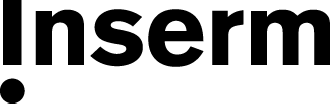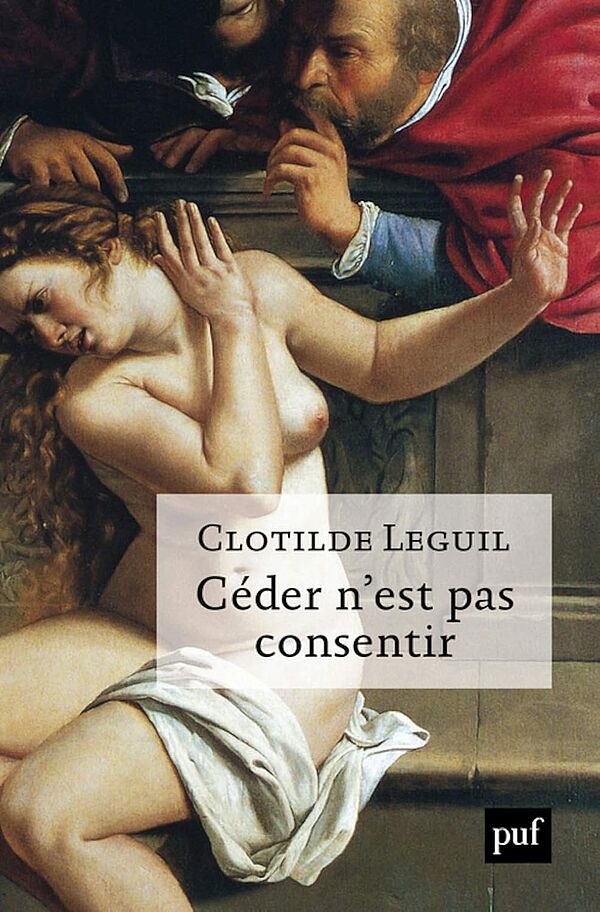« Si la révolte du “Nous les femmes” énonce un “non”, l’écriture du “Je” explore l’ambiguïté d’un “oui” » (p. 10). Avec Céder n’est pas consentir, Clotilde Leguil, philosophe, essayiste et psychanalyste, propose d’interroger la frontière entre le consentement et la cession, ces « affaires de corps et de paroles […], d’inconscient et de pulsion » (p. 22). Alors que Mai 68 a entraîné une libération des corps, un processus dont la face négative a longtemps été « cachée » (Malka Marcovich, L’Autre héritage de 68, 2018) : injonction à la jouissance, normalisation des abus par exemple, les années #MeToo ont libéré la parole des femmes, leur offrant la possibilité de dire et écrire ce qui leur est arrivé. On assiste ainsi à la naissance d’un espace d’échange et de partage d’expériences qui, cependant, suscite des débats. En plus de renforcer le clivage séparant les hommes des femmes, ce « nous » nouvellement entendu « n’ouvre pas sur une reconnaissance singulière du traumatisme de chacune » (p. 13). C’est ici que l’intérêt de la littérature se fait pleinement ressentir, car elle permet d’interroger la parole du « je » et invite à « trouver une langue singulière pour dire ce qui m’est arrivé » (p. 14). C’est ce qu’a fait Vanessa Springora avec Le Consentement (2020). Née à une époque marquée par la libération sexuelle, l’autrice de ce témoignage est non seulement la victime d’un homme mais aussi celle d’une ère où « “céder” avait voulu dire “consentir” au profit de quelques-uns cherchant à jouir sans s’inquiéter du désir de l’Autre » (p. 19). Pourtant, « ce à quoi elle a consenti n’a aucun rapport avec ce à quoi elle a dû céder » (p. 20). À partir de ces premières constatations, Clotilde Leguil décide de partir à la découverte de « ce monde intime et mystérieux du consentement » (p. 11), et cela en mêlant psychanalyse, art et politique.
« Qui ne dit mot consent » ? : mystère, voix muette et corps parlant
Depuis quelques années, le système médical a mis en pratique le « consentement éclairé ». Née de la méfiance des patient·es envers les médecins, et inversement, cette sorte de pacte « fait croire à un fondement rationnel du consentement » (p. 31), alors même que le cum sentire se fonde sur le sentir. Le consentement est un « pari » (p. 33) que je fais sans savoir : j’accepte de vivre l’« expérience d’un dénuement » (p. 28), de me confier à l’autre, sans pour autant être sûr·e de ce qui m’arrivera vraiment. Cette « ouverture à l’autre » (p. 27) n’est cependant pas un don total, une idée que Clotilde Leguil analyse à travers La Prisonnière (1923) de Marcel Proust. Consentant à donner son amour, Albertine reste toutefois un personnage opaque aux yeux du narrateur. « Il perçoit bien que son consentement ne dit pas tout d’elle. Elle n’est pas “toute” à lui pour autant » (p. 28-29). On ressent dès à présent les registres freudien et lacanien qui inspirent la psychanalyste, le « toute » rappelant le « pas toute phallique » de Lacan. À la suite de ses prédécesseurs, Clotilde Leguil se tourne vers le féminin et se demande si le consentement ne révèlerait pas « quelque chose de la féminité comme expérience corporelle de jouissance » (p. 35), voire s’il ne serait pas une mise en forme de l’expérience du « devenir femme », laquelle ne tiendrait « d’aucun programme naturel ou social, d’aucune obligation, mais plutôt d’un consentement fondé sur la rencontre » (p. 35).
Quelque énigme que puisse receler le consentement, il ne relève pas du traumatisme. A contrario, la cession tient d’une « angoisse qui provient de ne pas savoir, quelquefois, jusqu’où il faut aller pour obtenir une reconnaissance de l’autre » (p. 43). Par cette définition, Clotilde Leguil entend montrer que l’action de céder peut venir d’une « sur-obéissance » (p. 44, elle reprend Frédéric Gros, Désobéir, 2017) qui, cependant, n’est pas forcément visible de l’extérieur : « Qui peut affirmer s’il y a eu consentement ou pas, entre deux êtres ? Seule la parole du sujet concerné peut permettre de révéler cette frontière » (p. 46). Que faire alors lorsque le sujet ne sait plus ? Lorsqu’il s’est tu ? Lorsqu’il se tait ? « Qui ne dit mot consent », dit le dicton. S’il est vrai que le consentement peut se faire silencieusement, le silence n’est toutefois pas nécessairement un consentement. Parfois, « “Qui ne dit mot” a perdu la parole », explique la psychanalyste. « “Qui ne dit mot” est condamné au silence car l’effraction à laquelle il a eu affaire dans le corps ne se laisse pas dire » (p. 49). En somme : « qui ne dit mot » n’a pas forcément consenti, pas toujours, quelquefois pas du tout, et c’est précisément cette absence de consentement que la personne ne parvient pas à dire, voire dont elle ne saura jamais parler. Mais lorsque « je » ne dit pas, le corps, lui, parle. Il sait, marqué qu’il est « par l’expérience d’une rencontre qui a laissé en lui des hiéroglyphes illisibles et douloureux, traces de l’événement traumatique » (p. 47).
Passif politique et passivité : consentir ou « se laisser faire »
Pour parvenir à comprendre en profondeur la notion de consentement, Clotilde Leguil se tourne vers le domaine politique et rappelle que le terme acquiert une importance particulière à partir du XVIIIe siècle, avec la pensée du contrat social. Ce dernier, qui suppose de « ne se soumettre qu’à l’autorité que l’on reconnaît » (p. 54), aurait été implicitement signé par « des sujets libres et égaux en droit » (p. 57) et remettrait en question l’autorité éternelle du père. En effet, celle-ci ne devrait durer que le temps de l’enfance, après quoi les enfants, devenus sujets, consentent ou non au paternalisme. Ces interprétations peuvent être étayées par d’autres travaux. Dans The Sexual Contract (1988), Carole Pateman revient elle aussi sur le contrat social et montre qu’il implique un contrat sexuel fait entre hommes. Le consentement des femmes serait donc toujours déjà impensé, ou du moins détourné, dans le contrat originel. On rejoint alors ici, mais de biais, l’hypothèse de Clotilde Leguil qui, en s’appuyant notamment sur 1984 de George Orwell (1949), et L’Homme révolté d’Albert Camus (1951), explique que le consentement peut être instrumentalisé. Ce faisant, la chercheuse montre que la littérature peut restituer des dispositifs psychologiques qui, de façon immédiate, sont parfois voilés. En somme, il semble que la littérature soit apte à questionner les notions de transparence et de secret en ce qu’elle est un média capable de visibiliser, de dévoiler ce qui n’est pas toujours conscientisé par un sujet.
Mais pourquoi me suis-je laissé·e faire ? Possible « point de bascule » (p. 65) entre « céder » et « consentir », le fait de « se laisser faire » peut se décliner selon plusieurs modalités. Il existe tout d’abord un « se laisser faire » consenti et qui relève du désir. Passion Simple (1992) d’Annie Ernaux sert ici d’exemple à Clotilde Leguil pour illustrer son propos. « Se laisser faire » peut aussi recouvrir une dimension plus angoissante et traduisant mon ignorance quant à « ce que l’autre veut de moi » (p. 69). Enfin, l’essayiste s’intéresse à une troisième modalité. Cette fois, l’idée de « se laisser faire » est perçue comme un « moment trouble et obscur où le sujet n’est plus en mesure de consentir ou pas » (p. 77). Alors que les exemples ne manquent pas, – on ne compte malheureusement plus le nombre de victimes qui, des années après un acte pédocriminel, se souviennent et prennent la parole –, c’est sur le cas d’une patiente de Freud, Emma Eckstein, que s’arrête l'autrice. Le récit d’un cas clinique est attendu dans l’ouvrage d’un·e psychanalyste. Cependant, pourquoi s’appuyer sur un cas si ancien ? À la lecture de l’essai, il apparaît en effet que cet exemple ne fait qu’instaurer une excessive distance entre les lecteur·ices et le sujet du livre, ce qui empêche, non pas d’en comprendre l’importance, mais de s’y confronter, d’y faire face, ici et maintenant. Que disent les femmes d’aujourd’hui lorsqu’elles se font psychanalyser ? Ont-elles la même réaction qu’Emma, cette femme décédée il y a près d’un siècle, soit bien avant Mai 68 et #MeToo ? Si Clotilde Leguil ne donne pas de réponses directes à ces questions, par l’analyse d’une étude de cas plus récente, elle revient en revanche sur les tenants et conséquences de la cession, un acte qui recouvre différentes formes.
Céder sur et à
L’expression « céder sur », qui signifie abandonner son désir, le mettre de côté, a été mise en évidence par Lacan. Pour lui, l’éthique consiste non seulement à ne « pas céder sur son désir » mais également, et ceci découle de cela, à « ne pas céder à la pulsion [de mort] » (p. 93), ce qui ne veut toutefois pas dire qu’il faille « opérer un forçage sur l’Autre. Ne pas céder sur son désir, c’est prendre garde à sa propre jouissance » (p. 104). Antigone se révèle alors être un personnage exemplaire, car elle « ne consent pas et ne cède pas. […] La jeune fille préfère aller à la mort, être enterrée vivante, plutôt que de renoncer à son désir » (p. 106). Si, à la lecture de ces mots, l’on pourrait penser qu’Antigone se laisse aller à la pulsion de mort, là n’est pas l’analyse de l'autrice. En effet, Clotilde Leguil explique que l’héroïne « ne renonce pas à son désir et fait de ce désir une valeur plus grande que sa vie même » (p. 106). D’aucun·es peuvent certes reprocher à cette interprétation d’être quelque peu forcée. Malgré tout, on ne saurait nier la lutte qu’a menée Antigone pour ne pas se trahir, pour ne pas se sentir coupable d’avoir cédé sur « son désir de ne pas céder » (p. 106).
« Céder à » a un tout autre sens. Liée au traumatisme, cette expression porte à interroger le « sujet dans son rapport au corps, à son corps » (p. 110). Selon la psychanalyste, en cas de situation traumatique le sujet cède à la situation même, et il se fige, incapable de dire quelque angoisse. Ce « figement » est donc lié à de l’« inarticulable », que Clotilde Leguil perçoit selon plusieurs dimensions. Elle montre ainsi qu’à la pudeur s’ajoute l’idée d’aveu, laquelle implique « de dire quelque chose de ce qui a été éprouvé sans le consentement du sujet […]. Cet aveu peut alors fragiliser celle ou celui qui ne parvient pas à faire reconnaître ce qui s’est produit en son corps » (p. 115).
Parler et croire : (re)trouver sa langue
« L’histoire du traumatisme sexuel est toujours l’histoire d’un silence » (p. 126). Telle est l’idée que Clotilde Leguil tire de l’un de ses rêves et du mythe de Philomèle. Violée par Térée, la jeune femme est ensuite mutilée par l’homme, qui lui coupe la langue. Si l’« image de langue coupée dit métaphoriquement le morceau de corps arraché par le traumatisme sexuel » (p. 133), l’histoire de Philomèle nous apprend aussi que « [c]e dont on ne peut plus parler, il ne faut pourtant pas le taire. […] Il faut inventer une autre langue » (p. 134), ici par la broderie.
Dora, patiente de Freud, a cherché cette langue. Elle a tenté de parler, mais son père ne l’a pas crue. Alors sa langue fut le mutisme, car se retrouver face à une personne qui ne croit pas « réédite le caractère inarticulable du trauma » (p. 120). Pour livrer quelque parole, il faut se trouver face à quelqu’un·e « qui sache en faire résonner aussi la dimension de silence » (p. 143), cette zone du « mi-dire » lacanien et qui traduit un trauma qu’on ne dit pas clairement mais que « les mots peuvent faire résonner à travers ce qu’ils disent » (p. 144). Autrement, comment faire entendre ce contre quoi « je » n’a peut-être pas dit mot ? Ce face à quoi le mutisme est la réponse ? « Comment dire avec des mots ce qui ne relève plus des mots mais qui a percuté le corps ? » (p. 144), demande encore Clotilde Leguil.
L’Autre et moi : collectif, féminité et concession
Comment faire lorsque mon expérience côtoie celle d’une collectivité ? Lorsque tout fonctionne « [c]omme si le “Nous” imposait silence au “Je” » (p. 148) ? Pour analyser ces situations, la psychanalyste revient notamment sur les traumatismes de guerre et explique que la question du consentement et de la cession s’entend aussi en temps de guerre, lequel ouvre à la notion de « non-préparation » (p. 154) et d’effroi. Un ouvrage comme Le Lambeau (2018), de Philippe Lançon, lui permet par ailleurs de souligner l’intérêt de l’écriture, qui « peut devenir le lieu où se dit cet indicible du trauma » (p. 161). Retraçant les attentats du 7 janvier 2015, l’auteur a « recousu quelque chose qui s’était ouvert à vif » (p. 163). Certes, son ressenti et son vécu ne seront jamais ceux de l’ensemble des victimes. Néanmoins, « entendre, lire la solution d’un seul, sa réponse au réel, transmet à chacun une direction » (p. 166).
Il est une expérience, cependant, « qui n’est pas représentée dans le groupe, dans l’universel de l’ensemble des êtres qui appartiennent à la même espèce, dans le langage même » (p. 172) : c’est celle de la féminité, au sens où l’entend Lacan. Selon lui, « La femme n’existe pas », c’est-à-dire qu’il n’y a pas un modèle « Femme ». Par ailleurs, Lacan met en évidence une jouissance dite « féminine », soit une jouissance qui n’est pas toute phallique mais qui est un peu ailleurs. Clotilde Leguil montre ainsi que le consentement entretient un lien particulier avec la féminité, ce « dédoublement » que met en scène David Lynch dans Mulholland Drive (2001). Dans ce film onirique, le cinéaste expose une femme persuadée que « La » femme existe. Cette croyance crée chez Diane, l’héroïne, une fascination pour une autre femme, en qui elle dépose « l’éclat d’une féminité qui lui semble inaccessible » (p. 173). Ce faisant, Diane rejette l’expérience de la féminité, c’est-à-dire qu’elle refuse de consentir à cette « région de soi-même, marquée d’une opacité et qui peut se réveiller telle une part méconnue de ce que l’on ne savait pas de nous » (p. 175). Et l’essayiste d’écrire :
Si le consentement est dessaisissement, la féminité aussi, si le consentement est “déprise” de soi, la féminité aussi, si le consentement est une façon de se jeter dans une aventure dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants mais qui nous fait nous sentir plus vivants, la féminité aussi, si le consentement est affaire de choix intime et de vibration corporelle, la féminité aussi (p. 168).
Intense, cette « rencontre avec une jouissance qui traverse le corps » ne doit pas se confondre avec « une jouissance imposée par l’autre, qui provoque […] un séisme auquel le corps ne consent pas » (p. 185). En se focalisant sur le sujet féminin, Clotilde Leguil explique que l’amour, qui est « une condition de la jouissance », peut parfois donner lieu aux « plus grandes concessions » (p. 189). Frontière entre « consentir » et « céder », la concession revient à « renoncer au désir pour faire de la jouissance supposée de l’Autre le signe hypothétique de l’amour, déjà perdu » (p. 196).
114 000. C’est le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées en 2023 (7 mars 2024). Combien d’autres gardent encore le silence ? Au nom de quoi ? En 2021, Camille Kouchner expliquait avoir « consenti au silence » (p. 201) au nom de sa « grande famille » (La Familia grande, 2021). D’autres le font au nom de « l’indivision d’un amour imaginaire, [de] l’indivision d’une communauté » (p. 201), ou encore au nom du père. Si le « au nom de » amène à « la démission de soi-même » (p. 201), il peut aussi pousser à « désobéir à la soumission » (p. 201), à se révolter. « Se révolter, lorsque le consentement conduit au traumatisme, c’est se retrouver » (p. 203). Loin de lancer un appel implicitement injonctif aux victimes silencieuses, Clotilde Leguil ne se leurre pas. Elle sait que cette révolte peut coûter : « Le prix à payer pour l’accès à son propre “Je” est alors un autre consentement, un consentement à prendre le risque de perdre finalement un monde dans lequel on a cru » (p. 202). Cette conscience est l’une des plus grandes qualités de Céder n’est pas consentir, un essai par ailleurs rédigé par une plume attentive au style et à la formule. Il est vrai que certains passages sont complexes, surtout pour un public ne s’étant jamais confronté au discours lacanien et aux théories freudiennes. Cependant, les propos les plus importants de Clotilde Leguil ne se trouvent pas dans les idées parfois cryptiques de ses prédécesseurs. Ils sont dans ce qu’elle en ressort, dans ses analyses littéraires et cinématographiques (Proust, Ernaux, Woolf, Duras, Lynch, Cukor, Lançon, Cimino, Hitchcock, par exemple), dans les questions qu’elle pose et qui invitent à écouter la parole de l’Autre, même – surtout ! – si c’est un silence. « Je » n’a pas dit non. « Je » n’a rien dit. « Je » a peut-être même joui. Qu’importe. Écoutez bien, car « céder n’est pas consentir ».
Salomé Pastor - Doctorante en littérature française - Configurations Littéraires