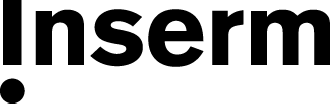L’analyse du point de vue genré suscite depuis plusieurs années d’importants débats dans le domaine des études littéraires françaises et francophones. La discussion que suscite la prise en compte des marques de genre dans les descriptions focalisées, bien ancrée dans le contexte anglo-saxon, semble avoir tardé à franchir l’Atlantique : dès les années 1980, la chercheuse américaine Susan S. Lanser appelait à une « narratologie féministe », « une réécriture de la narratologie qui prenne en compte les contributions des femmes comme productrices et comme interprètes des textes[1]. »
En 1975, dans son article fondateur intitulé « Visual Pleasure in Narrative Cinema », Laura Mulvey avait déjà élaboré un concept pour étudier le genre du point de vue au cinéma : le « male gaze ». Le terme de « gaze » désigne en anglais un regard long et intense[2] ; on pourrait donc traduire grossièrement par « regard fixe du mâle ». Mais il ne suffit pas que l’instance focalisatrice soit de sexe masculin pour qu’il y ait « male gaze ». Mulvey définit plusieurs critères : le « male gaze » est celui qui impose « [l]a femme comme image, l’homme comme porteur du regard » (Mulvey, p. 40). Il morcelle le corps féminin, restreignant le regard du spectateur à des zones du corps fortement érotisées ; il réifie, contraignant le corps regardé au statut d’objet du désir. Dans la définition que Mulvey établit du « male gaze », le masculin est synonyme d’actif, tandis que le féminin est toujours déjà passif, restreint à sa « vocation à être regardé[3] ». Le personnage féminin est ainsi voué à l’exhibition, sur le modèle de la pin-up ou de la strip-teaseuse. L’article de Mulvey revendique un ancrage psychanalytique, usant notamment de la notion freudienne de « pulsion scopique », ce plaisir pris à regarder un tiers comme objet érotique qui serait au fondement du « male gaze ». La conclusion de l’article soutient que « la femme en tant que représentation peut signifier la castration et déclencher les mécanismes voyeuristes et fétichistes nécessaires pour contourner la menace qu’elle incarne. » (Mulvey, p. 49)
L’article de Mulvey, traduit en français en 2017, a eu un retentissement aussi important que tardif. Tout en prenant le plus souvent leurs distances avec l’angle psychanalytique affiché par Mulvey, les spécialistes de littérature ont récupéré la notion, en tentant de l’adapter à l’analyse textuelle. Que devient le « gaze » lorsque disparaissent caméra et cadrage ? Plusieurs propositions ont émergé récemment. La question se pose dès lors en termes de focalisation littéraire ; elle interroge les techniques de la description en focalisation masculine, à la recherche des signes textuels de point de vue. Anne-Claire Marpeau a ainsi proposé une lecture nuancée du regard masculin dans le roman réaliste du XIXe siècle :
Les récits réalistes produisent donc des effets paradoxaux, puisqu’ils orchestrent la codification des normes du corps féminin selon les attentes du male gaze et font de la violence de ce regard une conséquence du désir suscité par ce corps, mais ils offrent, dans le même temps, la possibilité de s’identifier à certains protagonistes féminins et de faire, par la fiction, l’expérience d’une destinée féminine, ce dont la réception des textes peut parfois témoigne (Marpeau, 2023).
Cette restitution de l’« expérience d’une destinée féminine », Iris Brey l’a analysée en 2020 dans son ouvrage Le Regard féminin. Une révolution à l’écran. Comme Mulvey, Brey affine le concept de « gaze » à partir du cinéma. Elle choisit une approche phénoménologique, qui permet de définir le « female gaze » comme « un regard porteur d’une expérience spécifique – celle de ressentir une expérience vécue féminine – dont la subjectivité repose sur une construction historique et sociale. » (Brey, p. 49). Le « female gaze » serait un regard non plus voyeur ou fétichiste mais empathique vis-à-vis du personnage féminin : « nous ne la regardons pas faire, nous faisons avec elle. » (Brey, p. 40)
Azélie Fayolle pointe trois ans plus tard, dans son ouvrage Des femmes et du style. Pour un feminist gaze, la menace d’essentialisme portée par le couple male / female gaze. Son feminist gaze permet d’éviter la dichotomie genrée, et d’interroger plus directement l’ampleur politique d’un regard qui rejette le point de vue des dominants. Azélie Fayolle ouvre la question du gaze à celle du style littéraire : « Ce sont des styles et des esthétiques élaborés contre la domination masculine, représentant l’expérience sociale de l’appartenance à la classe des femmes, qui font le feminist gaze – et le style féministe. » (Fayolle, p. 33). L’autrice a organisé avec Clément Dessy un colloque de grande ampleur intitulé « Male gaze, female gaze, feminist gaze, queer gaze… quels styles pour les études de genre ? XVIIIe-XXIe siècles », dont les actes permettront d’éclairer ces notions encore en construction et de préciser leurs modalités d’application aux champs littéraires.
Le concept de gaze prouve sa richesse et sa plasticité par les nombreux usages qui en sont faits. Pauline Noblecourt l’emploie avec profit pour questionner l’éclairage sur les scènes de théâtre au xixe siècle (Noblecourt, 2020) ; Muriel Cormican et Jennifer Marston William proposent la notion de « tender gaze » (Cormican, 2021), qui défend la dimension éthique d’un regard humanisant ; d’autres « gazes » émergent (queer, colonial, adult, validist…). Ils permettent tous d’interroger des regards dominants, et cherchent à déplacer le point de vue – littéralement et dans tous les sens.
Lucie Nizard - Université de Genève (Unige)
[1] Nous traduisons de l’anglais (U. S.) le passage suivant : « a rewriting of narratology that takes into account the contributions of women as both producers and interpreters of texts. » Lanser, Susan S., « Toward a Feminist Narratology », Style, vol. 20, n° 3, 1986, p. 341‑363, p. 343.
[2] D’après le Merriam-Webster Dictionary, “to gaze” signifie “to fix the eyes in a steady intent look often with eagerness or studious attention”, ce que nous traduirions par « fixer avec un regard fixe et déterminé, souvent avec insistance ou une attention studieuse ».
[3] Mulvey parle de « to-be-looked-at-ness ».
Bibliographie :
- Iris Brey, Le regard féminin: une révolution à l’écran, Paris, Editions de l’Olivier, 2020.
- Muriel Cormican et Jennifer William, The Tender Gaze: compassionate encounters on the German screen, page, and stage, Rochester, New York, Camden House, coll. Women and gender in German studies, 2021
- Susan S. Lanser, « Toward a Feminist Narratology », Style, vol. 20, n° 3, 1986, p. 341‑363.
- Anne-Claire Marpeau, « Le regard masculin, ou male gaze : le roman réaliste français du XIXe siècle à l’épreuve d’un outil d’analyse féministe », Romantisme, vol. 201, n° 3, 2023, p. 139‑154.
- Laura Mulvey, Au-delà du plaisir visuel: féminisme, énigmes, cinéphilie, n. 1, Milan / Paris, Éditions Mimésis, coll. Formes filmiques, 2017.
- Pauline Noblecourt, « Techniques du regard masculin sur les scènes parisiennes, 1850-1880 », in Frédérique Desbuissons, Marie-Ange Fougère et Érika Wicky (dir.), L’œil du XIXe siècle, Actes du Congrès de la SERD, Société des Études romantiques et dix-neuviémistes, 2020.
- Jennifer Tamas, Au Non des femmes. Libérer nos classiques du regard masculin, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 2023.