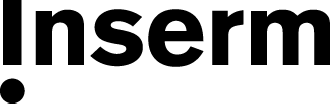L’« affaire » Chénier est une controverse qui a agité le champ universitaire littéraire français à la suite d’une lettre ouverte adressée au jury de l’agrégation de lettres modernes et publiée par des agrégatif·ves de lettres modernes en novembre 2017 sur le site de l’association féministe de l’ENS Lyon. Le contenu de cette lettre interrogeait le jury sur la pertinence de l’emploi du mot « viol » quand il s’agit de commenter littérairement un texte, en l’occurrence le poème « L’Oaristys » d’André Chénier, dans lequel un viol est représenté. Les auteur·ices de la lettre y argumentaient en faveur de l’emploi de ce terme. S’en est suivi un débat vif, voire virulent, à l’initiative d’Hélène Merlin-Kajman, entre ces jeunes chercheur·es et futur·es enseignant·es et des membres du séminaire Transitions de l’Université Paris III autour de la pertinence d’employer le terme de « viol » pour analyser un texte littéraire. Par la suite, des articles de presse d’un côté et des écrits universitaires de l’autre ont été publiés au sujet de la représentation des violences sexuelles dans les œuvres littéraires et des mots qu’on emploie pour les décrire et les commenter[1].
Outre le débat terminologique (dire le viol) se joue aussi un conflit d’interprétation (voir le viol), et au-delà d’une lutte de positionnements pour la légitimité entre divers·es acteur·ices du champ littéraire, l’affaire soulève des questionnements épistémologiques et éthiques. Comment intègre-t-on dans la recherche et l’enseignement les réceptions contextuelles et générationnelles ? Comment fait-on une place aux nouvelles épistémologies qui revendiquent la légitimité des savoirs situés, en lien avec la reconnaissance des groupes sociaux dominés et/ou minorés ? Comment aborde-t-on littérairement les problématiques éthiques et affectives que suscite la littérature, dans la recherche et en situation d’enseignement ?
Le texte
Pour aborder l’affaire Chénier, sans doute faut-il présenter brièvement le poème. « L’Oaristys » d’André Chénier est une réécriture de l’idylle 27 de Théocrite, idylle dont on sait aujourd’hui qu’elle est apocryphe. Dans la tradition de l’idylle et de la pastourelle, le poème est composé d’un dialogue versifié (en alexandrins ici) entre un berger, Daphnis, et une bergère, Naïs. Le texte est structuré par l’alternance entre l’insistance de Daphnis qui cherche à obtenir une relation sexuelle avec Naïs et le refus de cette dernière. À la fin du poème, Daphnis force Naïs à avoir une relation sexuelle malgré son refus. En termes contemporains, on dirait donc qu’il la harcèle, puis la viole.
Le poème d’André Chénier s’inscrit dans une tradition intertextuelle foisonnante et n’est en réalité pas la première, ni la dernière réécriture en langue française de l’idylle 27. Il en est une des versions, puisque le texte du pseudo-Théocrite a fait l’objet de nombreuses adaptations au XVIe et XVIIe siècles, ainsi que le montre Guillaume Peureux (Peureux, 2023). Estienne Forcadel, Jean-Antoine de Baïf, Antoine de Cotel, Claude Gauchet, Vauquelin de la Fresnaye et Jean de La Fontaine ont repris le texte et ses motifs (ibid.). Il est également intéressant de souligner qu’après Chénier, Balzac a réécrit le texte dans un chapitre des Paysans, sous le titre « L’Oaristys, XXVIIe églogue de Théocrite, peu goûtée en cour d’assises ». Il y raconte la tentative de viol d’une jeune paysanne de treize ans par un paysan et sa sœur.
Ces réécritures de l’idylle 27 en proposent des variations mais toutes mettent en scène l’agressivité sexuelle du personnage masculin, plus ou moins explicite selon les textes, face à un personnage féminin qui refuse toujours dans un premier temps la relation sexuelle, ce qui fait dire à Guillaume Peureux que les poèmes qu’il étudie apparaissent comme le lieu d’une interrogation sur une « situation sociale problématique » (ibid., p. 100[2]). Cette représentation littéraire répétée de la même situation traduirait l’observation d’un fait social qui dérange ou fascine, mais qui toujours interroge, ce que chaque écrivain représente avec les outils poétiques et littéraires de son temps. Le texte balzacien « réaliste », qui oscille entre dénonciation de la violence et sexualisation du personnage féminin, semble confirmer cette hypothèse.
Le débat contemporain au sein de l’université sur l’interprétation du texte de Chénier manifeste d’ailleurs lui aussi la persistance d’un questionnement sur les représentations littéraires des rôles de genre dans la scène de « séduction » et sur la violence inhérente à ce qu’on pourrait appeler le « script » (Gagnon, p. 73-79) hétérosexuel de cette scène.
Le débat : lignes de tensions
Résumons les grandes lignes de tension qui structurent ces échanges.
Une partie des arguments de la controverse porte tout d’abord sur une question de représentation littéraire. Deux positions se manifestent dans ce débat : d’un côté, l’idée que la scène de « séduction » présente dans « L’Oaristys » repose sur une série de codes et de topoï, construisant ainsi un jeu de rôles dans lequel le personnage féminin mime le refus. Il s’agirait pour le poète, d’une part, de répondre aux exigences de bienséance attendue du sexe féminin en matière de sexualité et, d’autre part, d’augmenter le plaisir érotique de la scène, dont l’attente mimerait et provoquerait l’exacerbation du désir du lecteur ou de la lectrice ; mais d’un autre côté, l’idée que la scène reprend en effet une représentation codifiée fictive qui figure une violence masculine et un rapport de genre dans lequel les femmes sont présentées comme passives et dominées, dans lequel leur « non » signifie « oui », fait le fond de ce qu’on appelle la « culture du viol ». En d’autres termes, la controverse permettrait d’interroger les rapports de la littérature et du réel, en particulier de la littérature et du monde social. Derrière l’affaire Chénier se joue la question de la figuration et de la modélisation des rapports sociaux. Typique et codifiée, cette scène dit-elle tout de même quelque chose des rapports de genre réels dans une société donnée ? Et a-t-elle une valeur d’exemple voire d’injonction ? Rappelons à ce titre que la controverse est née dans le contexte d’un concours d’enseignement, qui implique non seulement des questionnements très pragmatiques sur les attentes et modalités d’évaluation d’un concours qui détermine la carrière de celles et ceux qui le passent, mais aussi des questions sur ce que la littérature transmet et sur la façon dont on transmet la littérature.
Par extension, la controverse soulève donc des interrogations sur les liens entre littérature et éthique. Ce n’est alors pas seulement la portée éthique de la scène mais celle de son interprétation qui est mise en cause. Voir ou non, dire ou non le viol repose sur la validation ou l’invalidation de conduites dans le monde que certain·es des membres des camps opposés associent à une urgence éthique : défendre l’indépendance de la littérature face au militantisme et aux sirènes de l’idéologie, défendre les lecteurs et lectrices de la violence que la littérature perpétue. À ce titre, l’affaire Chénier est sans doute une manifestation de la révolution morale qui rend désormais les violences sexistes et sexuelles à la fois plus visibles et moins acceptables.
Plus encore, la controverse révèle le point de vue situé des interprètes et peut être analysée à l’aune des épistémologies du standpoint (Zenetti, 2021) et des approches en réception. À travers l’interprétation du texte, ce sont celles et ceux qui le lisent, les modes de lectures adoptés et les communautés interprétatives qui se rencontrent. Les différents acteurices du débat ont des positionnements sociaux divers (âge, sexe, légitimité au sein de l’université, etc.), adoptent des pratiques de lecture historicisantes ou actualisantes[3], ont recours à des traditions critiques différentes. Les études de genre par exemple, connues des signataires de la lettre, se sont diffusées depuis longtemps dans l’université anglo-américaine, et la pastourelle y a été lue comme une manifestation de la violence patriarcale, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’alors au sein de l’université française. L’affaire Chénier peut ainsi être perçue comme un exemple de débat entre communautés interprétatives (Fish, 2007), en particulier en ce qui concerne la diffusion de voix féminines et de thèses féministes que soutiennent les signataires de la lettre, à laquelle s’opposent des interprètes moins sensibilisé·es au repérage des manifestations de la culture du viol dans les œuvres.
Le plus délicat dans l’affaire Chénier est alors peut-être ce que la lecture du texte suscite et éveille en matière d’affects et qui appartient à ce que j’appellerais une « phénoménologie de la réception ». La lecture de ce texte qui porte sur une expérience de « séduction » selon les un·es, de violence sexuelle selon d’autres, mobilise sans doute chez ses lecteurs et lectrices des expériences physiques et vécues. Elle engage des expériences du corps, de la sexualité et du pouvoir. Voir ou ne pas voir, dire ou ne pas dire que la violence masculine fait partie des représentations littéraires et artistiques de l’hétérosexualité peut donc renvoyer à d’autres expériences hors texte, certaines peut-être traumatiques, certaines peut-être inenvisageables, certaines peut-être insupportables, et on comprend alors le nécessité qu’il y a pu avoir à rendre dicible ou indicible le viol dans « L’Oaristys ».
Anne-Claire Marpeau - Configurations Littéraires
[1] La plupart des textes de la controverse sont disponibles sur le carnet d’Hypothèses Malaises dans la lecture.
[2] On doit d’ailleurs à Vauquelin de la Freysnaye ce qui semble être la première occurrence en langue française du terme « harceler » dans son acception sexuelle.
[3] La question de l’anachronisme et la défense de l’anachronisme contrôlé (Nicole Loraux) a été souvent soulevée.
Bibliographie :
- Stanley E. Fish, Quand lire c’est faire. L’autorité des communautés interprétatives, trad. de l’américain par E. Dobenesque, Paris, Éd. Les Prairies ordinaires, 2007.
- John Gagnon, « Les usages explicites et implicites de la perspective des scripts dans les recherches sur la sexualité », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 128, juin 1999, p.73-79.
- Guillaume Peureux, « “Jamais un brave chien n’abandonne son os”. Remarques sur L’Oaristys entre 1548 et 1674 », dans Armel Dubois-Nayt et Réjane Hamus-Vallée (dir.), Écrire l’histoire du harcèlement sexuel. Les mots pour le dire, Actes du webminaire AVISA Historiciser le harcèlement sexuel, Gif-sur-Yvettes, MSH Paris-Saclay Éditions, 2023, p. 95-108.
- Marie-Jeanne Zenetti, « Théorie, réflexivité et savoirs situés : la question de la scientificité en études littéraires », dans Fabula-LhT, n° 26, 2021.