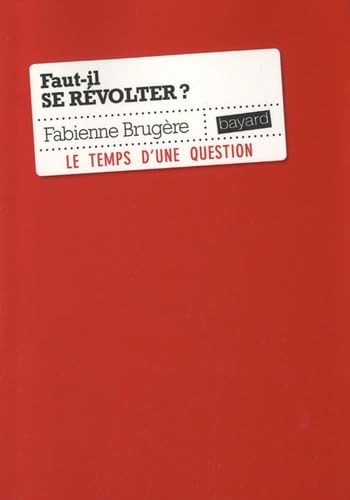C’est dans un contexte marqué par l’occupation de lieux publics en Europe (la Puerto del Sol par les Insurgés en Espagne, Occupy Wall Street aux États-Unis) et par des insurrections dans le monde arabe (Tunisie, Égypte) que Fabienne Brugère, inspirée par Jacques Rancière, pose une question aux accents camusiens toujours d’actualité : faut-il se révolter ? Plus précisément, en se tournant du côté des démocraties représentatives, elle se demande de quoi la révolte est le signe. Plutôt que de céder à une lecture pessimiste, qui verrait dans la modernité « la fin de la politique » (p. 6) et dans la révolte un « déclin démocratique » (p. 7), elle estime que les révoltes témoignent du « désir d’une autre politique » et révèlent « l’envie des peuples de renouer avec la puissance d’agir collectivement, avec la volonté de re-fabriquer du lien démocratique » (p. 9). L’essai se propose d’envisager comment l’action politique des gouvernés, à rebours de l’expertise des gouvernants, participe à l’élaboration d’« une alter-politique capable de construire un monde commun à partir de puissances d’agir toujours singulières » (p. 15).
Le premier temps de la réflexion interroge deux activités démocratiques, l’une « normale », représentée par le vote, l’autre « anormale », incarnée dans la révolte, pour revenir sur l’idée que le premier serait l’indice d’une démocratie saine et la seconde d’un dérèglement. Fabienne Brugère se montre plutôt réservée quant au pouvoir d’action du vote à l’ère de la manipulation médiatique, surtout lorsqu’il « délégitimise […] des formes d’action politique plus directes » (p. 46) et conduit à une forme d’apathie. En regard, elle voit dans la révolte, issue du sentiment de déficit démocratique, un appel subversif à « un retour à la démocratie contre tous les cadres qui la rendent spectrale » (p. 32). Aussi la révolte formule-t-elle une critique de la démocratie qui ne constitue pas sa négation, mais exige à l’inverse son retour, à condition de repenser les relations entre gouvernants et gouvernés ainsi que les modalités de participation de ces derniers au projet collectif. Le sens du vote est alors à repenser. S’il est la condition minimale et nécessaire de tout régime démocratique, il reste insuffisant pour fonder une expérience véritablement démocratique, qui exige un engagement des subjectivités politiques dans des actions de plus grande intensité. La philosophe ramène également le vote à son principe, pour penser une société plus juste, plus attentive aux singularités. Rappelant que « la démocratie doit porter comme hypothèse celle de l’égalité » (p. 24) et que « le suffrage universel établit l’égalité d’expression des voix » (p. 51), Fabienne Brugère appelle à prendre au sérieux cette égalité des voix, qui doit faire cas de toutes les voix, y compris les plus fragiles. Fondant la politique dans l’éthique du care posée par Carol Gilligan dans Une voix différente (1982), la philosophe voit dans la revendication de l’égalité des voix un exercice et une finalité de la révolte, entendue comme remise en cause des cadres qui concourent à les étouffer :
Promouvoir l’égalité des voix ne saurait alors s’accomplir sans un souci des voix les plus fragiles, les moins dessinées ou les plus discriminées par les catégories générales normatives. « Prendre soin » des voix fragiles ne peut se faire sans avoir en ligne de mire l’hypothèse démocratique de l’égalité des voix. Agir en direction de l’autre pour une égalisation des conditions est une manière de pratiquer une égalité réelle […]. (p. 56-57)
Puisque le vote s’avère insuffisant, il s’agit de définir d’autres modes de participation à l’alter-politique. Le second temps de l’essai explore les modalités d’une « participation structurée par la puissance d’agir des citoyens » (p. 69) à distance des modèles d’Habermas et de Rancière, structurés sur les valeurs a priori d’entente d’un côté et d’universel de l’autre, dont Fabienne Brugère souligne le risque d’exclusion. En effet, souscrire à la valeur de l’entente, avec ce qu’elle implique de formalisation pour parvenir à un consensus, risque d’exclure du processus de participation celles et ceux « qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas respecter les protocoles d’expérience participative ». On peut donc paradoxalement « exclure au nom de l’entente », dès lors que celle-ci, en s’appuyant sur une « ingénierie participative », rétablit une forme de « gouvernance » (p. 80). Si Fabienne Brugère trouve dans les travaux de Rancière (Aux bords du politique, La Mésentente, La Haine de la démocratie) le moyen de penser une participation des gouvernés à la vie publique qui préserve leur subjectivité, elle émet une réserve sur l’appel à l’universel, qui exclut les voix différentes au nom de la « nécessité de renouer avec un commun déjà là » et « un espace déjà constitué politiquement » (p. 87). Alors que Rancière extrait de la sphère du politique les expériences et les luttes jugées trop partiales, ramenées à l’infra-politique (l’exemple donné est celui des sans-papiers), Fabienne Brugère, au nom de l’égalité des voix, place quant à elle au centre du politique la prise en compte des différences et des invisibilités sociales :
Mais que devient la participation si elle ne tient pas seulement dans le fait de rendre visible une population invisible, de rendre possible son écoute mais dans l’acte même de rendre visible la structuration de la société elle-même, son essence communautaire ? Or, le problème de la visibilité pour des vies invisibles, le problème de la reconnaissance pour des populations qui font l’expérience d’une différence convertie en domination ne sont-ils pas des problèmes politiques majeurs que la participation citoyenne doit prendre en charge ? (p. 88-89)
Ainsi, pour Fabienne Brugère, « la vraie participation est du côté des expériences subjectives dissonantes, des actions nouvelles et inattendues » (p. 91), qui se manifeste par l’effort de citoyens pour faire entendre ces vies et ces voix oubliées. Se ressaisissant du concept foucaldien d’« usage », la philosophe met en lumière la façon dont des sujets s’emparent des règles pour inventer des conduites contestataires, qui prennent une forme véritablement participative dans des gestes de visibilité et de transparence, comme le fait de donner la parole à des détenus, en ce qu’ils sont producteurs de contre-pouvoir et de contre-savoir : « Participer, c’est porter, par-delà le visible et le dicible, son intérêt pour des institutions particulières enfermantes, qui refusent de laisser parler et agir leurs usagers » (p. 97-98). À rebours des modèles qui présupposent l’entente ou renvoient à un universel défini a priori, cette participation a pour enjeu de « reconfigurer l’universel a posteriori en fonction des coalitions des différences » (p. 100) et depuis une « solidarité des gouvernés », dans le but de « créer un monde commun avec d’autres qui sont dans une forme d’altérité par rapport à soi » (p. 103), contre « le désir d’unité des gouvernants » (p. 102), enclins à niveler les différences, assigner des places et imposer des hiérarchies.
C’est à partir de là que l’on peut comprendre la dernière partie de l’essai, qui parle « au nom du féminisme ». Non seulement le féminisme sert à interroger les conséquences paradoxales de la révolte, qui passe d’un discours contestataire en apparence tenu par un sujet asexué à la reconduction de « l’imagerie virile la plus classique » (p. 112) et d’un « avenir politique largement masculin » (p. 110), mais il s’avère intrinsèquement lié à la philosophie de la révolte, entendue comme « combat de subversion des places établies créant ainsi une dynamique d’égalité des conditions » (p. 105) et « revendication de la part qui revient aux gouvernés » (p. 124). Le féminisme apparaît comme un modèle pour l’alter-politique : il est un « combat démocratique » à la recherche non d’une prise de pouvoir mais d’« un pouvoir d’agir partagé » (p. 128), qui « promeut l’égalité des voix et l’égalisation des conditions humaines » (p. 125), depuis « une solidarité des identifiés, des exclus ou des vulnérables » (p. 121), auxquels est reconnue une égale agentivité libérée des fixations identitaires (de genre, mais aussi de classe et de race). C’est parce qu’il laisse entrevoir « la possibilité, démocratique, de se gouverner soi-même au milieu des autres perçus comme des égaux », « dans la reconnaissance de la puissance d’expression de la multiplicité non cadrée contre le désir d’unité et d’homogénéité des gouvernants » (p. 128), que le féminisme est porteur d’un projet démocratique.
Faut-il se révolter ? entend ainsi nouer révolte et démocratie (plutôt qu’anarchie, piste restant inexplorée), sans pour autant aplatir les tensions inhérentes à leur mise en relation. Dans le sillage de L’Homme révolté d’Albert Camus (1951), Fabienne Brugère fait ainsi voir ce que la contestation comporte de construction ouverte sur la possibilité d’un renouveau collectif : « La bonne révolte vit de ses paradoxes : disant “je”, elle dit “nous”, posant le “non”, elle pose le “oui” et destituant un monde, elle en institue un autre. » (p. 23). Le livre entreprend le « réenchantement de la démocratie » (p. 106), dont les sursauts, de plus en plus nombreux sous la double pression de la globalisation et du néolibéralisme, traduisent non un désaveu complet du modèle démocratique, mais une vitalité porteuse d’avenir.
Kathia Huynh - Configurations littéraires