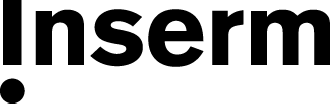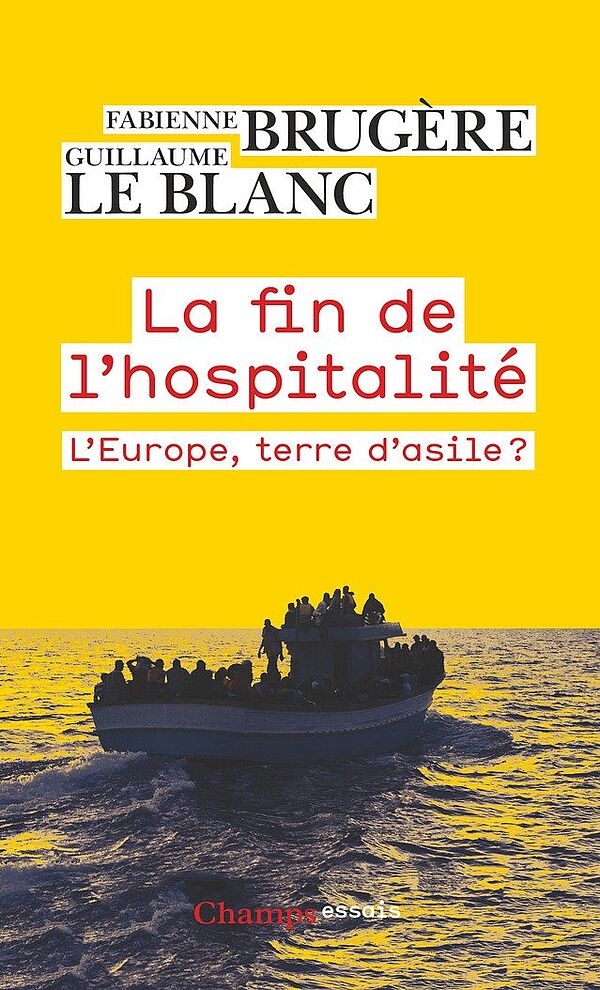La Fin de l’hospitalité. L’Europe, terre d’asile ? est l’aboutissement d’une série de stations effectuées par Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc dans plusieurs camps de migrants durant l’été et l’automne 2016, à Tempelhof en Allemagne, à la Linière de Grande-Synthe dans la banlieue de Dunkerque et dans la « Jungle » de Calais, démantelée en octobre 2016. Se réclamant d’une « philosophie de terrain » (p. 14), les deux philosophes se demandent si le XXIe siècle ne verrait pas la « fin de l’hospitalité » (p. 16), annoncée par la création en 1995 d’un « délit d’hospitalité » par le gouvernement français. Cette bascule aurait un retentissement d’autant plus grand que l’Europe, celle de l’Odyssée, s’est construite sur une culture et une morale de l’hospitalité, jusqu’à devenir avec Kant et Vers la paix perpétuelle (1795) un droit universel et le socle d’une politique internationale.
Refusant de séparer éthique et politique mais voyant plutôt comment chacun prend le relais de l’autre, l’essai tâche de démontrer que « la fin de l’hospitalité d’État […] ne signifie pas la fin de l’hospitalité des individus ou des collectifs ». Au contraire, « plus l’hospitalité politique reflue et plus en retour l’hospitalité éthique augmente », ce qui invite en retour à « politiser l’éthique de l’hospitalité » (p. 16). Abordée également par Michel Agier, cette question au cœur de l’actualité est examinée par Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc à travers sept chapitres, sous-tendus par deux ambitions principales : d’une part, la critique de la dévaluation de l’hospitalité, détournée en triage dans une biopolitique moderne ; d’autre part, le plaidoyer pour une sauvegarde de l’hospitalité, comme capacité à prendre soin des vies menacées par la vulnérabilité, l’indésirabilité et l’invisibilité sociale, grâce à l’éthique et à la politique du care.
Dans un contexte de montée des nationalismes et de triomphe d’une « discursivité de la fermeture totalement fantasmatique » (p. 33), qui imposent la norme nationale sur la réalité de migrations qu’il n’est plus possible de nier à l’ère des crises géopolitiques et climatiques, La Fin de l’hospitalité constate que le reflux des politiques d’hospitalité en Europe se concrétise par la substitution du secours à l’accueil. Si le secours est « une réponse immédiate à un appel de détresse » (p. 107) nécessaire en temps d’urgence, il court aussi le risque de devenir un cache-misère ou un trompe-l’œil hypocritement humanitaire, qui étouffe toute pensée de l’accueil égalitaire, viable et durable : « Toute vie a droit à être secourue mais certaines seulement peuvent être accueillies » (p. 115). Cela ramène à une biopolitique basée sur un tri d’urgence comportant « un grand risque d’arbitraire » (p. 129), comme le montre le roman Naufrage de Vincent Delecroix (2023). Les démocraties occidentales « ont ainsi fait refluer l’idéal cosmopolitique de l’accueil au profit de la norme biopolitique de secours de la vie menacée » (p. 114). S’emparant du concept foucaldien défini dans La Volonté de savoir (1976) comme un pouvoir de gestion sur la vie, Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc critiquent cette « nouvelle économie du bio-pouvoir », au sein de laquelle « le pouvoir aujourd’hui laisse vivre les réfugiés », ravalés au rang de « vies indésirables », pour les « laisser mourir » (p. 119). Ils montrent ainsi comment « le camp est devenu l’espace biopolitique de gestion des indésirables » (p. 120) et s’inscrit au sein d’un « archipel carcéral », mis au jour par Foucault dans Surveiller et punir (1975) : « La biopolitique du secours minimal devient une disciplinarisation maximale des centres d’accueil. À la séquence secourir et accueillir succède la séquence secourir, surveiller et punir » (p. 122). C’est au nom de la critique de cette biopolitique du tri que Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc contestent la terminologie administrative qui différencie réfugié et migrant : il s’agit pour eux d’« un artifice destiné à trier entre les individus que l’on accueille et ceux que l’on expulse », mis « au service d’un monopole d’État » (p. 125) s’arrogeant non plus un droit de vie ou de mort, mais un droit de séjour ou d’expulsion sur des vies d’inégale valeur.
Contre ce mirage, brandi comme un « supplément d’humanité qui laisse intacte la distinction entre vies utiles et vies inutiles » et empêche de remettre en question « le modèle de cité dans lequel nous vivons » (p. 157), Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc invitent à remettre l’hospitalité au cœur d’une « République bienveillante » (p. 207). Il leur faut, pour ce faire, prendre position contre deux attitudes symétriques : d’une part, contre le cynisme et le pragmatisme, qui voient dans la modernité le chant du cygne de l’hospitalité, incapable de répondre aux attentes d’une société inquiète ou indifférente face aux problématiques migratoires ; d’autre part, contre un idéalisme présumé, qui ferait de l’hospitalité le reliquat d’un monde révolu, voire une vertu déraisonnable. La Fin de l’hospitalité rejette la « pulsion de mur » (p. 167) et la « politique de l’intimité » (p. 189) d’une « République malveillante » (p. 210) qui préfère exclure les étrangers et trier les vies plutôt que se doter d’une politique de l’accueil. Mais pour autant, l’essai ne se réfugie pas dans une éthique individuelle et aristocratique, désincarnée et anachronique. En effet, La Fin de l’hospitalité se situe explicitement contre les séminaires que Jacques Derrida consacre à ce sujet entre 1995 et 1997. Estimant qu’il est aujourd’hui impossible « de s’orienter avec la pensée de Derrida » (p. 206), qui reconduit dans l’hospitalité un « attribut du sujet glorieux et héroïque » (p. 203-204), détaché des réalités sensibles, Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc se tournent du côté des philosophies du care, qui font de l’éthique un point de départ et un creuset du politique. Les formes de soin mises en œuvre dans les actions citoyennes et associatives trouvent un aboutissement concret dans le dispositif d’accueil qu’est l’hôpital, ouvert à toutes les personnes qui en font la demande, sans distinction ni tri. Celui-ci est ainsi amené à incarner la compréhension institutionnelle, impersonnelle et politique de l’hospitalité, contre la lecture contractuelle, domestique et morale héritée du modèle antique, recentré sur le foyer ou la chambre :
Nous considérons que l’hospitalité, telle qu’elle devrait être pratiquée aujourd’hui dans les États-nations qui sont les nôtres, doit d’abord se régler sur l’impératif politique de l’hôpital plutôt que sur le repli éthique de la demeure. Il est devenu insensé de vouloir faire porter l’exigence de l’hospitalité sur l’éthique des arts de vivre individuels pour ne plus la considérer que comme une sorte d’obligation personnelle alors qu’elle s’invente depuis des lieux qui sont eux-mêmes de part en part des dispositifs politiques. Si la morale ne peut exister que comme hospitalité, l’hospitalité ne peut exister que comme politique. (p. 199)
Sans nier la force motrice des sentiments moraux, du moment que ceux-ci sont « transformés en pratiques qui les incarnent » (p. 219), La Fin de l’hospitalité invite à ne pas en rester à la compassion, lorsqu’elle se réduit à une « valeur sentimentale qui tient lieu de politique » (p. 58). L’essai en appelle plutôt à penser une circularité heureuse entre éthique et politique : le recul du politique suscite une réaction éthique, appelée à être soutenue par une « politique de l’individu » (p. 215) consciente de la valeur et de l’interdépendance des vies humaines, toutes susceptibles de devoir un jour aller demander refuge ailleurs.
Kathia Huynh - Configurations littéraires