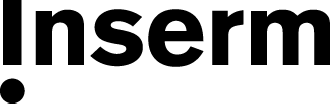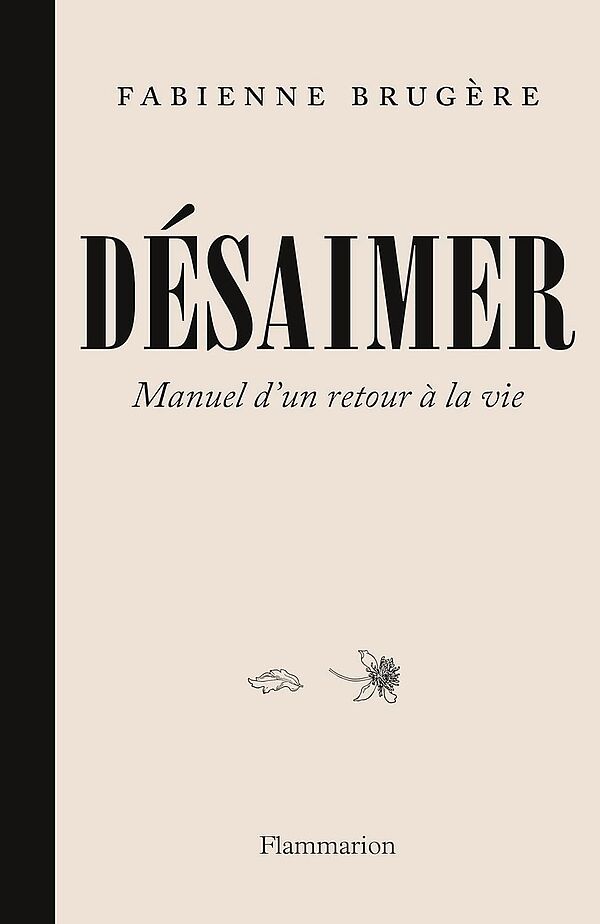Dans Désaimer (2024), Fabienne Brugère s’intéresse au pendant de l’amour, tout aussi universel mais nettement moins investi par la littérature, les arts et les sciences humaines : le désamour. Partant du constat qu’« il n’y a pas d’histoires du désamour » (p. 12), le livre investit un angle mort de l’imaginaire collectif dans le but d’appréhender cette expérience pourtant inscrite dans la trame du quotidien. Inspirée par la démarche de Barthes dans ses Fragments d’un discours amoureux (1977), la philosophe propose non pas un art de désaimer à la manière d’Ovide, mais « un manuel de vie stoïcien » (p. 15) sous les auspices d’Épictète, ce qui situe le discours dans la sphère de l’éthique : « comment vivre mieux » (p. 171) après la catastrophe de l’amour, a fortiori dans une société où celui-ci, érigé en mythe intemporel et en valeur ultime, devient une injonction ?
Telle est la question au cœur de l’essai. Présenté comme un « processus » (p. 12), le désamour y est décortiqué en diverses étapes et émotions, illustrées par des scènes tirées de la littérature (Belle du Seigneur d’Albert Cohen), du cinéma (Anatomie d’une chute de Justine Triet), des sciences humaines (Marée basse, marée haute de Jean-Bertrand Pontalis) ou de la vie personnelle de l’autrice, pour élaborer depuis une approche sensible une « description phénoménologique » (p. 15). Ce geste philosophique participe en même temps d’une « clinique » (p. 193) de l’amour, sur lequel le désamour invite à faire retour, dans un retournement du négatif en positif à visée thérapeutique, éthique et politique. En effet, il ne s’agit pas seulement de survivre au désamour. Désaimer esquisse aussi « la possibilité d’une prise de conscience, d’une réflexion, d’une auto-introspection sur sa propre vie » (p. 126). Ce processus passe par la critique des mécanismes inoculés par l’idéal de l’amour-passion, ou le « “script Tristan et Yseut” » (p. 98), manipulé par la société marchande pour rendre la réalité acceptable. Dans son analyse socio-économique de l’amour au temps du libéralisme, Fabienne Brugère s’appuie ainsi sur les théories d’Eva Illouz sur le « capitalisme émotionnel » (p. 129), développées dans Les Sentiments du capitalisme (2006) ou La Fin de l’amour. Enquête sur un désarroi contemporain (2020). Désaimer, c’est aussi parvenir à « une éthique du désamour » (p. 197) qui repose sur « l’instauration d’une juste distance à l’égard du plaisir, de l’amour, du désir, du pouvoir » (p. 189) grâce à un souci de soi d’obédience stoïcienne, brandi comme bouclier contre la rupture d’identité ou la désintégration du moi que fait encourir la perte de l’amour. Désaimer, enfin, devient peut-être « la forme ultracontemporaine de l’émancipation, de la possibilité de se constituer comme sujet libre » (p. 181), en ce qu’il est l’occasion de « changer d’amour et même changer l’amour » (p. 18), geste que Fabienne Brugère considère comme politique, voire « révolutionnaire » (p. 212). En mettant au centre l’importance ducare comme souci de soi et soutien des autres pour survivre à l’amour, le désamour « vaut comme une déconstruction et inaugure une reconstruction par la transformation des relations à soi et aux autres » (p. 209). La métamorphose individuelle à laquelle il donne lieu prélude à une révolution collective : « changer d’amour », c’est « inaugurer une réflexivité du désir » permettant de « refuser (au moins de modérer) la mécanique patriarcale de l’amour » (p. 210) à travers d’autres systèmes amoureux et sexuels, tels qu’ont pu l’envisager Monique Wittig dans La Pensée Straight (1978) ou Michel Foucault dans L’Usage des plaisirs (1978).
Ce dernier point, à savoir l’horizon d’un alter-amour né du désamour, demeure à l’état embryonnaire dans Désaimer, qui en reste le plus souvent à des développements et à des exemples axés sur la sexualité hétéronormée. Signe que la révolution morale est encore « à écrire, et surtout à vivre, à expérimenter » (p. 212), Désaimer laisse ainsi de côté d’autres modalités amoureuses, relationnelles et sexuelles comme l’asexualité ou le polyamour, pourtant sous-tendues par un questionnement social, éthique et politique. Peut-être le choix méthodologique effectué par Fabienne Brugère a-t-il pesé sur l’inflation du modèle du couple : en décloisonnant le désamour, également appliqué aux êtres, aux pays ou aux idées pour rendre compte de l’expérience que l’on pourrait dire désamoureuse des exilés (Kurt Tucholsky, Stefan Zweig) ou des désenchantés, l’essai s’est peut-être paradoxalement refermé sur la dyade du soi et de l’autre en raison de son caractère fonctionnel. En effet, une telle extension terminologique, pour être tenable, a sans doute poussé à privilégier un modèle, le plus simple ou le plus transposable, plutôt qu’à envisager plusieurs configurations. En outre, à quelques exceptions près (comme l’œuvre de l’autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie), Désaimer reprend un imaginaire de l’amour largement occidental. S’il est sans doute un sentiment universel (et encore n’est-ce là qu’un présupposé), l’amour gagnerait à être davantage ressaisi dans une perspective interculturelle, plus sensible aux potentialités d’invention, de subversion et de révolution qu’il est susceptible de receler dans les cultures et imaginaires où il prend une place spécifique, car située.
Kathia Huynh - Configurations littéraires