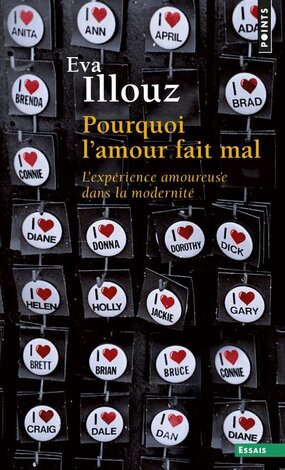Bridget Jones fut-elle plus malheureuse que Juliette Capulet ? La seconde a beau mettre fin à ses jours, quand la première noie son chagrin dans le Chardonnay, si on suit jusqu’au bout la thèse défendue dans cet ouvrage, c’est à la britannique héroïne d’Helen Fielding (qui inspira une adaptation cinématographique bien connue) que revient la palme des souffrances amoureuses. Consacré à la compréhension des affres sentimentaux contemporains, le présent essai postule en effet une insuffisance – ou à tout le moins un inachèvement - de la révolution sexuelle qui, « pressée d’écarter les tabous et de parvenir à l’égalité » entre hommes et femmes, aurait « laissé l’éthique à l’extérieur de la sexualité », avec de graves conséquences pour l’équilibre émotionnel, en particulier féminin. Sans prétendre donner la recette d’une sexualité éthique, à la fois libre et respectueuse de l’autre, Eva Illouz propose ici une réflexion fondée sur une double inflexion, disciplinaire et historique.
La première implique un changement de perspective sur l’amour, qui ne doit pas, selon l’auteur, demeurer l’apanage des psychologues, accusés de favoriser une perception myope et égocentrée de la problématique amoureuse : proposant de « traiter de l’amour comme Marx traita des marchandises », l’auteur affirme que « les échecs de nos vies privées ne sont pas – ou pas seulement – le résultat de psychés défaillantes, mais que les vicissitudes et les malheurs de nos vies amoureuses sont le produit de nos institutions ». La seconde inflexion consiste dès lors à identifier ce qu’on pourrait considérer comme une « révolution morale » dans la conception occidentale de l’amour : de fait, selon l’auteur, loin de constituer un sujet futile et anecdotique, « l’amour romantique hétérosexuel témoigne des deux plus importantes révolutions culturelles du xxe siècle : l’individualisation des manières de vivre et l’intensification des projets de vie affective d’une part, l’économicisation des rapports sociaux et l’omniprésence des modèles économiques dans la formation du moi et de ses émotions mêmes d’autre part ». Se fondant sur la lecture de plusieurs romans de Jane Austen (Le Cœur et la Raison, Emma, Orgueil et préjugés, L’Abbaye de Northanger, Persuasion) et, pour la période contemporaine, sur un corpus éclaté composé de quelques fragments littéraires (empruntés à des autrices telles qu’Helen Fielding ou Erica Jong) mais surtout d’un ensemble important de témoignages recueillis sur des forums ou lors des nombreux entretiens menés par l’auteur, l’essai entend mettre en évidence une métamorphose profonde de l’amour, qui aboutirait à une plus grande vulnérabilité du moi, rendu directement coupable de ses échecs et déconvenues sentimentales – et ce, bien sûr, avec l’appui scientifique de la psychanalyse et de la psychothérapie qui feraient de nous « les responsables intarissables, mais indéniables, de nos déboires amoureux ». Le triomphe de l’amour romantique consisterait en effet, selon Eva Illouz, à « désencastrer les choix amoureux individuels du tissu moral et social du groupe, et à faire émerger un marché de rencontres autorégulé », où chaque partenaire potentiel est jugé à l’aune de multiples critères, irréductibles au seul impératif ancien de l’endogamie (aisance sociale, éducation, etc.) et où les femmes se trouveraient structurellement désavantagées. L’auteure dépeint par conséquent une transformation décisive de « l’écologie du choix » (autrement dit de l’environnement social qui l’entoure) mais aussi de « l’architecture du choix » (autrement dit des mécanismes cognitifs et affectifs susceptibles de l’orienter). L’ultime chapitre de l’ouvrage (« Du fantasme romantique à la désillusion ») souligne à cet égard l’importance de l’imagination, présentée dans les termes d’Adorno comme une « véritable composante de la culture esthétique du capitalisme », dans nos représentations de l’amour : ainsi serions-nous « tous et toutes devenus des Emma Bovary, au sens où nos émotions sont profondément enchâssées dans des récits fictionnels » et « se développent dans des histoires et comme des histoires », influencées par la littérature, le cinéma et, plus récemment, par les nouvelles formes d’imagination (et de rencontres amoureuses) autorisées par Internet.
Qu’on nous permette cependant de revenir pour finir à l’inflexion disciplinaire qui conduit Eva Illouz à arracher le domaine amoureux aux psychologues pour en confier le soin aux sociologues, seuls à même de nous sauver des affres de la culpabilité en mettant en évidence les arcanes d’un véritable marché sexuel et sentimental : qu’en est-il, dans cette transaction, de la littérature, que l’essai se plaît à convoquer ? Est-elle porteuse, dans les termes de Martha Nussbaum, d’une « connaissance de l’amour » ? Une chose demeure certaine : la lecture d’Eva Illouz, qui prend d’ailleurs la précaution de préciser modestement que son approche « réductrice » « ignore la complexité » des textes, fait fi de la continuité historique et littéraire qui conduit par exemple Helen Fielding à proposer dans Le Journal de Bridget Jones une réécriture, somme toute assez fidèle, d’Orgueil et préjugés…