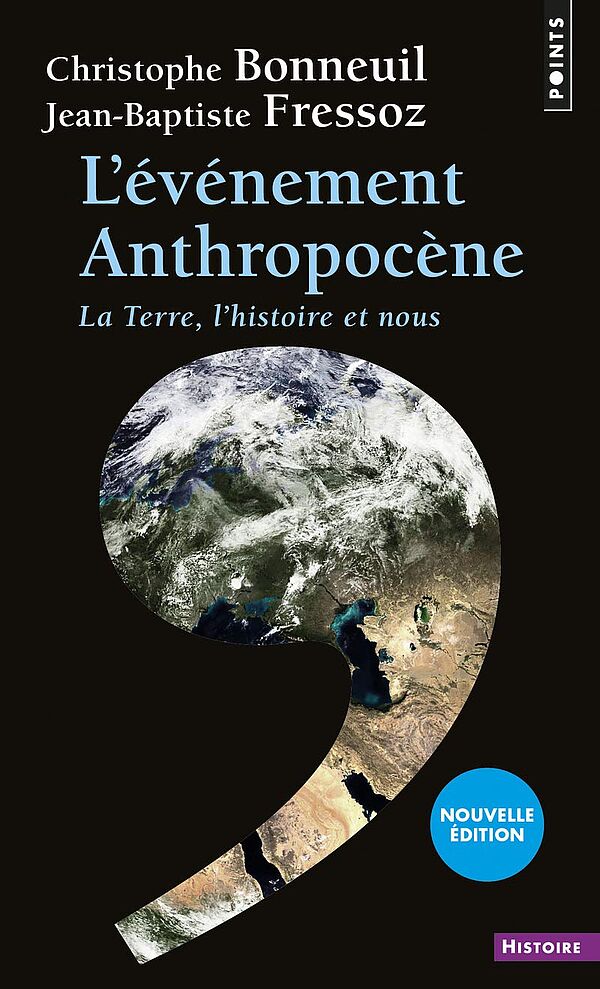Historiens des sciences et de l’environnement, qu’ils abordent à partir de leurs spécialités respectives – le développement des empires coloniaux, pour Christophe Bonneuil, et celui des techniques pour Jean-Baptiste Fressoz – les deux auteurs avaient, en 2013, inauguré la collection « Anthropocène » aux Éditions du Seuil avec cet ouvrage consacré à l’histoire de cette notion. À l’occasion de sa traduction anglaise et de sa réédition au format poche, leur livre fut révisé en profondeur et complété de deux nouveaux chapitres, afin d’intégrer les débats qu’il avait suscités : c’est cette version remaniée qui prévaut désormais, et s’est trouvée traduite en d’autres langues, comme le japonais en 2017 ou l’italien en 2018.
Les géologues, dans leurs histoires de la Terre, avaient pris l’habitude de qualifier les époques « récentes » – depuis le Quaternaire, qui vit l’apparition de l’homo habilis, il y a 2,6 millions d’années en Afrique – à partir de ce fait « nouveau » que constituait l’émergence de l’humanité au sein d’une profusion d’autres espèces vivantes. Après le « pleistocène », dont les étymons grecs (pleistos, superlatif de polus, pour « très nombreux », et kainos, pour « récent ») désignaient une période caractérisée par un très grand nombre de « fossiles identifiables à des espèces vivant actuellement », advint l’« holocène » qui, après la dernière glaciation, ouvrit voici 11500 ans un âge « entièrement nouveau » (holos & kainos), marqué par un climat tempéré particulièrement propice au développement de l’humanité. Mais cette dernière, depuis la fin du XVIIIe siècle et les révolutions industrielles qui firent suite à l’invention de la machine à vapeur par James Watt en 1784, a par ses actions tant altéré la composition des sols et de l’atmosphère qu’elle « rivalise désormais avec certaines des grandes forces de la nature en termes d’impact sur le système Terre » (p. 17-18). C’est ce phénomène sans précédent qu’on nomme « l’Anthropocène » – littéralement, la nouvelle période des humains ou « l’âge de l’humanité » dans son empreinte colossale sur l’environnement planétaire. Proposée en 2000 par Paul Crutzen (1933-2021), spécialiste néerlandais de l’atmosphère et prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la couche d’ozone, cette notion a permis de pointer les transformations majeures provoquées par les activités humaines. La combustion des résidus fossiles (charbon, pétrole, gaz) prélevés dans la lithosphère, combinée à l’accumulation d’autres gaz comme le méthane, le protoxyde d’azote ou les gaz fluorés, a en effet considérablement augmenté l’effet de serre de l’atmosphère terrestre (ou sa rétention de la chaleur reçue du Soleil), et partant fait aussi monter la température sur notre planète. Ce réchauffement climatique, qui atteint d’ores et déjà +1,1°C par rapport à la période pré-industrielle, et qui pourrait s’élever à +6 °C à la fin de notre siècle, ne fait qu’accélérer par ailleurs « la dégradation généralisée du tissu de la vie sur Terre (biosphère) » et « l’effondrement de la biodiversité, lié au mouvement général de simplification (par anthropisation agricole ou urbaine), fragmentation et destruction des écosystèmes du globe » (p. 20). L’Anthropocène se caractérise enfin par d’autres mutations majeures comme les transformations des cycles biogéochimiques (eau, azote et phosphate) et la surexploitation des ressources terrestres – nous consommons « annuellement une fois et demie ce que la planète peut fournir sur un mode durable » (p. 23).
Pour donner à comprendre cette nouvelle ère dans l’histoire de la Terre, Bonneuil et Fressoz s’attachent à montrer que l’Anthropocène n’est pas uniquement un événement géologique, mais avant tout la conséquence de choix politiques et économiques qui ont inscrit nos sociétés dans une trajectoire irréversible sur le plan climatique : nous ne pourrons pas revenir à la situation équilibrée de l’holocène, et pour nous préparer dès lors à vivre voire survivre dans ce qui constitue désormais notre « nouvelle condition » (p. 317), il convient de rompre avec certaines idées reçues – à commencer par la conviction que notre conscience de l’influence humaine sur le climat est nouvelle, ou que le salut nous viendra essentiellement de la science qui, après nous avoir précipités vers le gouffre, nous aurait enfin décillé les yeux.
Ce récit d’éveil est une fable. L’opposition entre un passé aveugle et un présent clairvoyant, outre qu’elle est historiquement fausse, dépolitise l’histoire longue de l’Anthropocène. Elle sert surtout à faire valoir notre propre excellence. Son côté rassérénant démobilise. Depuis vingt ans qu’elle a cours, on s’est beaucoup congratulé et la Terre s’est enfoncée toujours davantage dans les dérèglements écologiques.
Dans sa variante gestionnaire, la morale du récit officiel consiste à donner aux ingénieurs du système Terre les clés du « vaisseau Terre » ; dans sa variante philosophique et incantatoire, elle consiste à en appeler d’abord à une révolution morale et de pensée, qui seule permettrait de conclure un armistice entre humains et non-humains et une réconciliation de tous avec la Terre. (p. 13)
En disqualifiant ainsi la notion de révolution morale, Bonneuil et Fressoz ne cherchent pas à tant à éluder la contribution des arts et des littératures au développement d’une sensibilité écologique – il leur arrive ponctuellement, à cet égard, de citer des écrivains comme René Char (p. 113-114), Georges Pérec (p. 191) ou René Barjavel (p. 312) – qu’à « prendre au sérieux l’histoire et apprendre à travailler avec les sciences dures » (p. 13). Dans cette perspective interdisciplinaire, s’ils ambitionnent à leur tour de « forger de nouveaux récits et donc de nouveaux imaginaires pour l’Anthropocène » (ibid.), c’est plutôt en tirant plusieurs fils historiques et en multipliant les histoires, de 1780 à nos jours, qu’ils s’y emploient.
Les deux auteurs commencent d’abord par déconstruire le récit dominant de « “l’espèce humaine” forçant le “système Terre” (p. 318), en montrant que « d’un point de vue environnemental, l’humanité prise comme un tout n’existe pas ».
Un Américain moyen ne consomme-t-il pas 32 fois plus de ressources et d’énergie qu’un Kenyan moyen ? Un nouvel être humain naissant sur Terre n’aura-t-il pas une empreinte carbone mille fois plus élevée s’il naît d’une famille riche d’un pays riche que s’il naît d’une famille pauvre d’un pays pauvre ? Les Indiens Yanomani, qui chassent, pêchent et jardinent dans la forêt amazonienne en travaillant trois heures par jour sans aucune énergie fossile (et dont les jardins ont un rendement énergétique 9 fois supérieur aux terres des agriculteurs de la Beauce) doivent-ils se sentir responsables du changement climatique et de l’Anthropocène ? Un récent rapport montre que les 1% les plus riches de la planète accaparent 48% des richesses mondiales tandis que la moitié la plus pauvre de l’humanité doit se contenter de 1%. (p. 88-89)
L’Anthropocène se voit ensuite décliné dans ses divers aspects, et ses principaux visages sont exposés sans détour. Parce qu’il tire son origine d’un usage immodéré des résidus fossiles à des fins énergétiques, ce nouvel âge est d’abord un « Thermocène » (chapitre 5) ; puisque nombre des innovations industrielles et techniques l’ayant favorisé furent initiées à des fins militaires, il est également un « Thanatocène » (chapitre 6), l’histoire naturelle de la destruction de l’environnement étant coextensive aux arts nouveaux de faire la guerre développés par les puissances occidentales, à l’occasion des multiples conflits du XXe siècle. En engageant ensuite les sociétés humaines dans la voie d’un consumérisme effréné, l’Anthropocène s’est aussi révélé être un « Phagocène » (chapitre 7), et en sapant tour à tour les appels à la prudence (phronêsis en grec) ainsi que les alertes culturelles et sociales récurrentes, à compter du XIXe siècle, contre les désastres écologiques en cours, il s’est progressivement mué en « Phronocène » (chapitre 8) et en « Agnotocène » (chapitre 9), privilégiant toujours l’ignorance au savoir. Mais son essor reste en définitive fondamentalement lié à celui de l’impérialisme et du capitalisme : produit en cela d’un « long processus historique de mise en relation économique du monde, d’exploitation des hommes et du globe, remontant au XVIe siècle et qui a rendu possible l’industrialisation » (p. 254), l’Anthropocène reste avant tout un « Capitalocène » (chapitre 9) voire un « Anglocène » (p. 137), la Grande-Bretagne et les États-Unis représentant à eux seuls plus de 50 % des émissions de CO2 depuis 1900 (ibid.), tandis qu’au moment du premier choc pétrolier, en 1973, l’empreinte britannique atteignait alors 377% de la biocapacité de son territoire, et l’américaine près de 180 % (p. 276). Après avoir ainsi démontré sans détour l’incroyable « endettement écologique des pays industriels occidentaux », dont le « modèle insoutenable de développement » et les « émissions massives de polluants et de gaz à effet de serre reviennent au bout du compte à s’approprier les fonctionnements écosystémiques réparateurs du reste du monde pour leur compte » (p. 276-277), les deux historiens analysent, dans un ultime chapitre, les multiples contestations et résistances à l’industrialisme et aux dégradations croissantes de l’environnement qui firent de l’émergence de l’Anthropocène un constant « Polémocène » (chapitre 11). Mais à dire vrai, ce constat final constituait surtout l’un des fils rouges de l’ouvrage, dont chaque chapitre s’évertuait à souligner la contingence des choix économiques, géopolitiques et technologiques qui furent alors faits en termes d’énergie, de transport, d’exploitation des sols et de leurs ressources agricoles, forestières ou minières. Contrairement à l’idéologie imposée avec le triomphe du néolibéralisme, des alternatives étaient donc possibles, et beaucoup, moins couteuses en termes énergétiques, et bien moins néfastes en termes environnementaux ou sanitaires, furent d’ailleurs expérimentées avant d’être systématiquement contrariées et supprimées au bénéfice des industries fossiles et chimiques qui dominent encore aujourd’hui. L’ouvrage explore ainsi les manières anciennes de faire cas de l’environnement, autant que les redoutables stratégies d’occultation d’autres voies qui furent mises en œuvre selon une dialectique du secret sur laquelle les deux auteurs s’emploient à rétablir toute la transparence historique possible. En définitive, concluent-ils,
L’un des aspects déterminants dans l’histoire de l’Anthropocène fut la capacité à rendre politiquement inoffensives les dégradations et les critiques. L’histoire de l’Anthropocène est celle des désinhibitions qui normalisèrent l’insoutenable : […] on peut au contraire la penser comme une somme de petits coups de force, de situations imposées, d’exceptions normalisées. Plutôt que d’incriminer des monstres sacrés (le cadeau biologique de l’intelligence fait à Homo sapiens et mal utilisé, le fatum démographique, la posture judéo-chrétienne de domination de la nature, la “modernité” aveugle, séparatrice et dominatrice) trop énormes pour être infléchis, n’avons-nous pas beaucoup à apprendre de toutes ces tactiques et dispositifs de désinhibition qui ont permis depuis deux siècles et demi de passer outre aux savoirs et aux alertes environnementales successives et de défaire les contestations et alternatives opposées à l’agir industriel et consumériste ? (p. 320)
Tout en reconnaissant l’impression « déprimante » que peut produire la lecture de leur récit (« C’est en connaissance de cause que nos ancêtres ont déstabilisé les écosystèmes et la Terre »), Bonneuil et Fressoz ne s’en déclarent pas moins confiants dans nos capacités à « reprendre politiquement la main sur des institutions, des oligarchies, des systèmes symboliques et matériels puissants qui ont fait basculer dans l’Anthropocène : les appareils militaires, le système de désir consumériste et son infrastructure, les écarts de revenus et de richesses, les majors énergétiques et les intérêts financiers de la mondialisation » (ibid.). Vaste programme, pour lequel ils en appellent à d’autres récits historiques, à partir notamment des cultures non-occidentales ou de « l’expérience des subalternes et des victimes » (p. 318). Mais force est de constater qu’à l’issue de remarquables analyses, leur argumentaire tourne ici un peu court et, confinant davantage au vœu pieux qu’à un véritable programme politique et critique, verse peut-être, à son tour, dans un certain air du temps.
Anthony Mangeon - Configurations littéraires