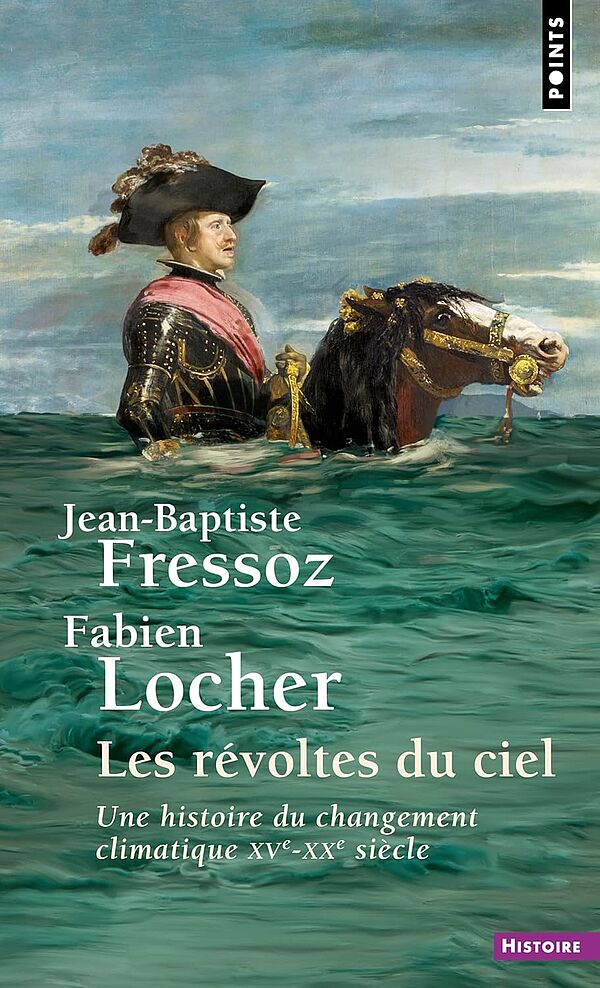Après L’Événement anthropocène, corédigé avec Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz s’associe à un autre historien de l’environnement, Fabien Locher, pour signer un nouveau livre à quatre mains. Titre et sous-titre sont toutefois quelque peu trompeurs : « les révoltes du ciel » induit en effet l’idée d’une réaction météorologique, mise en lien avec un changement climatique qui aurait commencé bien avant les débuts de l’anthropocène, vers le XVe siècle. Il n’est en réalité jamais vraiment question d’une révolte effective dans cet ouvrage, mais plutôt d’une préoccupation ancienne pour le climat et ses variations, qui virait souvent à l’effroi : et si la nature se révoltait finalement contre les altérations que lui imposent les êtres humains ?
C’est ainsi que les auteurs pourfendent deux idées fausses encore trop largement répandues aujourd’hui : la première voudrait que l’évolution du climat soit une inquiétude récente, et la seconde considère que « l’agir humain » est finalement sans grande incidence sur ce changement lui-même. Tout au contraire ! Soumis à une « séquence froide » (le « petit âge glaciaire », qui dura approximativement du XIVe siècle à la fin du XIXe), nos ancêtres se souciaient beaucoup des phénomènes naturels (pluies, vents, gels, sécheresses…) qui affectaient leurs vies, et notamment leurs récoltes, et ils prêtaient volontiers à l’humanité une influence, néfaste ou positive, sur le climat. Ils ne s’inquiétaient certes pas tant du réchauffement que du refroidissement de la Terre, et si l’atmosphère dans sa composition et son « effet de serre » était, jusqu’au XIXe siècle, moins prise en compte que la nature des sols et le couvert végétal de la planète, dont la déforestation constituait alors une fréquente hantise, les effets volontaires ou involontaires de leurs activités sur les équilibres de la nature, en particulier le cycle de l’eau, constituaient néanmoins un enjeu majeur pour les sociétés européennes, de leurs hommes politiques à leurs savants en passant par leurs paysans et leurs religieux.
Après avoir exposé en introduction les dix thèses qui motivèrent l’écriture de leur essai, et dont je n’ai mentionné jusque-là que les deux plus importantes, les deux auteurs livrent une histoire au long cours et à une échelle globale qui n’est pas sans offrir quelques surprises. Lectrices et lecteurs découvrent ainsi, au fil des chapitres, comment la capacité humaine à agir sur le climat fut précisément l’une des justifications de l’expansion impériale européenne :
Dès la « découverte » de l’Amérique, l’idée s’impose que la colonisation est aussi une normalisation climatique, une manière d’améliorer le climat du continent par le défrichement et la mise en culture. C’est une promesse pour les colons, et un discours de domination : une façon de dire que les Indiens n’ont jamais vraiment possédé le Nouveau Monde. Au XVIIIe siècle, l’agir climatique sert à hiérarchiser les sociétés et leurs trajectoires historiques : peuples amérindiens restés dans l’enfance d’un climat sauvage, peuples européens producteurs du doux climat de leur continent, peuples orientaux destructeurs. Le Maghreb, l’Inde, et plus tard l’Afrique noire : aux XIXe et XXe siècles, les Empires français et britanniques s’édifient en accusant le Noir et l’Arabe, l’islam, le nomadisme et la mentalité primitive, d’avoir dégradé les climats. La colonisation se pense et se donne à voir comme une entreprise de restauration de la Nature. L’homme blanc doit réparer les pluies, adoucir les saisons, faire reculer le désert – et pour cela commander aux indigènes. (p. 12-13)
Un autre fil conducteur de l’ouvrage est ainsi l’étroite corrélation entre visées politiques (voire géopolitiques) et considérations climatologiques : l’accusation de dégradation de l’environnement portée contre les peuples colonisés pouvait être également orientée par les dirigeants vers de précédentes élites. Provoquée entre autres par une « météorologie épouvantable » qui engendra, entre 1788 et 1789, des pénuries de grain et des émeutes frumentaires, « la Révolution française fut aussi une révolution climatique » (p. 105) contre un système féodal soupçonné d’avoir déréglé et « dégradé à la fois le climat et le peuple de la France » (p. 107) à force de convoitise – privatisation des espaces forestiers et des cours d’eau par les seigneurs – et d’incurie – déboisement excessif et multiplication des eaux stagnantes. Mais cette argumentation climatique se retournait parfois au gré des changements de régime, car la Révolution française, qui avait opéré « le basculement fondamental de l’optimisme colonisateur à l’angoisse de l’effondrement environnemental » (p. 123) fut à son tour dénoncée, d’abord sous l’Empire napoléonien, puis avec la Restauration, pour sa gestion calamiteuse des sols, des eaux et des forêts.
Tout aussi méconnue est l’existence de « patriotismes climatiques » (chapitre VII), liés à l’idée de « climats nationaux » (de l’Angleterre, des États-Unis, de la France…) et au développement de modèles spécifiques de construction étatique et d’aménagement du territoire, avec des obsessions propres qui infléchissent les politiques globales au fur et à mesure que les rapports de force géopolitiques se transforment au cours du XXe siècle. Ainsi les Français lancent-ils, en 1821, la première enquête d’envergure sur le changement climatique (chapitre XI), tandis que les Américains traumatisés, un siècle plus tard, par l’épisode des tempêtes de poussière (dust bowls) qui touchèrent les grandes plaines dans les années 1920-1930, se préoccupent surtout de l’érosion des sols dont ils font une préoccupation majeure des Nations-Unies après la Seconde Guerre mondiale, tout en s’inquiétant sur le plan climatique de la possibilité d’un « hiver nucléaire » qui pourrait découler d’un conflit atomique.
Mais le dernier constat saisissant est celui d’un point de bascule historique au moment même où nous entrons dans l’anthropocène. L’obsession pour l’agir anthropique sur le climat qui avait été celle de multiples générations cesse d’en être une, alors même que cette influence devient plus prégnante que jamais. Cette indifférence au changement climatique provoquée par l’humanité a bien évidemment ses causes historiques : grâce au développement de l’industrie, des énergies fossiles, et des moyens modernes de transport et de communication, nos sociétés contemporaines deviennent beaucoup plus résilientes face aux aléas du ciel. Le bois cède la préséance au charbon comme moyen de chauffage, et à l’acier et au ciment pour la construction ; les réseaux ferroviaires et maritimes favorisent la globalisation agricole et la circulation des denrées alimentaires ; les évolutions du climat perdent dès lors « de leur charge d’angoisse, de leur intensité politique » (p. 18). S’ouvre ainsi une parenthèse historique dont nous ne sommes malheureusement pas encore sortis, durant laquelle ce qui avait été un souci majeur des sociétés humaines, notamment européennes, a cessé durant quelques décennies de nous préoccuper.
Si le réchauffement global a été et reste un choc pour les consciences, c’est parce que depuis le début du XXe siècle la civilisation industrielle et la science nous ont inculqué deux idées confortables mais fausses. D’une part, que l’agir humain ne saurait perturber le climat, de l’autre, que les sociétés riches n’avaient, pour l’essentiel, plus rien à craindre de ces soubresauts. Notre sidération face à la crise existentielle du réchauffement tient largement à ces illusions rassurantes d’un climat à la fois inébranlable et inoffensif. (p. 311)
À la lecture de ce dégrisant ouvrage, une révolution morale et une conclusion philosophique s’imposent : nous ne pourrons plus longtemps rester « insensibles à la menace d’un changement climatique anthropique » (p. 18) et pour cela, comme l’expliquait Héraclite d’Éphèse, « il ne faut pas agir et penser comme les enfants de nos parents ».
Anthony Mangeon - Configurations littéraires