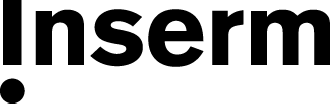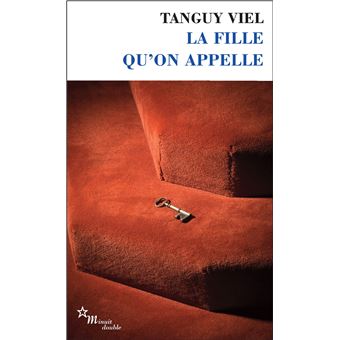La Fille qu’on appelle ou, dans l’original, call girl : on retrouve dans ce jeu de mot initial l’américanophilie de l’écrivain Tanguy Viel, célèbre pour ses romans marqués par le genre du polar comme par les films noirs hollywoodiens, de L’Absolue perfection du crime (2001) à La Disparition de Jim Sullivan (2013). Pourtant, ce texte de 2021 constitue à de nombreux égards une nouvelle veine dans l’œuvre de celui qui apparaissait jusque-là comme un parfait « auteur de Minuit », du nom de la maison d’édition qui le publie depuis ses débuts et qui est célèbre pour favoriser l’expérimentation littéraire, l’humour et la réflexivité.
Dans La Fille qu’on appelle, l’habituel narrateur plus ou moins facétieux des récits de Viel s’estompe : il s’agit d’un de ses rares textes racontés à la troisième personne, ce qui permet de se concentrer sur deux héros cabossés, Max Le Corre et sa fille Laura. Tous deux sont des personnages sur le retour : Max a été une gloire de la boxe, avant de se reconvertir en chauffeur du maire d’une petite ville bretonne bien sous tous rapports, avec sa plage et son casino. Laura a entamé une carrière de mannequin et réalisé notamment une publicité dénudée, dont certains murs de la ville portent encore la trace : revenue chez elle, elle cherche un logement et un coup de pouce. Max Le Corre se tourne tout naturellement vers son patron, qui dirige la petite ville avec autorité et paternalisme, pour lui demander de l’aide. Mais le maire a d’autres projets pour Laura : il fait d’elle une « fille qu’on appelle », sans jamais lui rendre les services dont elle a besoin, avant de rompre quand lui-même est appelé à Paris par une charge de ministre. Prolongeant l’exploration de l’abus de confiance déjà entamée dans Article 353 du Code pénal (2017), le roman raconte la mise en place de l’implacable machine qui permet à un homme d’imposer son pouvoir à deux autres êtres, de les assujettir à sa volonté et à ses désirs, et de toujours pouvoir s’échapper sans être poursuivi lui-même.
L’histoire est, dit Tanguy Viel, inspirée par une double actualité, celle de la multiplication des témoignages tragiques de victimes d’emprises qui opacifient la compréhension ordinaire de la notion de consentement et celle des frasques d’hommes puissants qui parviennent à se maintenir au pouvoir parce que leurs victimes ne sont jamais de « bonnes victimes ». Cette atmosphère littéraire et médiatique pèse sur le récit, qui prend un tour apparemment très sociologique, ancré dans une réalité géographique précise et confrontant les faibles et les forts, les générations et les sexes. Mais elle pose aussi la question de la pertinence éthique du geste littéraire effectué par l’auteur : certains pourraient se demander si, au sein de ce lourd contexte, il reste vraiment une place pour la fiction, et en particulier une fiction écrite par un homme, qui plus est par un écrivain qui semblait jusque là peu préoccupé de décrire le champ social et les débats contemporains.
Politique, La Fille qu’on appelle ne l’est pas, et ne veut pas l’être. Le romancier a récemment contribué à repenser les rapports entre littérature, réflexion et action politiques dans un volume collectif d’auteurs qui défaisaient l’apparente naturalité de ces liens : au-delà de cette naturalité, c’est l’ancillarité de la littérature par rapport au politique que critique Viel dans son essai de Contre la littérature politique, comme si la fiction et le style trouvaient leur légitimité uniquement par la vertu de ce qu’ils permettent de dénoncer. Dans son roman, cette contestation prend la forme d’une mise en scène du pouvoir restaurateur du récit, susceptible de combler les failles de la justice ou les insuffisances du jugement moral, non par ce qu’il raconte, mais grâce à la manière dont il le fait. Le récit n’entretient jamais l’espoir que va s’inverser le rapport de force effectif qui entrelace le destin des personnages – la réparation qu’obtient Laura peut apparaître bien maigre, puisqu’il n’y a que son père pour considérer que c’est grave et aller casser la figure à son « protecteur ». En revanche, s’il ne peut pas défaire l’histoire, le récit de Viel travaille à infléchir le regard, à provoquer une attention. L’inhabituel effacement du narrateur de Viel et le passage au récit à la troisième personne se font au profit de ces figures qui sont en tous points des subalternes dans la vie de l’édile prédateur et manipulateur. Loin de tomber dans l’exercice formel, le style permet ici de s’arrêter sur eux et d’incarner leurs espoirs et leurs déceptions à travers des images concrètes et parfois mythologiques : il donne ainsi corps à des personnages (les Le Corre) pour lesquels la messe semble être dite depuis longtemps, de même que l’intrigue de nature sexuelle matérialisait dans l’interaction des corps le lien de sujétion.
La littérature n’existe pas ici pour délivrer un message politique, pour contribuer à une action concrète, ou ne serait-ce pour s’indigner de la faible prise en charge des victimes ou de la rapidité de leur condamnation par le qu’en-dira-t-on : elle met le lecteur en situation d’écoute, semblable à celle du juge d’Article 353 du code pénal, qui entendait toute la nuit un prévenu confessant le meurtre d’un puissant qui lui avait tout pris, pour mieux le libérer au matin au nom de l’« intime conviction ».Le drame que raconte Viel n’est pas seulement celui d’une jeune fille abusée : c’est celui d’une parole qui n’est pas entendue, celle de la déposition inutile que Laura effectue auprès des policiers de la ville, ceux-là mêmes qui répondent à l’autorité du maire. Viel livre le récit appuyé de cette déposition pour rien, qui lance le récit sur une fausse piste, celle d’une intrigue judiciaire : c’est son propre récit qui suppléera à l’absence de la justice des hommes, en lui substituant une justice des mots – et au premier chef en donnant un prénom et une existence intérieure à « la fille qu’on appelle ».
Victoire Feuillebois - GEO