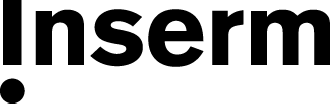En 2006, la militante américaine Tarana Burke donne à son association contre les violences sexuelles le nom de « Me Too ». Le 15 octobre 2017, alors qu'éclate dans les médias l’affaire Weinstein, producteur de cinéma américain accusé de multiples agressions et viols, l’actrice et productrice étatsunienne Alyssa Milano écrit les mots suivants sur le réseau social Twitter : « If you’ve been sexually harassed or assaulted write “me too” as a reply to this tweet. » [Si vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, écrivez « moi aussi » en réponse à ce tweet]. Avec près de 800 000 tweets en 24 heures, l’expression devient virale. Transformée en hashtag, elle est depuis lors un slogan de ralliement pour les victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS). Deux jours plus tôt en 2017, la journaliste française Sandra Muller avait lancé sur les réseaux les mots de ralliement : #BalanceTonPorc, également en réponse aux discussions autour de Weinstein et de l’accusation du patron de la chaîne française Equidia. La formule utilisée sur les réseaux sociaux français fait néanmoins polémique : le « porc » désigne l’abuseur et le violeur, mais suscite des accusations de « stigmatisation de la gent masculine assimilant tous ses représentants à d’ignobles bêtes » (Froidevaux-Metterie, 2020), et #MeToo reste aujourd’hui majoritairement utilisé comme mot de ralliement. Les témoignages sont très nombreux et inondent le discours sur les réseaux sociaux, devenant rapidement un sujet médiatique incontournable ; les accusés sont rarement nommés, mais les faits sont détaillés, confirmés par d’autres, dans tous les milieux professionnels et sociaux, montrant le caractère systémique et global des VSS.
Un mouvement féministe
#MeToo est d'abord un enjeu de transparence et de secret : la prise de parole publique par une poignée de personnes encourage la parole de nombreuses autres. Une spirale vertueuse s’enclenche : l'augmentation du nombre de témoignages renforce alors de nouvelles prises de parole. Des rapports de force s'établissent entre la parole des unes et l'omerta de la société. La fin du tabou de la condition de victime se traduit par l’un des mots d’ordre du mouvement : « la honte change de camp », retournée vers les agresseurs (la pratique militante du shaming - l’humiliation - consiste à nommer publiquement l’agresseur). Les dénonciations publiques veulent rendre visible la fréquence de ces violences qui interviennent dans tous les milieux, protéger les autres victimes potentielles et encourager leur prise de parole, afin d’éventuellement lancer une procédure judiciaire et / ou obtenir un soutien de la part des pairs voire une réparation morale. La dénonciation des VSS dans les milieux professionnels, culturels, politiques et associatifs met au jour les relations hiérarchiques qui favorisent la dissimulation de la violence : l’agresseur Weinstein a été protégé par le milieu du cinéma hollywoodien car il était à la tête d’un studio de production puissant et ses victimes étaient de jeunes femmes au début de leur carrière. #MeToo a également mis en lumière la fréquence des VSS dans les milieux familiaux et amicaux : les féminicides sont régulièrement relevés par les associations, la prise de conscience de la réalité du viol conjugal augmente, l’inceste et les violences faites aux enfants prennent une place grandissante dans le discours, avec notamment la médiatisation des rapports de la Civiise en France, les plans de lutte lancés par le gouvernement (avec une efficacité très relative), et le soutien d’une partie du corps politique aux engagements de Lyes Louffok pour la protection de l’enfance.
De ce fait, #MeToo engendre une révolution morale en raison de l’extrême rapidité du changement de regard sur ce qu’on ne qualifiait pas toujours de violences auparavant, mais de mœurs qui feraient partie de la sphère privée (le principe du « devoir conjugal », l’idée que la chambre à coucher ne concerne personne d’autre) ou d’actions qui relèveraient d’une « nature masculine » (les hommes auraient des besoins primaires contre lesquels ils ne pourraient lutter). L’idéologie patriarcale, jusqu’ici dominante, crée, nourrit et enrichit une culture du viol, c’est-à-dire les comportements qui minimisent, banalisent ou encouragent les violences sexuelles (Valérie Rey-Robert, 2020). Elle laisse son agresseur profiter d’une impunité totale et rend la victime responsable de son agression, ce qui se traduit dans les champs littéraires et artistiques par certains discours, procédés et représentations qui convergent pour ignorer ou excuser les VSS (dans la littérature : euphémisation ou ironie, récit construit autour du point de vue de l’agresseur, plan cadré déshumanisant la victime, etc. ; au cinéma : violence montrée du point de vue de l’agresseur qui provoque une empathie avec lui mais ignore l’expérience de la victime, déformation du point de vue de la victime, scènes qui visent à excuser ou justifier une agression). Les conséquences de #MeToo ont donc été majeures, puisque le mouvement a autant permis de pointer du doigt une discrimination sexiste que de réinterroger la notion de consentement, et partant de montrer les violences et abus normalisés en contexte patriarcal. #MeToo a donc incité la société à se focaliser sur la deuxième participante de la relation et son consentement.
Si cette révolution morale a rapidement pris de l’ampleur, c’est aussi parce que le terrain a été préparé depuis les années 1970 par les mouvements féministes de l’époque, qui ont formulé et théorisé ces questions de la sexualité, de la violence, du travail et du pouvoir. L'analyse féministe des VSS montre que ces violences sont issues de la structure des rapports sociaux de sexe, et non le fait de comportements individuels. #MeToo soutient une prise de conscience générale des VSS et de leur fonctionnement, la volonté d’une meilleure éducation et d’une prise de responsabilité générale, et la nécessité de réformes ou lois pour une meilleure prise en charge. En France, quelques résultats législatifs sont déjà apparus, par exemple la promulgation d’une loi en 2018 visant à allonger le délai de prescription des violences sexuelles, ou d’une loi en 2021 visant à mieux protéger les mineurs des crimes sexuels et de l’inceste, à la suite du mouvement #MeTooInceste. Début 2025, une proposition de loi est déposée pour inscrire le non-consentement dans le Code pénal, nécessité débattue par les féministes sur le plan philosophique, juridique et militant.
L’anthropologue et psychiatre Claire Mestre et la psychiatre Marie Rose Moro notent que le langage n’est pas toujours la première réaction ; sur le continent africain entre autres, des femmes choisissent de partir : « Elles disent #MeToo avec leurs pieds, elles forment les bataillons des migrations contemporaines, sûres de ne pouvoir être défendues et entendues dans leurs contrées et gonflées d’espoir d’être protégées en Europe » (2018).
#MeToo est bien un mouvement féministe, un jalon intellectuel et culturel qui contribue à visibiliser et structurer les féminismes contemporains, et provoque un changement d’idées dans les domaines théoriques, politiques et culturels. Il contribue à une prise de conscience des enjeux linguistiques, artistiques, littéraires des VSS et touche, entre autres, à la littérature et aux arts. Il fonctionne également comme un mouvement féministe en raison du retour de bâton qu’il a immédiatement subi : le backlash, théorisé par la journaliste et militante Susan Faludi en 1981 dans l’essai éponyme, désigne le discours antiféministe mis en place pour freiner toute révolution morale et empêcher la conservation des acquis sociaux et moraux. S. Faludi relève un effet systématique, commun aux États-Unis dans les années 1980, à l’Angleterre du début du XXe siècle (où les revendications pour le droit de vote des femmes mènent à un virulent combat médiatique et à un retour des idées conservatrices), ou encore à l’Argentine sous Javier Milei à partir de 2023. En France, dans les années 2020, le discours conservateur anti-MeToo est porté par une idéologie antiféministe, et se retrouve surtout dans les milieux politiques de droite et d’extrême droite (la classe politique n’a pas pris acte de ce changement dans son ensemble, comme le montre le soutien du président de la République envers Gérard Depardieu ou Gérald Darmanin ; d’autre part se lève une vague éditoriale de textes antiféministes comme les ouvrages de la polémiste Caroline Fourest), et il devient un argument rassembleur autour de la régression des droits. Le backlash se révèle aussi dans les sphères culturelles, de manière plus insidieuse : cinéma, musique, littérature, mode, publicité, soutiennent en partie le même agenda politique en diffusant des réactions conservatrices pour diminuer l’impact de la révolution morale et empêcher la continuation du progrès et des droits acquis.
#MeToo dans la littérature et les arts
Dans la littérature, les débats éthiques sont fréquents quant au contenu des livres et notamment à la représentation des VSS (l’émergence du métier de sensitivity reader ou démineur littéraire étant un signe fort de cette nouvelle attention). Certaines œuvres anciennes ou récentes peuvent être retirées de la vente, on interroge la possibilité d’une séparation ou dissociation entre l’œuvre et l’artiste, ou ce que fait #MeToo à la littérature (M.-J. Zenetti, 2022). Mettre des mots sur des réalités auparavant non reconnues (reconnaissance du viol, par exemple), donc de nouveaux objets et enjeux, nécessite de nouvelles pratiques de lecture et de critique, et de nouveaux modèles interprétatifs. Cela incite la critique littéraire à s’enrichir et dépasser l’opposition théorique intenable entre deux pôles fictifs d’une lecture littéraire (purement esthétique) et une lecture référentielle (refusant de distinguer la morale de l’œuvre), comme le formule Marie-Jeanne Zenetti dans l’article cité plus haut.
Au cinéma, le coordinateur d’intimité, là aussi nouveau métier, signale une prise de conscience de la vulnérabilité de la position des acteurices dans leur métier face aux exigences des réalisateurs et producteurs. Cependant l’affaire Weinstein n’a pas fondamentalement renversé le fonctionnement de ce milieu international : des réalisateurs et acteurs accusés et condamnés continuent leur carrière (R. Polanski, J. Depp). Une tribune de personnalités du cinéma français revendique en 2018 la « liberté d’importuner » des hommes, où les accusations portées sur les agresseurs semblent plus choquantes que les viols subis par les victimes. La prise de parole d’Adèle Haenel s’est suivie de son retrait du cinéma français pour se tourner vers le théâtre, en raison du manque de soutien des membres de sa communauté artistique d’origine. Des polémiques régulières ont lieu dans des institutions culturelles telles que la Cinémathèque française, dont les choix de projection font débat (notamment critiqués par l’actrice et réalisatrice Judith Godrèche, elle-même ayant dénoncé les violences qu’elle a subies) ; mais d’autres structures comme le Forum des Images choisissent de mettre en valeur d'autres approches du cinéma. Plus récemment, le livre de Geneviève Sellier Le Culte de l’auteur a été violemment reçu par la critique cinéphile française, livre qui suit pourtant trente années de publications scientifiques, et de contributions régulières sur les sites Le genre et l’écran et Les mots sont importants par cette spécialiste de l'étude des représentations des rapports sociaux de sexe au cinéma.
Au théâtre, les prises de parole françaises ont été rassemblées dans l’ouvrage #MeTooThéâtre (Libertalia, 2022) qui annonce en quatrième de couverture : « Nous sommes légion à subir et à vouloir dénoncer la sexualisation constante de nos corps, l’écrasante dominance de la présence des hommes aux commandes et en possession des moyens de production, l’entretien de cette chimère qu’est la zone grise [...] ». Dans le milieu de l’art contemporain, l’affaire Claude Lévêque (artiste plasticien accusé de pédocriminalité) a immédiatement donné lieu à une tribune en sa défense, mettant en cause la parole des victimes. Le compte Instagram @metoo.artcontemporain publie quotidiennement des récits de violences sexistes, sexuelles et racistes, montrant que rien n’a fondamentalement changé. Le milieu de la photographie a été secoué par les accusations portées envers David Hamilton, ouvrant un nouveau regard sur sa pratique artistique, sulfureuse pour les uns, abjecte pour les autres.
Plus généralement, les victimes, témoins et soutiens s’organisent en annonçant publiquement les lieux et conditions de travail favorisant les agresseurs. Si les initiatives législatives, disciplinaires et morales semblent augmenter, il semble aussi qu’il soit encore tôt pour évaluer la portée du mouvement et remarquer des changements structurels profonds et positifs, en France comme ailleurs, notamment en raison des backlashs sur des affaires ponctuelles et d’un certain discours de contre-réalité des VSS, discours qui tend à les masquer ou les minimiser (N. Trovato, “La tentative de construction d’une contre-réalité des violences sexuelles en France : l’échec discursif du mouvement #MeToo ?”, 2022), ainsi que de l’absence de politique nationale efficace de lutte contre les VSS. Comme le remarque Noémie Trovato, le discours #MeToo est un discours partiellement agissant, qui a engendré une prise de conscience, mais les VSS ne sont pas encore réellement examinées en tant que problème systémique ni contrées par des actions efficaces. Le décalage entre le discours et les pratiques est encore bien réel ; la révolution morale a eu lieu dans les conceptions morales, mais pas les mœurs. #MeToo est un vecteur de clivage, car tout le monde reconnaît le changement, mais il n’est pas appliqué (la parole des victimes est remise en question, on les accuse d’être elles aussi coupables, on trouve des excuses aux agresseurs) : la révolution est donc toujours en mouvement.
#MeToo, ses variations et ses « angles morts »
Si #MeToo n’est que partiellement agissant, l’universalité des VSS a en revanche rapidement rendu le mouvement planétaire, et cela alors même que, note l’anthropologue française Véronique Nahoum-Grappe, il serait né « dans le monde social des femmes éduquées, urbanisées et qui évoluent dans des sphères sociales “brillantes” » (Nahoum-Grappe, 2018). La prise de parole a en effet tendance à se diffuser. Bien que les médias relèvent principalement les témoignages de femmes célèbres, bourgeoises et blanches, #MeToo a en réalité brisé les frontières géographiques en tirant parti du mode de communication international des réseaux sociaux, et il se traduit en parallèle localement et sous différentes formes. En 2018, le Japon voit ainsi apparaître #WeTooJapan. Depuis 2021, au Venezuela, #YoSiTeCreo (Je te crois) se développe, et les témoignages s’accumulent. On peut encore relever le #EnaZeda (Moi aussi) des Tunisiennes, le #QuellaVoltaChe (Cette fois où) italien, le #SeAcabó (C’est fini) espagnol, ainsi que les hashtags français #SciencesPorcs, qui reprend #BalanceTonPorc et permet aux étudiantes des IEP de témoigner, #BalanceTonProf, #BalanceTonGyneco, #ChurchToo, #MeTooMedia, #MeTooHopital, ou encore #MeTooGay, #MeTooLesbien et #MeTooTrans. Le mouvement n’est ainsi pas réservé seulement aux femmes hétérosexuelles cisgenres, prouvant s’il fallait encore le faire que les VSS sont subies par une majeure partie de la population, des groupes sociaux infériorisés.
Le mouvement connaît bien sûr des limites, car toutes les victimes ne témoignent pas, et leurs raisons sont multiples : le tabou de la sexualité, le continuum qui existe dans certaines cultures entre sexualité et violence qui empêche de mettre des mots sur les faits, la crainte de se lancer dans des procédures judiciaires, les pressions familiales et professionnelles ou les menaces qui pourraient en résulter, le réveil potentiel d'un traumatisme par la parole, l'amnésie, la peur de ne pas être crue ou la honte de n'avoir pu se défendre. De plus, les priorités féministes s’expriment de manière variable en fonction des différents pays. Claire Mestre, qui se trouvait au Tchad au moment de la naissance de #MeToo, remarque que « [l]es priorités des unes ne sont pas celles des autres » (2018). La chercheuse et militante québécoise Kharoll-Ann Souffrant parle quant à elle du Privilège de dénoncer (Remue-ménage, 2022) pour signifier que les femmes afrodescendantes sont absentes du débat public sur les VSS, et que leur parole est invisibilisée à la fois par le patriarcat et par le féminisme bourgeois libéral blanc. Souffrant mentionne ainsi les « angles morts » (2023) qui heurtent les femmes racisées, et elle rappelle qu’avant les actrices hollywoodiennes, des femmes noires avaient parlé, parmi lesquelles Anita Hill (juriste américaine qui accuse de harcèlement sexuel un juge de la Cour Suprême étatsunienne) et Nafissatou Diallo (femme de chambre qui accuse de viol un homme politique français). C’est alors la question de la légitimité du témoignage qui semble se poser. Sur ce point, Gisèle Pélicot a joué un rôle de taille, puisqu’elle a fait résonner la parole des femmes d’âge mûr, elles aussi touchées par les « angles morts » de #MeToo.
Conclusion : faire cas et prendre soin
Depuis 2017, #MeToo a sans aucun doute permis une évolution. Avec le recul, l’impact du mouvement peut être salué, en ce qu’il ouvre la parole, permet une dynamique féministe renouvelée, un meilleur soin de l’autre, et a une influence claire dans la vie sociale, la littérature et les arts. Cela se traduit par de nouveaux sujets construits à partir de cas particuliers trouvant de nombreux échos voire faisant système, de nouveaux points de vue qui participent de la richesse des représentations et renouvellent les imaginaires, menant à de nouveaux sujets et de nouvelles manières de faire de la recherche. Contribuant à la mise en évidence des violences systémiques de la société patriarcale, le mouvement a donné naissance à une parole collective, de plus en plus entendue mais cependant pas toujours prise en compte : « Qui nous écoute vraiment ? », ont justement demandé plus de cent personnalités dans une tribune publiée en 2024 et exigeant une loi intégrale et ambitieuse contre les VSS en France.
#MeToo interroge ainsi notre capacité à prendre soin de l’Autre et rejoint des questions posées par l’éthique du care, ou plus simplement d’humanité. Il renouvelle notre écoute et notre attention pour la parole des victimes comme pour le fonctionnement systémique du patriarcat. Notre responsabilité en tant que société est remobilisée ; elle interroge les capacités du système judiciaire à rendre justice au pénal ou via d’autres modalités comme la justice restaurative. Or, il s’avère que les cas classés sans suite ou déboutés restent majoritaires et que les procédures sont entravées par le manque criant de moyens de la justice. En dépit de multiples plaintes, des cinéastes ont toujours le droit de tourner, des acteurs de jouer, des prêtres de prêcher, des professeurs d’enseigner…
Suzel Meyer, docteure en littérature comparée
Salomé Pastor, doctorante en littérature française
Configurations Littéraires
Bibliographie
Ouvrages :
- Camille Froidevaux-Metterie, « #MeToo, libérer la parole, rappeler le désir », Samuel Lequette, Delphine Los Vergos (dir.), Cours petite fille ! #MeToo #TimesUp #NoShameFist, Paris, Éditions des femmes, 2020, p. 173-180.
- Séphora Haymann et Louise Brzezowska-Dudek (coord.), #MeToo Théâtre, Montreuil, Libertalia, 2022.
- Elsa Deck Marsault, Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes, Paris, La Fabrique, 2023.
- Hélène Merlin-Kajman, La littérature à l’ère de MeToo, Paris, Ithaque, 2020.
- Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française, Montreuil, Libertalia, 2020.
- Gisèle Sapiro, Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?, Paris, Seuil, 2020 et 2024.
- Kharoll-Ann Souffrant, Le Privilège de dénoncer, Remue-ménage, 2022.
- Marine Turchi, Faute de preuves. Enquête sur la justice face aux révélations #MeToo, Paris, Seuil, 2021.
Articles :
- Claire Mestre, Marie-Rose Moro, « Me too, femmes exilées et d’ici, femmes du Sud et du Nord, femmes blanches et noires », L’Autre, vol. 19, N°2, 2018, p. 133-136.
- Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen, vol. 16, N°3, automne 1975, pp. 6-18.
- Véronique Nahoum-Grappe, « #MeToo : Je, Elle, Nous », Esprit, vol. 5, 2018, p. 112-119.
- Claire Scodellaro et al., « Les violences sexuelles dans les vies des gays et des bisexuels. Configurations, dissémination et orientations intimes », Population, Vol. 79, N°1, 2024, pp. 75-109.
- Marie-Jeanne Zenetti, « Que fait #MeToo à la littérature ? », Revue critique de fixxion française contemporaine 24, 2022, DOI: https://doi.org/10.4000/fixxion.2148.
Thèses et mémoires :
- Lucie Nizard, Poétique du désir féminin dans le roman de mœurs français du second XIXe siècle (1857-1914), thèse de littérature, Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, 2021.
- Noémie Trovato, « La tentative de construction d’une contre-réalité des violences sexuelles en France : l’échec discursif du mouvement #MeToo ? », mémoire de master 2 de linguistique, Université Sorbonne Nouvelle - Paris III, 2022.
Presse :
- Lucie Beaugé, Pourquoi le #MeTooLesbien peine-t-il à éclore ?, Libération, 2022.
- Mathilde Blottière, Crise à la Cinémathèque française : le contre-exemple du Forum des images, où “d’autres cinéphiles existent”, Télérama, 2025.
- Juliette Campion, « "La force de Gisèle Pelicot permet à des femmes comme moi de se réparer" : comment l’affaire des viols de Mazan bouleverse intimement les victimes de viols », FranceInfo, 2024.
- Denis Cosnard, Les « sensitivity readers » au cœur d’une polémique avant le prix Goncourt, Le Monde, 2023.
- Michel Guerrin, "Bien sûr qu’il faut montrer Le Dernier Tango à Paris, mais il faut se demander comment l’encadrer", Le Monde, 2024.
- Ludovic Lamant, #MeToo cinéma : une charge contre le "culte de l’auteur" braque la critique, Mediapart, 2024.
- Julien Lecot, La vague MeToo atteint à son tour la communauté gay, Libération, 2021.
- Emmanuelle Lequeux, « Tout le monde savait » : Claude Lévêque, une omerta au nom de l’art, Le Monde, 2021.
- Emmanuelle Lequeux, Une tribune en soutien au plasticien Claude Lévêque divise le milieu de l’art, Le Monde, 2021.
- Benjamin Martinez, Floriane Picard et Eric Dedier, « 5 ans de #metoo en infographies : un hashtag, une prise de parole mondiale à rebondissements », Le Monde, 2022.
- Néo, « #MeTooGay : la culture du viol en accusation », Union communiste libertaire, 2021.
- Clara Serra, De quoi le consentement est-il le non ?, Le Monde Diplomatique, 2025.
- Kharoll-Ann Souffrant, « Genèse de l’écriture de l’essai Le privilège de dénoncer », Courage to act, 2023.
- Marlène Thomas, « Définition du viol : une proposition de loi déposée pour introduire le non-consentement dans le Code pénal », Libération, 2025.
- Marine Turchi, « Devoir conjugal » : la CEDH inflige un camouflet à la France », Mediapart, 2025.
- Victor Vasseur, « 5 ans de #MeToo : #Cuéntalo, #EnaZeda, #jagockså, ces hashtags devenus des points de ralliement à l'étranger », FranceInter, 2022.
- Djaïd Yamak, La Cinémathèque française annule la projection du « Dernier Tango à Paris », après une vive polémique, Le Monde, 2024.
- Un collectif d'organisations féministes, « Introduire le consentement dans la définition pénale du viol n’est pas une "solution miracle" », Libération, 2024.
- Collectif, Catherine Deneuve : "Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle", Le Monde, 2018.
- Collectif, #metoohopital : « La levée du silence sur les comportements inacceptables doit s’accompagner de l’éradication de l’impunité », Le Monde, 2024.
- Têtu, #MeTooTrans : des personnes trans livrent des témoignages poignants sur les réseaux sociaux, Têtu, 2019.
Sitographie :