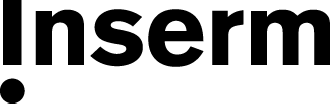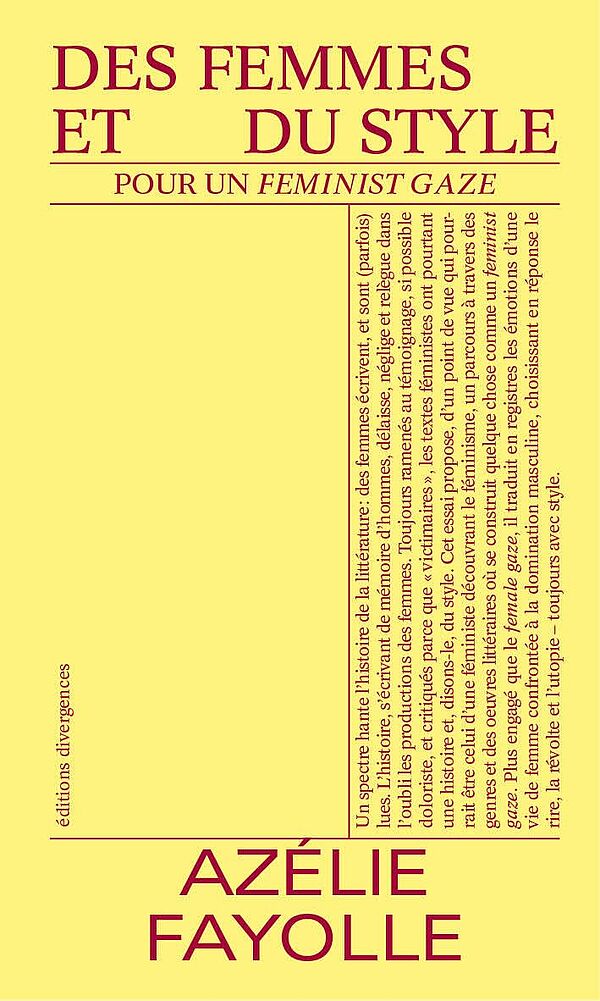Après le male gaze, une technique avant tout cinématographique théorisée par Laura Mulvey en 1975 et qui consiste à montrer les femmes comme des corps saturés de sexualité, et le female gaze, qu’Iris Brey définit comme « un regard qui adopte le point de vue d’un personnage féminin pour épouser son expérience » (Brey citée par Fayolle, p. 131), voilà le feminist gaze. Dans Des femmes et du style, Azélie Fayolle explique vouloir « examiner comment les femmes (et quelques hommes) écrivent avec une conscience féministe » (p. 12). Ce faisant, elle entend montrer ce que peut être un style féministe, lequel trouve son pendant cinématographique dans le feminist gaze et suppose « un regard féministe conscient de l’oppression spécifique des femmes » (p. 35). Si ce parallèle entre regard, gaze et style, ou cinéma et littérature, mériterait davantage d’approfondissement, l’essayiste ne s’y attarde pas. Se concentrant avant tout sur la littérature, elle propose un ouvrage qui, tout en gardant une dimension scientifique, se veut pour le moins engagé. Ce mélange de subjectivité, d’engagement et d’analyses scientifiques est assumé par l’autrice, qui explique que « [m]ilitantisme et recherche scientifique ne s’excluent pas aussi nettement qu’on aimerait le croire » (p. 19). Aussi est-ce la voie que prend Azélie Fayolle pour faire voir « une autre façon de penser et d’appréhender les savoirs » (p. 14). Dès lors, il semble que cela soit à une révolution morale, et non pas seulement artistique et épistémologique, qu’appelle Des femmes et du style.
Jamais vraiment absentes de la sphère littéraire, les autrices ont toutefois été mises au ban de la culture, enclavées dans l’intime, et souvent stigmatisées du fait de leur sexe, l’ « odor di femina » s’imprégnant dans le livre selon Jules Barbey d’Aurevilly (1878, p. XXII). Considérant pleinement la fonction heuristique de l’art, Azélie Fayolle explique que la production artistique des femmes et des féministes permettrait d’accéder à des points de vue jusqu’alors inexploités. L’exploration d’un style féministe semble par conséquent nécessaire pour appréhender le monde. Nécessaire ou exclusif ? Si la critique « espère que ce regard apparaîtra comme un regard ouvert » (p. 37), d’aucun·es lui reprocheront peut-être de vouloir faire de ces yeux les seuls acceptables.
« Nous sommes du sexe de la peur, de l’humiliation, le sexe étranger », écrit Virginie Despentes dans King Kong Théorie. Citée par Azélie Fayolle au début de la deuxième partie de l’ouvrage, cette constatation marque le point de départ du parcours de la vie d’une femme, vie faite de peur et d’un silence « parlant : il s’agit de l’écouter » (p. 46). Entre dit et non-dit, l’art féministe peut traduire l’inquiétude et le doute des femmes quant à leur condition, à leur situation, à leur capacité, à leurs possibilités de vie, d’évolution et d’épanouissement, à leur (in)sécurité et à leurs droits. Si les femmes sont parfois incertaines, le regard dominant, lui, a longtemps défendu l’affirmation suivante : « toute la femme se résume à son utérus » (p. 49). Le style féministe va alors chercher à se réapproprier le corps, comme le fait Hélène Cixous, à montrer l’aliénation qu’il subit, ou encore tenter « d’approcher l’horreur pour l’apprivoiser » (p. 56). Cette horreur comprend notamment le viol. C’est à bras-le-corps qu’Azélie Fayolle prend ce crime et explique qu’il « n’y a pas de recette pour (d)écrire un viol de manière féministe, mais des écueils à éviter, reposant sur des questions éthiques et esthétiques, comme le refus de l’érotisation ou d’une utilisation ornementale des violences sexuelles » (p. 59). La mise en fiction, ou du moins la conscience des violences sexistes et sexuelles, peut en outre donner lieu à « la badasserie du rape and revenge » (p. 43), soit à une reprise de contrôle de la part de la victime qui, dans sa vengeance, peut aller jusqu’à esquisser « la possibilité de voir la peur s’inverser, au moins dans les pages d’un roman » (p. 73). Azélie Fayolle revient ainsi sur le « dirty care », défini comme « l’attention qui est requise de la part des dominé·es, et qui consiste à se projeter en permanence sur les intentions de l’autre, à anticiper ses volontés et désirs, à se fondre dans ses représentations à des fins d’autodéfense, produit de la connaissance, une connaissance des plus poussées, documentées, sur les groupes dominants » (Dorlin, 2017, p. 176). L’essayiste montre alors la « dimension collective » (p. 74) de cette notion qui permet « la vérification, toute empirique, de ce simple état de fait : je ne suis pas folle, je ne suis pas seule » (p. 74).
Des femmes et du style aborde également les « principales stratégies de résistance à l’ordre patriarcal représentées en littérature » (p. 76). Azélie Fayolle interroge ainsi le registre du merveilleux, selon elle propice à produire une pensée sur le genre. Lieu où s’imposent « la magie et les métamorphoses » (p. 79), le merveilleux permet de remodeler la réalité, si ce n’est d’en sortir et d’inventer autre chose. Comme le merveilleux, le spiritisme travaille avec l’imaginaire et ouvre le champ des possibles. En ce sens, il a également intéressé les femmes (Edelman, 1995), qui « ont milité en s’appuyant sur leurs visions pour une nouvelle société » (p. 79). À partir de ces considérations, Azélie Fayolle explique comment certains courants féministes (l’écoféminisme en particulier) ont réussi à détourner la « science dominante ». Avec la militante américaine Starhawk, la magie devient « une réflexion sur le langage et les métaphores » (p. 80). La notion d’obscur à laquelle ouvre ces théories et que l’on peut « ramene[r] à des mythes et à des forces primitives à apprivoiser » (p. 81) fait alors pleinement ressortir la dimension collective sur laquelle entend appuyer l’essayiste. Autre acte du collectif : le manifeste, qui est l’une des « formes textuelles phares des groupes politiques » (p. 84) et que les féministes ont su mobiliser, comme avec SCUM Manifesto par exemple. On peut aussi relever le rire, cet éclat « qui voudrait se prolonger en se répercutant de proche en proche » (Bergson, 1940, p. 4). Il est vrai que les féministes ne sont pas connu·es pour leur rire, et les femmes ont longtemps été exclues du rire, lorsqu’elles n’en furent pas la cible principale. « Alors, y aurait-il une couille dans le potache ? » (p. 103), se demande Azélie Fayolle. En revenant sur l’origine de cet humour avant tout masculin, elle montre que les féministes ont su l’investir, politisant la blague.
Résister, d’un point de vue féministe, c’est aussi faire face au temps, à une (H)istoire qui n’inclut pas les femmes, aux « silences de l’Histoire » (Perrot, 1998, 2020) : « la formule notre temps nous même pourrait résumer cette lutte, qui se réalise aussi en littérature » (p. 117). La langue devient dès lors l’objet d’un travail de transformation, qui peut aller de l’écriture inclusive à une suppression du genre en passant par une féminisation totale, ainsi que le fait Typhaine D. De la langue, Azélie Fayolle en vient au sexe. « Le féminisme est-il anti-sexe ? » (p. 127), demande-t-elle avant d’expliquer qu’il ne s’agit pas de nier le sexe, mais de le représenter autrement. Reprenant la logique du female gaze et celle du « tender gaze », soit un regard tendre qui « humanise la personne désirée et respecte sa pudeur » (Nizard, 2024, p. 129, à partir de M. Cormican et J. William), l’autrice indique que le feminist gaze tient de « l’empathie et [de] la mise en relation » (p. 131). Elle ajoute qu’il refuse la « non-mixité dégradante. Il prolonge l’éthique sexuelle en une éthique textuelle » (p. 133). Le texte ne cherche pas à détourner ou à masquer le (non)consentement, de la même manière qu’il ne grime pas les femmes, car ce « qui saute avec le verrou de la sexualité : c’est cette impossibilité de (se) connaître » (p. 133). On se souvient alors évidemment des Guérillères de Monique Wittig, qu’Azélie Fayolle mentionne à bon escient :
Elles n’utilisent pas pour parler de leurs sexes des hyperboles, des métaphores, elles ne procèdent pas par accumulations ou par gradations. […] Elles disent que toutes ces formes désignent un langage suranné. Elles disent qu’il faut tout recommencer.
Entre ces langues et ces corps se trouvent en outre des narrations « où des femmes prennent la parole pour raconter, que le récit soit fictif ou factuel » (p. 151). Doit-on voir là une forme de narcissisme ? Selon Azélie Fayolle, ces témoignages ne sont pas le résultat d’une autocomplaisance. « La place des locutrices y est instable justement parce qu’ils montrent comment le “je” du témoignage individuel se construit comme une subjectivité, qui reste clivée en contexte patriarcal » (p. 153). Les femmes de la littérature féministe seraient-elles alors condamnées à n’être que vulnérabilité, quand les hommes garderaient leur puissance habituelle ? D’après la chercheuse, il est possible de « [r]emettre le Héros à sa place », c’est-à-dire de « laisser le virilisme de côté, et parier, plus que sur l’Héroïne, sur les femmes » (p. 159). On comprend alors que la littérature relevant d’un style féministe tient en partie de la rupture. Décalée, subversive, silencieuse et bruyante à la fois, elle propose un regard désaxé qui la situe dans l’utopie, ce monde qui peut traduire et produire du désordre (Cohen, Turbiau et al., 2022), cet univers qui n’est pas mais que les féministes esquissent en s’appuyant « d’abord sur le constat d’une réalité qui ne va pas comme elle est dite : en dire et en dénoncer l’injustice, c’est déjà rêver et construire un monde meilleur » (p. 181).
Pour rédiger Des femmes et du style, Azélie Fayolle a très certainement mené un travail de recherche de longue haleine. Effort de vulgarisation, un exercice que l’autrice met aussi en pratique sur les réseaux sociaux, cet ouvrage témoigne également des riches connaissances de l’universitaire qu’est Azélie Fayolle. On ressent en effet l’influence d’éminentes chercheuses telles que Michelle Perrot, Christine Delphy, Colette Guillaumin ou encore Patricia Hill Collins. Cependant, si ces théories ont très bien été comprises, elles sont intégrées à un essai écrit par une plume parfois railleuse. Ce ton affirmé peut bien sûr être plaisant, voire faire naître le sentiment d’appartenance à un groupe. Toutefois, il peut aussi déranger certain·es dans leur lecture. Enfin, on regrette de ne pas trouver plus d’analyses d’œuvres signées par des écrivains (hommes) dits marginaux ou féministes d’avant-gardes. Malgré ces quelques réserves, nous ne pouvons que reconnaître la richesse de l’ouvrage. En se confrontant à des questions éthiques, esthétiques et politiques, elle parvient à faire dialoguer l’Histoire et l’actualité, tout en balayant un vaste pan de la littérature, de Christine de Pizan à Alice Zeniter en passant par les saint-simoniennes, Renée Vivien, Virginia Woolf, Annie Ernaux, Léonora Miano ou encore Mariana Enriquez. La chercheuse prend en outre soin de mettre à l’honneur des femmes invisibilisées et qu’il est temps de redécouvrir : Olympe Audouard, Claire Démar, Madeleine Pelletier… Grâce à cette étendue d’exemples et ses observations, Azélie Fayolle est parvenue à faire émerger les nuances et possibilités d’un style féministe. Nous ne pouvons alors qu’espérer que cette recherche continue de s’étendre, car elle promet de nous faire écouter « des voix minorées (et pas seulement féminines, ni féministes) et faire entendre celles qui n’ont jamais pu parler » (p. 185).
Salomé Pastor - Doctorante en littérature française - Configurations littéraires
Bibliographie :
- Jules Barbey d'Aurevilly, Les Bas-bleus, Paris/Bruxelles, Victor Palmé/Lebrocquy, 1878.
Henri Bergson, Le Rire. Essai sur la signification du comique, Paris, PUF/Quadrige, 1940.
Iris Brey, Le Regard féminin : une révolution à l’écran, Paris, Éditions de l’Olivier, 2020.
Judith Cohen, Samy Lagrande, Aurore Turbiau (dir.), Esthétiques du désordre : vers une autre pensée de l’utopie, Paris, Convergences, 2022.
Virginie Despentes, King-Kong Théorie, Paris, Grasset, 2006.
Elsa Dorlin, Se défendre : une philosophie de la violence, Paris, La Découverte, 2017.
Nicole Edelman, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France, 1785-1914, Paris, Albin Michel, 1995.
Nicole Edelman, Histoire de la voyance et du paranormal. Du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2006.
- Anne-Claire Marpeau, « La réparation du female gaze ? », Revue critique de fixxion française contemporaine, vol. 24, 2022.
- Anne-Claire Marpeau, « Le regard masculin, ou male gaze : le roman réaliste français du XIXe siècle à l’épreuve d’un outil d’analyse féministe », Romantisme, vol. 1, N°201, 2023, pp. 139-154.
- Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen, vol. 16, N°3, automne 1975, pp. 6-18.
- Lucie Nizard, Poétique du désir féminin dans le roman de mœurs français du second XIXe siècle (1857-1914), thèse de littérature, Université Sorbonne nouvelle – Paris III, 2021.
Michelle Perrot, Les Femmes ou Les silences de l’histoire, (1998), Paris, Flammarion, 2020.
Monique Wittig, Les Guérillères, Paris, Les éditions de Minuit, coll. « Minuit double », 1969.