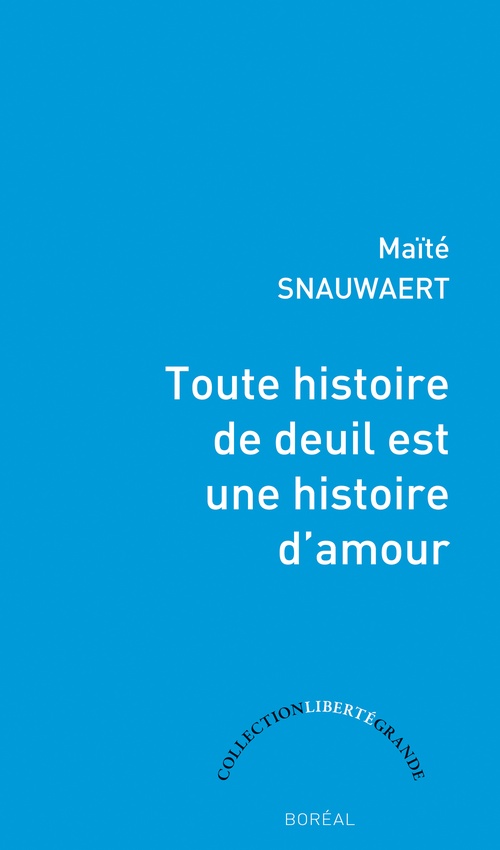Comment prendre soin des morts ?
Les journaux et récits de deuil sont devenus un genre à part de la littérature. Inaugurés en France par le Journal de deuil de Roland Barthes, publié après la mort de son auteur en 2009, et outre-Atlantique par le livre du théologien C. S. Lewis, longtemps resté un hapax littéraire (Apprendre la mort, 2019 – édition originale en anglais en 1961), puis celui de la journaliste et écrivaine Joan Didion (L’Année de la pensée magique, 2007 – édition originale en 2005), ils répondent à une disparition des rituels du deuil dans nos sociétés occidentales et à cette triste révolution morale qui laisse aujourd'hui les endeuillés dans la plus grande des solitudes et le plus grand désarroi. Dans notre monde, le deuil manque d’espace pour se dire, notait aussi Anne-Dauphine Julliand dans son essai Consolation (2021) et avant elle Philippe Ariès dans ses Essais sur l’histoire de la mort en Occident. Du Moyen Âge à nos jours (1975) et dans L’Homme devant la mort (1977).
Les récits de deuil relèvent du care, dans la mesure où ils remettent les disparus dans la « circulation des discours », recréent une communauté autour d’eux et constituent « les derniers soins » qu’on peut encore leur prodiguer (p. 173). En inventant des formes inédites, les écrivains poursuivent leurs entretiens avec leurs aimés. Comme le dit l’écrivain Joseph Luzzi, auquel Maïté Snauwaert emprunte son titre : « Every grief story is a love story » (In a Dark Wood: A Memoir, 2016). Le deuil apparaît ainsi comme le dernier âge de l’amour, celui où le survivant peut continuer à converser avec l’aimé… sans jamais, hélas, en recevoir de réponse, ce qui constitue toute la douleur de cette expérience. Ce faisant, les écrivains du deuil rendent hommage aux disparus dont ils font vivre la mémoire. La forme littéraire, parfois très savante, frappe les imaginations pour que les vies et les personnes qu’ils ont aimées « deviennent indélébiles » (p. 60).
Autrice d’une étude sur Philippe Forest, écrivain entré en littérature avec un récit bouleversant consacré à la mort de sa fille de quatre ans, L’Enfant éternel (1997), Maïté Snauwaert, professeur à l’université de l’Alberta (Canada), aborde un vaste corpus de quarante-deux textes, pour l’essentiel français et nord-américains. Elle érige, à la suite de Barthes, dont elle reprend ces mots, une « histoire pathétique de la littérature », personnelle et sensible.
Il faut un certain courage pour se confronter à ces textes si chargés émotionnellement, dont l’objectif est de mettre en mot le chagrin du premier deuil, et dont le résultat, de fait, est de le communiquer aux lecteurs : les passages cités par l’essayiste sont tous plus poignants les uns que les autres. S’ils concernent parfois des parents âgés, ils témoignent souvent de la disparition d’êtres encore jeunes, emportés par les maladies, les accidents, les suicides, laissant les survivants dans l’hébétude et l’affliction.
Tous singuliers, ces livres, rédigés par des veufs ou des veuves, des sœurs ou des frères, des pères ou des mères endeuillés, des amis, touchent et bouleversent, mais ils ont aussi une vocation : transmettre un savoir sur une expérience cruciale de notre humanité. « Non seulement la littérature peut transmettre l’expérience du deuil, mais elle est seule à pouvoir le faire » écrit l’autrice dans sa conclusion (p. 244). Intervenant dans le champ public, les écrivains donnent une voix à ce qui est d’ordinaire tu. Ils s’élèvent contre les stéréotypes de pensée qui oblitèrent la compréhension profonde du deuil. Le plus connu fait du chagrin lié à la perte déchirante d’un être cher un indicible. Leurs récits montrent l’inverse, avec brio, notamment les livres d’artistes. Anne Carson consacre ainsi un livre-tombeau à son frère décédé : une boîte renfermant un accordéon, où elle a disposé et traduit les vers d’un poème de deuil du poète latin Catulle. Tous ces auteurs mettent en cause les discours sociaux sur le deuil, en particulier les cinq étapes élaborées par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross dans son ouvrage On Death and Dying (traduit sous le titre Les derniers instants de la vie) publié en 1969, reprises dans la vulgate médico-psychologique contemporaine qui constituent aujourd’hui quasiment le seul discours social disponible sur le chagrin (choc/déni ; colère ; marchandage ; dépression ; acceptation : voir le résumé sur Wikipédia). Les écrivains du deuil témoignent à l’inverse d’un chaos qui perdure dans le temps, d’une trajectoire qui dément l’idée d’un apaisement linéaire et chronologique, voire d’une « guérison » qui ferait son long cheminement à partir du décès. Tout aussi caustique que Roland Barthes qui refuse d’utiliser le mot « deuil », « trop psychanalytique », lui préférant « chagrin », Joan Didion s’élève contre les conceptions de notre époque qui envisage le deuil comme la sortie progressive d’un traumatisme : « Nous ne nous attendons pas à ce que ce choc oblitère tout, disloque le corps comme l’esprit » (p. 232).
Un premier chapitre est consacré au « livre » inaugural de Barthes (réunissant des feuillets autonomes), qui n’était pas destiné à la publication, et qui a ouvert une nouvelle perspective au « genre de chagrin » contemporain (p. 23). Âgé de 65 ans, Barthes, confronté au deuil majeur de sa mère, avec laquelle il vivait, documente son chagrin sur des notes, des fragments incisifs, où se lisent à la fois sa profonde désorientation et le maintien d’un esprit critique acéré. Il rend compte de la profonde incrédulité qui s’abat sur le survivant devant la mort de la personne aimée. Et, lors des premiers temps, à chaque réveil, de « l’entêtement sisyphéen de la douleur qui chaque jour recommence […], à chaque retour de conscience » (p. 28). Ce « retour » du chagrin survient à différents moments de la journée, dans une intensité qui déchire le sujet comme s’il réalisait pour la première fois la perte qu’il vient de subir.
Pourtant si le chagrin pulvérise le quotidien, il n’efface ni la « présence d’esprit » du survivant, selon le terme de Barthes, ni la volonté d’une « tenue », dont le journal est justement l’instrument. Les écrivains utilisent alors le récit ou le journal dans une optique de dédoublement réflexif en même temps que de critique des usages sociaux ou de la mondanité, tandis que l’écriture devient profondément une « méthode de deuil ». Chaque écrivain trouve la sienne propre : après la mort de son frère, Helen Humphreys par exemple (Nocturne: On the Life and Death of My Brother, 2013) recopie une à une les entrées d’une encyclopédie consacrées aux pommes de New York dans une longue lettre qu’elle adresse au frère disparu. Les écrits de deuil sont d’ailleurs très souvent adressés à l’aimé. Ils prennent une forme narrative (et non poétique comme au XIXe siècle) pour mieux dire le temps brisé et la syncope qui semble le nouveau rythme du deuil, et ils s’emploient à restituer les « météorologies du chagrin » (titre du chapitre 5) – saisons et climats de l’expérience. Ce travail formel revêt une double dimension : il permet de se « tenir droit dans son deuil » (p. 148) et rend hommage aux disparus.
Les expériences des endeuillés sont parentes : le deuil est toujours une « surprise », voire une « catastrophe ». Même quand la mort concerne une personne très âgée ou très malade, elle paraît toujours accidentelle et troue la trame du temps. À cet égard, le chapitre 2 accorde une place de choix à La Pensée magique de Joan Didion, titre qui renvoie à l’incapacité de l’écrivaine, pendant de long mois, à croire en la mort de son mari, et à imaginer, de manière irrationnelle, son retour à la maison. L’entretien avec l’aimé, qui peut durer dans le temps on l’a vu, rend d’autant plus terrible la forme de radiation sociale du défunt, dont le nom n’est même plus mentionné dans les discussions, comme s’il n’avait jamais existé. « C’est ce que ne comprennent souvent pas ceux qui n’ont pas franchi le tropique du chagrin [explique Julian Barnes] : le fait que quelqu’un est mort peut signifier qu’il n’est pas en vie, mais ne signifie pas qu’il n’existe pas » (Julian Barnes, Quand tout est déjà arrivé, 2017 – édition originale en anglais en 2013, cité p. 99). La difficulté réside dans l’isolement de l’endeuillé, à la fois subi et recherché, son sentiment d’inadéquation à la société, et l’impression que l’entourage n’est pas à la hauteur : le survivant s’endurcit… et les auteurs se moquent de l’attitude si maladroite des personnes qu’ils rencontrent.
Certains lieux deviennent alors des refuges, telle la chambre du défunt transformée en mausolée chez Roland Barthes qui y dépose rituellement des fleurs, ou en chambre d’écriture chez Bernard Chambaz qui a perdu un fils, mort accidentellement à l’adolescence (Martin cet été, 1994). Le journal ou le récit de deuil devient parabole et extension de ce lieu (p. 107).
Si les auteurs réfutent tous en chœur les fameuses « étapes » du deuil, Maïté Snauwaert souligne pourtant la temporalité de cette expérience, variable chez les affligés, un « premier » deuil (en anglais grief), souvent dévastateur, laissant place à un second (en anglais mourning), où le survivant retrouve un peu de légèreté à vivre. L’endeuillé peut alors entrer dans sa « dernière vie », un âge qui ne doit pas être confondu avec la vieillesse, car on peut y pénétrer très tôt. Sa caractéristique est de procurer à l’endeuillé le sentiment d’une vulnérabilité nouvelle, voire une sensibilité à son « extinction personnelle » selon les mots d’Helen Vendler (citée p. 222) : il se découvre en effet fragile et mortel.
Se sort-on du deuil ? Peut-on en guérir ? Les auteurs répondent d’une manière nuancée. Si Joan Didion réfute le terme de « guérison », Julian Barnes propose une image saisissante : « Et on s’en sort, c’est vrai. Mais on n’en sort pas comme un train jaillit d’un tunnel [...] on en sort comme une mouette s’extirpe d’une marée noire, tel un condamné à être enduit de goudron et de plumes pour la vie » (p. 238).
Ceux qui sont passés de l’autre côté du tropique du chagrin deviennent des « éclaireurs » pour les lecteurs, comme le montre la nouvelle inédite qui clôt l’essai, signée de l’écrivaine québécoise Catherine Mavrikakis, autrice de L’Absente de tous bouquets consacrée à sa mère décédée (2020). Une psychanalyste endeuillée, qui ne supporte plus aucun conseil de ses proches, y trouve du réconfort dans sa lecture du passage de Voyage au bout de la nuit consacré à la mort de « Bébert », l’enfant que Bardamu aimait :
Avec Céline, tout à coup le chagrin n’était plus une honte, elle se sentait vue par l’écrivain, heureuse de ne pas se savoir seule dans sa rage contre l’absurde, contre l’injuste. Elle était incapable d’aller mieux. C’était ainsi, et Céline ou Bardamu lui disait de continuer à ronger son misérable os de chagrin (p. 255).
Loin de trouver une consolation dans un livre, le personnage identifie chez Céline de quoi accompagner et justifier son chagrin. Tous les endeuillés du corpus se tournent d’ailleurs vers la littérature, non dans l’espoir de faire germer dans ce terreau une improbable guérison, mais pour soigner au long cours des maux, dont ils proclament la nécessité de les vivre pleinement et leur indépassable valeur.
Corinne Grenouillet - Configurations littéraires