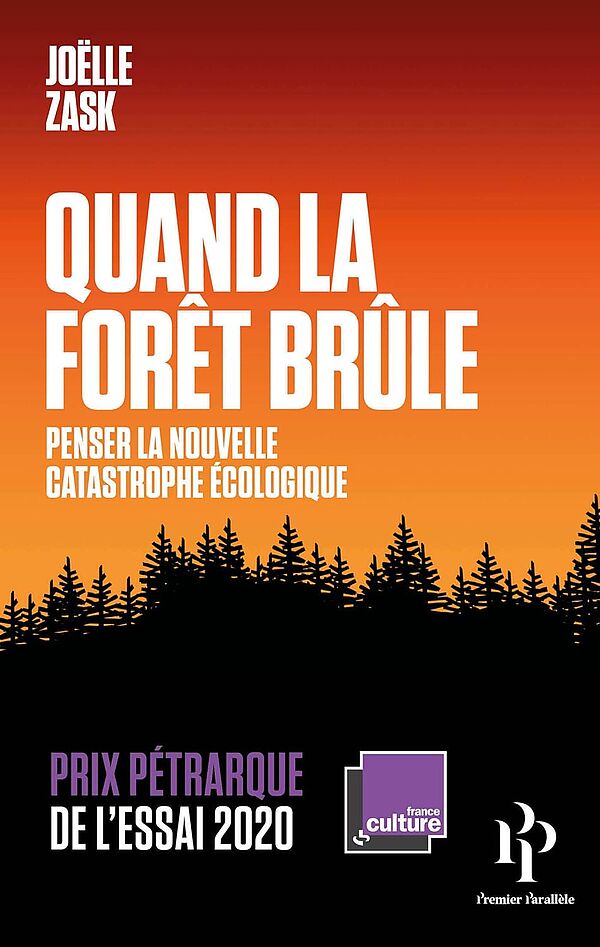On peut vivre avec les loups, comme le préconise le philosophe Baptiste Morizot (Les Diplomates : cohabiter avec les loups sur une nouvelle carte du vivant, 2016), mais certainement pas avec les grands feux, « dont le premier aurait été celui de Yellowstone en 1988, au cours duquel 45 % du parc a brûlé. ». Connus depuis une dizaine d’années sous le nom de mégafeux (« The Mega-Fire Reality », Forest Ecology and Management, 2013, n°294), de feux extrêmes ou encore d’hyperfeux, ces épisodes meurtriers marquent une rupture à la fois écologique et anthropologique : couvrant une surface « supérieure à 20 000 hectares, voire 40 000 hectares selon les auteurs », ils « rendent le pays inhabitable, l’air irrespirable, le sol durablement stérile » et se révèlent impossibles à contrôler, quels que soient les moyens techniques déployés pour tenter de circonvenir un « phénomène par nature imprévisible et sidérant ». Aux États-Unis, l’exemple le plus marquant est celui du « Camp Fire » de 2018, qui détruisit une ville californienne ironiquement nommée « Paradise ».
Croisant les apports de plusieurs disciplines, l’essai de Joëlle Zask propose de traiter le mégafeu comme un « événement total, à la fois social et culturel » (et dans une certaine mesure géopolitique, puisque, comme le rappelle le dernier chapitre, certaines organisations terroristes encouragent un jihad des forêts fondé sur l’arme redoutablement efficace que constituerait le « pyroterrorisme » dans un monde fragilisé par le réchauffement climatique). L’ouvrage aborde dès lors aussi bien les causes et les conséquences écologiques des incendies, que leur impact psychologique sur des populations durablement marquée par la destruction sans recours du « paysage » qu’elles avaient contribué à façonner. La description de ce traumatisme profond et du « pouvoir de sidération » exercé par les flammes passe ici par le truchement de la fiction : les bouleversantes citations empruntées au roman que la Québécoise Jocelyn Saucier consacra aux grands feux du nord de l’Ontario (Il pleuvait des oiseaux, 2011) contribuent à invalider le diagnostic d’Amitav Gosh, selon qui la littérature « sérieuse » se refuserait à rendre compte des catastrophes climatiques (Le Grand Dérangement : d’autres récits à l’ère de la crise climatique, 2016). Reprenant les analyses de Jean-Marc Besse (Le Goût du monde : exercices de paysage, 2009), Joëlle Zask rappelle qu’un monde sans paysage est un « monde sans horizon » et qu’« en détruisant tout sur son passage, le grand feu de forêt […] enserre nos actions dans les limites étriquées d’un présent sans futur ». Sans jamais omettre de souligner le caractère dramatique de ces événements, elle propose « recourir au phénomène du mégafeu comme à un poste d’observation et à un “accélérateur d’opinion” en faveur d’une action commune pour la sauvegarde, non de la terre qui nous survivra, mais des conditions d’existence humaine ». Deux raisons majeures justifient que le mégafeu puisse selon elle « jouer le rôle d’un puissant avertisseur ». En premier lieu, ces incendies invitent à une prise de conscience de la responsabilité humaine, puisque « 85 à 98% d’entre eux, selon les sources, sont provoqués par des êtres humains négligents, imprudents ou criminels ». En second lieu, le feu rend visible de façon paroxystique un changement climatique dont les manifestations demeurent « sinon insensibles, du moins suffisamment lentes pour que nous puissions nous y adapter et les accepter, voire les nier » : le mégafeu en revanche peut se trouver à l’origine d’une révolution morale, dans la mesure où face à lui « nos architectures, matérielles ou mentales, ne tiennent plus ».
Quoique le constat de la multiplication des feux et l’incompréhension de la plupart des spécialistes fasse de l’optimisme « une gageure », Joëlle Zask s’y astreint en proposant de chercher « une nouvelle grammaire de nos interactions avec ce qui constitue notre milieu » pour « développer une approche intellectuelle et émotionnelle susceptible de mener à une action efficace sur le terrain », et faire de ces événements traumatiques le « tremplin pour un changement général qui concernerait non seulement l’intelligence des interactions nécessaires entre les phénomènes naturels et nos activités, mais aussi la distribution des pouvoirs dans les sociétés modernes ». Cette résolution suppose de renouer avec une « culture du feu » dont les paysages contemporains sont le résultat millénaire, puisque « ce sont les interactions entre les feux et l’humanité qui ont donné à de larges espaces naturels leur forme actuelle », voire qui ont permis le développement de certaines espèces animales et végétales. Ressusciter cette culture aujourd’hui largement oubliée suppose de se départir de deux attitudes également délétères – la domination de la nature et sa sanctuarisation. À ce titre, les politiques publiques consistant depuis une cinquantaine d’année à éteindre ou à interdire les feux sont présentées comme susceptibles de provoquer une « crise de la forêt » et de favoriser paradoxalement la catastrophe écologique qu’elles entendaient enrayer. Pour sortir de cette impasse, Joëlle Zask développe ici une distinction fondamentale, qui apparaîtra comme un fil rouge dans l’ensemble de ses travaux : elle consiste à délaisser le concept d’une nature autonome, « commun aux conceptions duelles de la domination et de l’idéalisation » pour lui préférer celui d’une nature indépendante. À l’opposé de l’autonomie, qui suppose « la séparation substantielle des entités concernées », « l’indépendance peut se comprendre comme interaction ou, plus précisément, comme le résultat d’influences réciproques et de transactions situées », si bien qu’il n’y a « rien de paradoxal dans le fait que l’indépendance de la nature repose sur des soins appropriés, des savoirs cumulés, des pratiques d’aménagement altruistes et plurielles », adéquatement exprimées dans l’expression aborigène de cleaning country. Cette proposition rejoint celle de « l’éthique de la nature ordinaire » de Rémi Beau (Éthique de la nature ordinaire : recherches philosophiques dans les champs, les friches et les jardins, 2017), « qui se développe sur la base de relations actives avec la nature et non sur la base d’un respect qui serait dû à la valeur intrinsèque de la nature hors de nous ». La même réflexion vaut pour le paysage, que la philosophe refuse de considérer comme un « objet de contemplation » modelé par le regard des peintres, voire comme une « image fixe, dont la valeur originaire et le caractère intangible sont promptement affirmé » : bien plus, il doit être compris comme un « objet de soins, d’attention, d’un “faire avec” », et, ajouterons-nous ici, d’un faire cas. Joëlle Zask relève ainsi un changement dans le traitement des incendies en Australie : alors que les feux de 2009 suscitent une réponse technologique et le dépôt d’un brevet pour une « bombe à eau du type aérosol capable d’éteindre les feux en extrayant la chaleur qu’ils contiennent », en juillet 2018, les autorités incapables de juguler les flammes se tournent vers les gardes forestiers autochtones. Ces nouvelles démarches impliquent de « réintégrer dans les processus d’enquête et de décisions ces nombreux individus qui, des victimes aux riverains, des locaux aux professionnels, des spécialistes aux héritiers de traditions, ont été exclus tout autant par les experts de l’aménagement des territoires que par les partisans d’une nature sans homme. » À ce titre, la démocratie apparaît bel et bien comme la seule alternative à un monde en proie aux flammes : « parce qu’elle requiert une “culture du feu” et, plus largement, une culture de la participation individuelle au monde commun humain ou non humain, sous la forme de l’entretien, de l’attention et du soin, l’écologie ne peut être que démocratique », conclut Joëlle Zask, énonçant ainsi la thèse d’un essai ultérieur, paru en 2022 chez le même éditeur (Écologie et démocratie).
Ninon Chavoz - Configurations littéraires