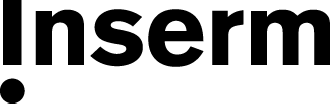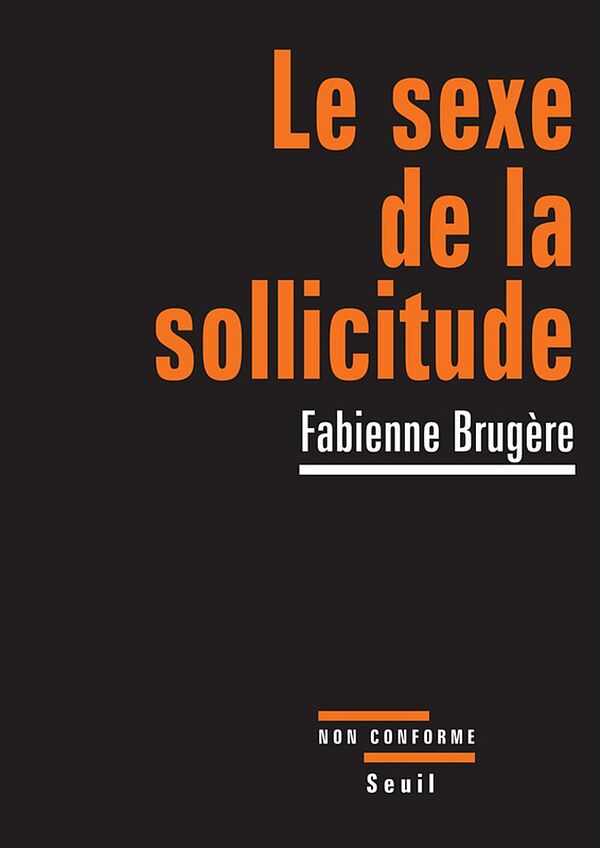Dans Le Sexe de la sollicitude (2008), Fabienne Brugère entreprend « une réévaluation de la sollicitude » (p. 13), trop souvent rabaissée à une forme de « sentimentalisme mou » (p. 21) à l’usage des femmes qui, en rejouant les partages genrés (masculin/féminin, public/privé, raison/affect), reconduirait la domination masculine. Or l’enjeu de l’essai, nourri par les éthiques du care développées dans les années 1980 aux États-Unis, est de « produire une critique qui explore les limites » du concept de sollicitude « pour en proposer un bon usage et des transformations » (p. 21). Pour ce faire, Fabienne Brugère aborde la question sous trois angles : idéologique, éthique et politique.
Premièrement, la sollicitude instaure « une certaine relation aux autres sur le mode de la protection ou de la préoccupation » (p. 13) envers toute vie en situation de besoin, de danger ou de précarité. En tissant des liens concrets qui permettent de sortir de soi et de « modifier la perception du soi qui n’est plus idéalement indépendant » (p. 25) mais concrètement dépendant d’autrui et du monde, la sollicitude pose un « être de relations » (p. 30). Cette mutuelle dépendance « révèle la vulnérabilité » (p. 31) au centre de la condition et de la communauté humaines, qui appelle une prise en charge adaptée dans des relations d’interdépendance, des « chaînes de vulnérabilité » (p. 144), « de conduites affectives » (p. 150) et « d’entraide » (p. 159). L’exercice de la sollicitude est un coup porté à l’idéologie libérale et au mythe de l’individualisme, fondé sur la fiction d’un sujet autonome et indépendant, fiction qui n’a que peu de réalité : le passage obligé par l’enfance ou la vieillesse, ou encore l’expérience toujours possible de la précarité, de la maladie ou du handicap, ramènent l’individu à sa vulnérabilité et à sa dépendance.
Néanmoins, la sollicitude s’exerce dans des sociétés dominées par l’idéologie et l’économie libérales qui, dirigées par l’exigence de rentabilité, font peu de cas de ces tâches dévaluées du fait de leur assignation à un genre, une classe et une race – les pratiques de soin sont en effet réalisées en majorité par des femmes issues des classes défavorisées et de populations immigrées. D’où la nécessité, dans un second temps, de porter la réflexion sur le terrain éthique : « la valeur de la sollicitude peut être comprise comme la mise en place d’une voix éthique qui subvertit les normes sociales habituelles de la sollicitude, vouée à des partages de genre, de classe et de race. Elle nous fait passer d’une sollicitude subie et imposée par des rapports de domination à une sollicitude choisie et revendiquée » (p. 79). À rebours de l’imaginaire sacrificiel dévolu aux femmes, l’éthique de la sollicitude doit se construire en relation avec « une éthique du souci », fondée sur un « équilibre entre souci de soi et souci des autres » (p. 79). Selon Fabienne Brugère, inspirée des éthiques du care, « la sollicitude doit être limitée ou repensée par le souci de soi » (p. 114-115), en tant que voix minoritaire étouffée qui mérite soin et attention au même titre que les autres. Le souci de soi est une manière pour les femmes d’« entrer en résistance » (p. 115) et une façon de renouer la sollicitude à la trame de l’existence sans s’effacer : « La sollicitude ne doit pas être un sacrifice de soi qui se résume à des liens de dépendance perpétuelle. Elle peut servir à avancer une conception plus solidaire de la société en agissant de manière renouvelée envers soi-même et les autres » (p. 122). La démonstration présuppose toutefois une liberté et une agentivité qui ne vont pas de soi, notamment dans le cadre du travail, où la réalité des pressions économiques tempère l’idéal de souci de soi. Polarisé par la question du genre et le féminisme, Le Sexe de la sollicitude reste également plus discret sur les questions de classe et de race, abordées sans que soient frontalement affrontés leurs enjeux et leurs dilemmes spécifiques. L’intersectionnalité reste ainsi un horizon du discours plutôt qu’une réalisation.
Enfin, Fabienne Brugère se demande si l’on peut « défendre des politiques selon la sollicitude » ou s’il faut « en rester à la possibilité d’une éthique » (p. 139). Consciente des écueils – la « tyrannie du proche » (p. 139), qui privilégierait les personnes déjà connues ou familières, ou l’avènement d’une société pareille à « Big Mother » (p. 148), qui infantiliserait les citoyens –, la philosophe rappelle la grandeur de la sollicitude et le gain qu’il y aurait à la placer au centre des dispositifs politiques, au nom de la « compréhension différentielle du tissu social » (p. 144) qui la sous-tend. Parce qu’elle se donne pour but de « transformer et de réévaluer les activités au service des personnes en rémunérant mieux les professions concernées, en promouvant de nouveaux modes d’organisation de ces activités dans le monde social afin que chacun se sente impliqué dans le souci des autres » (p. 159), et qu’elle tente « de placer au cœur de la justice la victime et non plus la loi, l’ordre public ou le criminel » (p. 172), la sollicitude engage une vision autre du travail et de la justice, porteuse d’un véritable projet de société.
Le Sexe de la sollicitude est également traversé par trois efforts : définitionnel, critique et illustratif.
Fabienne Brugère s’attèle à situer le « concept ténu, glissant » (p. 14) de sollicitude par rapport à une galaxie de catégories voisines, connexes et disjointes à la fois. Sont ainsi passées en revue les notions de sympathie, de compassion et de charité, qui pèchent par l’abolition des frontières entre le moi et l’autre, par la spectacularisation médiatique des souffrances ou par l’obéissance à un principe transcendant qui distingue le prochain du bienfaiteur, et ont en commun leur faible engagement, trop passif, trop éphémère ou trop distancié. Or la sollicitude, qui est à la fois disposition et action éthiques, instaure une relation asymétrique entre soignés et aidants, dépendants par leur commune vulnérabilité, mais différents par leurs histoires singulières. Résultante ni du spectacle ni de la manipulation des émotions, la sollicitude est une réponse appropriée à une situation, qu’autrui est toujours libre de refuser, en tant que sujet à part entière. C’est finalement au confluent du care, défini par Carol Gilligan et Joan Tronto en particulier, et de la fraternité, telle que la conceptualise Alain Renaut dans Égalité et discriminations (2007), que Fabienne Brugère situe la sollicitude, à laquelle est conférée une portée éthique et politique : comme le premier, elle se manifeste par « un souci responsable des autres qui prend la forme d’une activité éthique et politique en faveur de la vulnérabilité humaine, dans l’idée de la stabiliser ou de la diminuer » (p. 19) ; du second, elle reprend « la possibilité de considérer autrui comme son semblable en vulnérabilité, et donc comme un être à protéger ou à aider lorsqu’il est dans le besoin » (p. 143).
Le titre, ensuite, ne doit pas porter à confusion : Le Sexe de la sollicitude n’assigne pas la sollicitude à la sphère toute désignée du féminin, mais, tout en reconnaissant son ancrage dans l’expérience singulière des femmes, entend la « “dé-genrer” » ou la « “dé-féminiser” » (p. 115). Autrement dit, la « valorisation inédite de la sollicitude » ne peut être menée qu’« à partir d’une critique des identités de genre » (p. 104). Fabienne Brugère fait l’archéologie du genre, avant d’entreprendre sa « clinique » (p. 112), qui consiste à « déboîter » (p. 137) la sollicitude de la pensée de la complémentarité entre les sexes, qui, en réduisant les femmes au soin dans l’espace domestique pour laisser aux hommes l’accès aux lieux de pouvoir, entre au service de la domination masculine. Pour ne pas refaire de la sollicitude « le lieu d’aliénation des femmes », la démonstration effectue deux déplacements : éviter « le piège féminin ancestral de l’abnégation de soi » (p. 115) par l’impératif du souci de soi ; plaider pour une « dénaturalisation des rapports sociaux » (p. 126) et défendre une « éthique de la sollicitude qui refuse toute naturalisation genrée », en montrant que celle-ci « est une affaire de sensibilité et non de sexe » (p. 138).
Le Sexe de la sollicitude est enfin un livre incarné, parce qu’illustratif. À l’appui de développements nourris, qui commentent les théories de Hume, d’Adam Smith, de Michel Foucault, de Judith Butler, Martha Nussbaum ou d’Axel Honneth, Fabienne Brugère ponctue son essai d’exemples tirés de la littérature ou du cinéma. Des œuvres comme To the Lighthouse de Virginia Woolf (1927), lu par le Bourdieu de La Domination masculine (1998), ou Babel d’Alejandro González Iñárritu (2006), viennent ci et là incarner le propos de la philosophe et condenser les problèmes qu’elle se propose de prendre en charge. Cet usage témoigne d’un pouvoir d’exemplarité conféré à l’art et à la littérature, qui participent de la réflexion éthique par leur capacité à rendre sensibles et visibles des nœuds philosophiques, autrement dit à faire cas, dans l’optique qui est à terme celle du Sexe de sollicitude, celle de prendre soin.
Kathia Huynh - Configurations littéraires
Bibliographie :
- Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Seuil, 1998
- Michel Foucault, Histoire de la sexualité. La volonté de savoir [1974], Paris, Gallimard, 1994
- Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, Harvard University Press, 1982
- Axel Honneth, La Réification, traduit de l’allemand par Stéphane Haber, Paris, Gallimard, 2007
- Martha Nussbaum, Frontiers of justice: Disability, Nationality, Species Membership, Harvard University Press, Belknap Press, 2006
Alain Renaut, Égalité et discriminations, Paris, Seuil, 2007
Joan Tronto, Moral boundaries. A political argument for an ethic of care, New York/Londres, Routledge, 1993