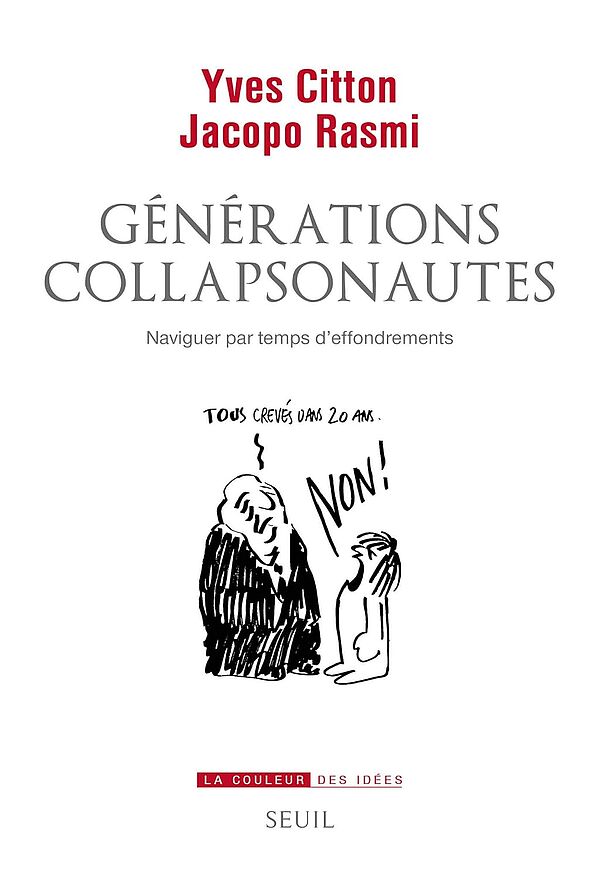L’effondrement est aujourd’hui à la mode – on ne compte plus ses prophètes, qui en ont fait un genre de discours à part entière, la collapsologie – mais que désigne-t-il exactement, et peut-on l’appréhender sans appréhension ? S’il s’agit d’anticiper la disparition de nos actuels modes de vie et de consommation ou, plus largement, du capitalisme consumériste, force est de constater qu’ils ne concernent pas (encore) toute l’humanité, ni tout le monde au même degré. Quant à la catastrophe écologique qui s’accélère sous nos yeux, avec le réchauffement climatique et l’extinction massive des espèces vivantes, une autre évidence s’impose : les plus exposés et vulnérables sont non seulement ceux qui y ont le moins contribué, mais aussi ceux qui ont auparavant subi d’autres effondrements – culturels, économiques, environnementaux, sociopolitiques – à l’époque des conquêtes coloniales et expansions impériales de l’Europe sur tous les continents du globe. L’effondrement doit donc se penser au pluriel, dans la diversité de ses causes et de ses manifestations, d’une part, et d’autre part depuis plusieurs perspectives, sans se limiter à un point de vue anthropo- voire occidentalo-centré.
C’est à cette tâche que s’attellent Yves Citton, professeur de littérature et médias à l’université de Paris 8, et Jacopo Rasmi, un de ses anciens doctorants devenu, depuis la parution de leur ouvrage, maître de conférences en études italiennes et arts plastiques à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne. D’emblée, les deux chercheurs tirent parti de leur différence d’âge et de statut – le premier, sexagénaire, se présente comme un « sortant » dans le système universitaire où le second, trentenaire, s’avère plutôt un « entrant » – pour souligner – à l’image de l’illustration de Gébé, reproduite en couverture – le trait d’union et en même temps l’écart que la perspective d’un effondrement généralisé produit entre les générations. Tandis que les « boomers » y restent largement indifférents, leurs enfants nés dans les années 1960 et 1970 se découvrent plutôt désemparés et pessimistes, et ce sont finalement surtout les plus jeunes, nés à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe, qui se révèlent les plus actifs – voire activistes – pour y faire face et même l’espérer, comme la possibilité de bâtir après lui un meilleur monde. Le titre de l’ouvrage doit ainsi s’entendre d’une double manière : nombreuses et plurielles sont aujourd’hui les générations confrontées à la probabilité d’effondrements systémiques et écologiques des sociétés dans lesquelles elles vivent, mais ces catastrophes prévisibles sont elles-mêmes en gésine d’autre chose, et porteuses de nouvelles opportunités, si tant est qu’on sache les identifier et les saisir. Les « générations collapsonautes » peuvent dès lors tracer de nouvelles voies, et engendrer de nouvelles sociétés ou de nouveaux rapports au vivant.
Pour cela, plusieurs préalables s’imposent néanmoins. Il convient tout d’abord de rompre, d’une part, avec l’imaginaire vertical inhérent à la notion même d’effondrement et, d’autre part, avec la conception linéaire de l’histoire qu’il prolonge tout en semblant la renverser. Si, dans sa brutalité annoncée, l’effondrement prochain est à l’image inversée des courbes exponentielles, en forme de canne de hockey (voir p. 26), de toutes les tendances socio-économiques qui caractérisent, à compter des années 1950, la « grande accélération » de l’anthropocène (augmentation en flèche de la population mondiale et notamment urbaine, consommation excessive des ressources énergétiques et naturelles, développement démesuré des moyens de transport et de communication, essor du tourisme planétaire…), cette représentation en dents de scie ne tient nul compte des nombreux processus à l’œuvre et déjà en cours (affaissements, délitements, effritements, fracturations…) qui travaillent depuis autant de décennies nos sociétés et leurs environnements. L’effondrement a en effet une histoire fractale et multiscalaire, et ce qui caractérise parallèlement la collapsologie, c’est son bégaiement :
L’effondrisme bégaie. À intervalles irréguliers, mais avec une constance et une ingénuité désarmantes, chaque génération voit quelques-un.e.s de ses membres refaire l’expérience d’ouvrir les yeux, avec incrédulité, sur une réalité sidérante et inouïe, qui exige de prendre des mesures immédiates et radicales, sans quoi tout va s’effondrer. […] Une scansion en trois temps articulerait ainsi le dernier demi-siècle : on découvre l’inversion des courbes dans les années 1970 ; on commence à en tirer les conséquences dans les années 1990 au titre de la « décroissance » ; l’accumulation de données relatives au dérèglement climatique et à la sixième grande extinction de biodiversité radicalise et popularise aujourd’hui le message décroissant sous la forme de la hantise effondriste, qui remplit les rues de lycéen.ne.s les vendredis et commence à faire évoluer nos habitudes alimentaires (dans les pays riches). (p. 79 & p. 83)
Pour retracer cette histoire de l’effondrement dans toute sa complexité, les deux auteurs proposent d’adopter « le point de vue décolonial » (titre de leur deuxième chapitre) qui les conduit à préférer, aux nominations géologiques d’« anthropocène » et de « capitalocène », solidement étayées par Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz dans L’Événement anthropocène (2013), celle de « plantationocène ». La plantation, entendue dans sa forme esclavagiste comme dans son acception agro-industrielle, permet en effet de caractériser « ce qui s’est déployé à travers l’axiomatique capitaliste aussi bien qu’à travers un certain socialisme réel » (p. 61), dans ses différentes incarnations (russe, chinoise, nord-coréenne…) en pointant « l’extractivisme » comme leur dénominateur commun.
La même structure de raisonnement met en œuvre et en équation la plantation esclavagiste coloniale du XVIIIe siècle, l’industrie lourde soviétique, l’extermination des moineaux mangeurs de semences dans les campagnes chinoises des années 1950, ou la plantation géométrique d’arbres dans le Canada contemporain. Qu’il s’agisse de pomper du pétrole ou de cultiver du soja transgénique, le modèle de la plantation est extrativiste en ce qu’il croit pouvoir impunément 1° réduire un milieu biodivers à une ressource unique, pour 2° exploiter cette ressource sans veiller à son renouvellement, ni 3° se préoccuper des conséquences humaines ou environnementales de cette exploitation.
Ce qui s’effondre aujourd’hui sur nos têtes et sous nos pieds, c’est ce modèle de la ventouse plantationocène qui depuis quatre siècles, à travers diverses phases et sous divers drapeaux, poursuit une colonisation parallèle des sociétés humaines et des milieux naturels. C’est donc bien une décolonisation que nous avons à opérer, comme invitait à le faire Frantz Fanon, pour « changer l’ordre du monde » structuré par la myopie extractiviste. (p. 61-62)
Mais Citton et Rasmi empruntent également aux « pensées écoféministes, issues du mouvement “Reclaiming” des années 1990 » (p. 84) une attention aux résistances de la nature, « faisant toujours resurgir une diversité revenant du passé » et s’obstinant ainsi à « naître, et renaître, et renaître encore (natura : “ce qui naîtra”) » (p. 85). En situant ainsi leur réflexion « au croisement des études décoloniales et de certaines sensibilités écoféministes » (p. 60), les deux auteurs s’emploient à faire cas de tout ce qui se trouve habituellement minoré et maintenu dans l’ombre par les forces dominantes de nos sociétés, tout en se trouvant enchevêtré à la trame de nos existences comme leur condition nécessaire de survie, qu’il s’agisse de la biodiversité, sur le plan environnemental, ou de la « diversité » humaine, sur le plan culturel. Ce changement de paradigme les conduit également à restituer leur préséance aux milieux, rebaptisés « fonds » (chapitre IV), de nos activités, actant ainsi un véritable « renversement de la pensée effondriste » :
Ses prophéties catastrophistes de chute résultent d’une tendance à concevoir le fond écologique comme un fondement-plancher (ground), plutôt que comme une nappe ou une atmosphère environnante (surround). Seule une conception discutable assimilant le milieu à une plateforme solide sur laquelle notre société artificielle s’érigerait en s’en séparant par un processus d’élévation peut engendrer la peur de tomber et son imaginaire de verticalité. Une autre compréhension du milieu, horizontale, circulaire et fluide, désamorce immédiatement la hantise de l’écroulement. Dans une conception spatiale du surround, comme dans une conception temporelle cyclique, une extinction absolue de la vie environnementale n’est qu’un leurre ; elle résulte d’une pensée historique de progression ascendante, univoque et linéaire – négatrice de toutes les formes de vie qui entourent et assiègent les îlots colonisateurs pour les revitaliser périodiquement de leur infatigable force de résurgence.
Ainsi, si l’on adopte le point de vue du fond-surround, ce qui est menacé n’est pas le milieu environnant. Au contraire, ce qui occupe, au bout du compte, une position fragile et vulnérable, c’est la petite forteresse de l’individualisme occidental et de ses techniques de colonisation, encerclée par les arcs et les flèches d’un environnement qui refuse de se soumettre complètement à son emprise. (p. 124-125)
Résolument pluraliste et interdisciplinaire, leur démarche s’appuie de surcroît sur de fréquents exemples artistiques ou littéraires qui donnent chair et sens à une argumentation constamment portée par une exigence éthique : conduire les humains à faire cas de leur environnement et des diverses et multiples autres formes de vie auxquelles par nature ils sont liés. Dans cette perspective, l’écologie définie comme « l’étude scientifique interdisciplinaire des conditions de vie des organismes en interaction les uns avec les autres et avec le monde qui les entoure » (Arne Naess, cité p. 174) doit selon eux se muer en « écosophie », c’est-à-dire en connaissance « directement pertinente pour l’action » en faveur d’une défense et préservation de la « vie bonne » (ibid.).
En transformant ainsi nos représentations de l’effondrement, Citton et Rasmi contribuent à rendre l’air du temps plus respirable, convertissant avec humour notre hantise de l’apocalypse en espérance de l’« happy collapse », selon un jeu de mots qu’ils reprennent à l’essayiste franco-colombien Pablo Servigne.
Anthony Mangeon - Configurations littéraires