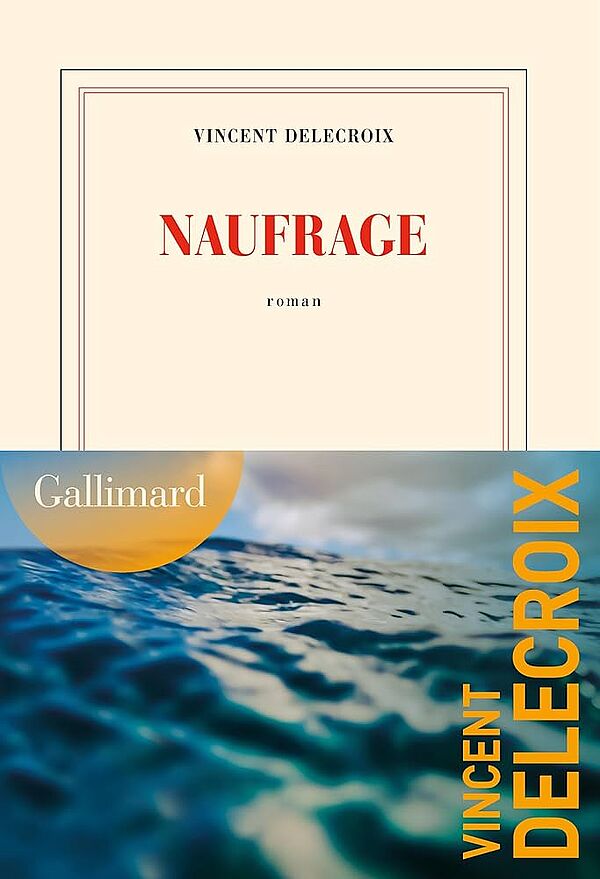Tiré d’un évènement historique, le roman de Vincent Delecroix évoque le naufrage d’un bateau survenu la nuit du 23 au 24 novembre 2021. Alors qu’ils tentaient de traverser la Manche, de Calais vers la Grande-Bretagne, les vingt-neuf occupants du bateau ont alerté les secours français. Malgré les appels de détresse, aucune opération de sauvetage ne fut lancée, puisque, l’embarcation étant à la limite des eaux territoriales, le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) estime que la situation relève de la responsabilité des Britanniques. Ce qui a secoué l’opinion publique en 2021, ce n’est pas uniquement la gestion des militaires français, mais les enregistrements des échanges que l’un des occupants du bateau a eus avec une opératrice du CROSS de Gris-Nez. Après quatre heures de dérive, le naufrage s’achève, ne laissant que deux survivants. Inspiré de cet événement, le récit de Delecroix reste tout de même une œuvre de fiction.
L'auteur imagine la suite du 24 novembre, et la position de l’opératrice impliquée dans l'enquête judiciaire. Le choix de Lucrèce en guise d’exergue est hautement signifiante ici : « Il est doux, lorsque sur la vaste mer les vents bouleversent les flots, de regarder depuis la terre la grande peine que se donne autrui. ». Ces vers permettent d’interroger la position de celui qui, depuis le rivage, observe le naufrage en train de se produire. Si le premier questionnement éthique concerne les motivations qui conduisent à refuser de porter secours à ceux qui le demandent, l’auteur s’interroge plus largement sur ce qu’implique la position de spectateur distant de la souffrance.
Naufrage n’adopte pas la perspective des naufragés, à l'exception du chapitre central, le plus court des trois qui constituent l’œuvre. En dehors de cette séquence, c’est la voix de l’opératrice qui est mise en avant, à travers une succession de pensées contradictoires et de souvenirs de sa vie personnelle. Au début du roman, la protagoniste se rend auprès de la capitaine-enquêtrice à la gendarmerie maritime de Cherbourg, en laquelle elle voit son reflet : « portrait impitoyablement navrant de ce à quoi je devais ressembler en réalité » (p. 41) qui n’est qu’une projection de la voix intérieure de sa conscience. Cette dialectique permet de remonter le cours des actions de l’opératrice et les défaillances qui auraient mené au naufrage. Les premiers arguments concernent l’articulation entre domaine personnel et professionnel :
[…] mon métier supposait justement de ne pas faire la différence […] on vient au secours de tout le monde, on ne fait pas la différence. […] j’ai dit que je n’avais pas d’opinions sur les migrants […]
Je ne m’occupe pas d’une ONG, je ne suis pas là pour défendre une cause et je n’envoie pas les secours parce que c’est juste, voilà ce qu’il fallait lui faire comprendre, à la capitaine de gendarmerie. Ce n’est pas ma conscience morale ou je ne sais quoi, qui balance les bouées de sauvetage ou les couvertures de survie. (pp. 24-28)
Dans cette configuration, toute affectation idéologique et morale semble neutralisée, et les convictions politiques comme les états d’âme sont écartés sous prétexte que « ça empêche d’agir, de prendre des décisions, d’être efficace : c’est une évidence et c’est la première chose qu’on apprend dans ce métier. » (p. 28). L’argumentation se déplace ensuite vers le plan logistique, se focalisant sur le manque de moyens à disposition pour ces missions et donc sur la nécessité de « hiérarchiser » (p. 29). Elle se contredit en passant du premier au second argument, et c'est la voix de la capitaine de gendarmerie qui prend le relais :
Oui mais en définitive vous n’avez envoyé personne du tout, avait-elle coupé, et c’est ça, avait-elle ajouté, qu’il faudrait finir par expliquer, car c’est pour ça qu’on était là : expliquer pourquoi ils avaient mis trois heures à couler alors qu’il y avait un patrouilleur à vingt kilomètres de là, pourquoi lorsque les Anglais avaient été prévenus personne (c’est-à-dire pas moi) ne les avait pourtant informés que l’embarcation était en difficulté, pourquoi lorsqu’un navire les avait aperçus et m’avait demandé ce qu’il devait faire j’avais expliqué qu’il pouvait continuer sa route sans s’en soucier […] (p. 29)
Le récit de Delecroix montre combien chaque cas demeure indissociable de son contexte et ne peut se réduire aux termes d'un drame qui se répète en permanence à l’identique. Ce qu’affirme la protagoniste de Naufrage, c’est l'articulation impossible entre le général et le particulier dans le cadre du secours en mer :
Je ne veux pas les connaître, ces gens. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec leur vie, je veux dire leur vie d’avant, leur existence, leur histoire, qui ils sont, ce qu’ils ont fait ou ce qu’ils valent et surtout ce qui les a poussés à être aussi cons. Moi je n’ai affaire qu’à la vie toute nue.
Et d’ailleurs c’est exactement comme ça, dans cet état qu’on les repêche : des vies toutes nues. (p. 50)
L'empathie, « une crétinerie luxueuse que se paient ceux qui ne font rien et qui s’émeuvent au spectacle de la souffrance. » (p. 49), constituerait selon elle un obstacle à la gestion de l’urgence. Naufrage soulève à ce titre la question du triage : « qu’est-ce que cela veut dire : faire le tri ? Le tri dans ce qu’ils disent, dans leurs paroles, lorsqu’ils vous appellent. Leurs paroles ne se valent pas toutes. » (p. 45). Ainsi se pose une série d’interrogations : à quels critères répond la définition d’un état d’urgence et selon quels paramètres s’active la chaîne des secours ? Comment faire le tri des victimes, à l’intérieur d’un dispositif qui suppose de faire la distinction entre les appels qui relèvent d’une situation d'urgence vitale et les appels des migrants qui ne seraient pas réellement en danger, mais chercheraient à atteindre leur destination ? Les problématiques soulevées dans Naufrage entrent en résonance avec les interrogations que Frédérique Leichter-Flack a abordées dans Qui vivra qui mourra : « L’existence sociale n’est-elle pas faite de ces arbitrages, tris, allocations de ressources rares et vitales qu’il faut refuser à certains pour pouvoir les offrir à d’autres ? ». Ce constat trouve une expression crue dans le récit de Delecroix :
On me reproche de ne pas réussir à me mettre à leur place, ai-je encore songé. Mais la vérité est que c’est exactement le contraire : je suis à leur place parce que c’est leur place que j’occupe et eux, ceux qui se noient, ils sont à la mienne et ils coulent pour que je reste à la surface et je peux rester sur la terre ferme tant qu’ils sont dans l’eau (p. 121)
Revenir sur ce triste fait divers permet à l’auteur de problématiser la position des Européens vis-à-vis des processus migratoires, et de montrer que l’obligation morale de traiter toutes les vies selon un principe d'égalité se heurte systématiquement aux limites des dispositifs compétents en matière de sauvetage. Dans la dernière partie du récit, la protagoniste rétablit à sa manière la représentation des faits, essayant de prouver que ce qu’on entend dans les enregistrements « ce n’est pas la voix d’un monstre ou d’une criminelle […] – c’est la voix de tout le monde. » (p. 115). Entièrement construit autour de la sphère sémantique de la représentation, le roman suggère que c’est bien au-delà de la représentation, et peut-être dans la faculté active d’imagination, que doit être cultivée et mobilisée la notion de responsabilité à l’échelle individuelle et collective, pour contrer les mécanismes de désengagement.
Vittoria Dell'Aira - Configurations littéraires
Notice rédigée dans le cadre du séminaire d'Enrica Zanin : Littérature de l'extrême contemporain.