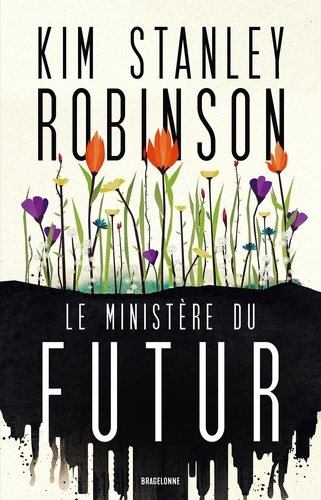« Réfléchissez bien. Si vous connaissiez vraiment le futur, sachant donc que des gens d’aujourd’hui sont en train de tuer vos enfants, et les enfants de vos enfants, alors vous défendriez votre famille. Pour protéger votre foyer, votre vie et celle de vos proches, vous tueriez un intrus. » Opposant aux commandements de la morale un principe de durabilité posé au fondement de l’éthique climatique, cette proposition, énoncée au vingt-cinquième chapitre du roman, en cristallise les enjeux romanesques et philosophiques. Elle surgit en effet lors de la première confrontation des deux personnages principaux : Mary Murphy, « ancienne ministre des Affaires étrangères de la République d’Irlande et, avant cela, avocate en droit syndical », et Frank May, un Américain engagé dans l’humanitaire. La première est présentée par le critique littéraire Bill McKibben comme un mélange réussi de la Présidente de l’Irlande Mary Robinson (qui exerça entre 1997 et 2002 les fonctions de Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme), de l’économiste Laurence Tubiana et de la diplomate costaricaine Christiana Figueres (devenue la secrétaire exécutive de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques entre 2010 et 2016). Dans le roman de Robinson, Mary Murphy se trouve à la tête d’une institution nouvelle, créée lors de la COP29 tenue à Bogota en 2024 (la fiction s’écarte ici de la réalité, puisque cette conférence se tiendra en réalité en Azerbaïdjan) : installé à Zurich et baptisé par la presse « le Ministère du futur », ce nouvel organe des Nations Unies est chargé de travailler avec le GIEC et avec tous les gouvernements signataires de l’accord de Paris « afin de plaider la cause des générations futures de citoyens du monde » et « de défendre toutes les créatures vivantes présentes et à venir qui sont dans l’incapacité de s’exprimer par elles-mêmes, en promouvant leur statut légal et leur protection physique » (chapitre 3). Quelques mois après l’entrée en exercice du Ministère, Frank May, en mission dans l’Uttar Pradesh, est témoin d’une canicule meurtrière dont la description détaillée saisit le lecteur à la gorge dès le premier chapitre du roman. Lorsque les températures montent à 42°C avec 60 % d’humidité, les habitants se réfugient dans un lac en espérant y trouver un peu de fraîcheur, mais c’est en vain : les autorités indiennes annonceront 20 millions de morts et Frank s’éveillera seul survivant dans un plan d’eau rempli de cadavres. Durablement traumatisé par cette expérience, le jeune Américain entreprend d’agir par tous les moyens pour éviter qu’une telle catastrophe se renouvelle : n’hésitant pas à recourir à la violence pour se faire entendre, il enlève Mary pour lui reprocher l’inaction de son ministère et l’inciter à entreprendre des actions plus radicales. Tandis que l’Irlandaise défend la prééminence de l’État de droit, le rescapé se prévaut d’une forme de « légitime défense » pour justifier l’élimination des pires « criminels climatiques », rappelant au passage que les procès de Nuremberg ont ouvert la possibilité de ne pas obéir à une loi jugée mauvaise.
Le dilemme éthique ainsi posé constitue indéniablement l’un des fils rouges du roman : la volonté de sauver le monde justifie-t-elle l’usage de la violence, le sabotage, voire même l’assassinat ciblé ? La question est d’autant plus cruciale que les solutions au réchauffement climatique, ainsi que le fait à plusieurs reprises remarquer l’auteur, sont connues de longue date : manque seulement l’élan décisif qui conduirait à leur mise en œuvre. Comme le comprend rapidement Mary lorsque ses collaborateurs lui rappellent la « litanie bien connue […] déjà vieille mais toujours pertinente » des mesures permettant la baisse des émissions, « il n’y avait pas de mystères, tant sur la nature du problème que sur les solutions. […] Ils perdaient la partie face à des gens qui, apparemment, n’en saisissaient pas l’enjeu. » (chapitre 56). Le problème, en d’autres termes, n’est pas un défaut de savoir, mais une interrogation éthique : faut-il imposer une révolution morale et si oui, par quels moyens ?
La réponse apportée par le roman de Kim Stanley Robinson ne manque pas d’ambiguïté : de fait, si Frank May, coupable d’homicide involontaire, finit par être arrêté et incarcéré dans une prison helvétique, dont il ne sort que pour se découvrir atteint d’une foudroyante tumeur au cerveau, il demeure un personnage fondamentalement sympathique, pour lequel Mary elle-même développe une affection qu’elle ne s’explique pas (la convocation d’un syndrome de Stockholm couplé à un syndrome de Lima, au chapitre 50 n’étant que modérément convaincante). Plus encore, le choix de Frank May est loin d’être isolé : ainsi Mary découvre-t-elle que l’organisme qu’elle dirige abrite à son insu une division secrète, chargée de mener des actions aux confins de la légalité. Le Ministère éponyme est donc une instance bicéphale : Mary porte son volet officiel, aux activités transparentes, tandis que son volet le plus opaque est confié à son directeur de cabinet, autrefois employé par Interpol, l’Indo-Népalais Badim Bahadur (lequel lui succèdera lorsqu’elle prendra sa retraite à la fin du roman, semblant ainsi prendre acte de la fusion des deux têtes, ou de la moindre nécessité du service secret à une période où le risque de crise est ponctuellement écarté). De même, en Inde, les ravages de la canicule conduisent à la fois à des mesures politiques officielles (largage de dioxyde de souffre dans l’atmosphère pour réduire la température, sur le modèle de l’irruption du Pinatubo en 1991 ; nationalisation de la production d’électricité, fermeture des centrales charbon, recours accru à l’éolien et au solaire, encouragement de l’agriculture biologique, etc.) et à l’émergence d’un groupe terroriste connu sous le nom des « enfants de Kali ». Dans la description que donne l’auteur des changements survenus dans les années 2030 (chapitre 31), les actions de cette organisation souterraine jouent un rôle non négligeable pour imposer une transformation rapide de nos modes de vie :
On avance que la guerre pour la Terre a officiellement débuté le jour du Crash. La même année, les porte-conteneurs ont été pris pour cibles à leur tour, coulés la plupart du temps près des côtes. Des torpilles surgissant de nulle part : une autre sorte de drones. Il s’avéra assez vite que ces navires coulaient souvent à des endroits où ils pouvaient former la base d’un nouveau récif corallien. En tout cas, ils coulaient. Avec leurs moteurs Diesel. Ces actions firent peu de victimes mais affectèrent durement le commerce mondial. Les Bourses plongèrent encore plus bas qu’après le jour du Crash. Récession mondiale, sentiment de perte de contrôle, hausse fulgurante des prix à la consommation, perspective d’une énorme dépression qui se produisit en effet quelques années plus tard… […] Ensuite, les Enfants de Kali – ou un autre groupe reprenant ce nom – lancèrent un nouvel avertissement au monde : les vaches. Peu après, ils annoncèrent que la maladie de la vache folle – ou encéphalopathie spongiforme bovine – avait été inoculée à des millions de bêtes à travers le monde par des drones tirant des aiguilles. […] Donc, pour leur propre bien, les gens furent sommés de renoncer à la viande bovine. De fait, à partir des années 2040, la consommation de bœuf ralentit. De même que celle du lait. De même que la construction d’avions.
Si elle donne l’impulsion décisive, l’action violente ne suffit pourtant pas : elle est conjuguée dans le roman aux négociations politiques et aux mutations économiques orchestrées par Mary grâce à un habile travail de diplomatie auprès des gouvernements et des Banques centrales européenne, américaine, russe et chinoise. L’objectif est de concilier une approche punitive, qui sanctionne les pollueurs, à des dispositifs incitatifs, ou comme le synthétise l’éloquente Irlandaise, la carotte et le bâton. Ainsi le Ministère parvient-il à obtenir la création d’une nouvelle monnaie, le carboncoin (bientôt appelé « carboni »), « à raison d’une unité par tonne d’équivalent CO2 épargnée, soit en évitant de la libérer alors qu’elle aurait dû l’être, soit en la capturant dans l’atmosphère » (chapitre 60). Cette évolution du système économique mondial est obtenue de haute lutte, à la suite de la création, par l’un des services du Ministère, d’une « banque coopérative intégrée au monde des réseaux sociaux », baptisé MaClé, laquelle conduit à la désertion des banques privées et menace de provoquer un krach plus tragique encore que ceux de 2008 et de 2020. Parfois assez techniques, les chapitres ayant vocation à exposer ce dispositif économique complexe et les modalités de sa mise en œuvre occupent une place centrale dans le roman : ils démontrent avec une remarquable efficacité que l’action pour le climat est indissociable d’une réforme du capitalisme, et que cette dernière implique à la fois les gouvernements, les instances internationales et les individus eux-mêmes, qui font ici le choix de confier leurs données et leurs économies à des « partisans de l’économie du don ». Les négociations de Mary la conduisent enfin à discuter avec les grandes entreprises pétrolières qui ne sont plus vouées aux gémonies, mais convaincues d’utiliser leurs infrastructures pour pomper du dioxyde de carbone et l’enfouir au fond de leurs puits abandonnés (chapitre 54). Le Ministère du futur imagine par conséquent une double révolution, l’une menée par la voie de la violence spectaculaire, l’autre décrite, dans l’un des dialogues socratiques qui parsèment le roman, comme une révolution « invisible », « technique, légale » (chapitre 99) :
Pas de révolution totale, pas de semaines de dix jours, pas d’euphorie révolutionnaire tentant de tout changer d’un coup. Rien que des ajustements dans la notion de propriété. Des chiffres. Des graphiques. Des inversions dans l’échelle des valeurs. Quelques improvisations. Le soleil continuait de se lever et les plantes de pousser. Mais les gens se vautraient dans les idées, donc l’ambiance était quand même folle malgré la présence rassurante du soleil ; ce printemps-là, joie et panique se mêlaient. (chapitre 75)
Cette éthique du petit pas n’est pas l’apanage des diplomates : elle caractérise aussi le projet « Ralentir » mené par les glaciologues en Antarctique et au Groenland avec le soutien du Ministère. Elle consiste à pomper l’eau de fonte logée sous les glaciers pour la projeter à la surface, en particules assez fines pour qu’elle gèle immédiatement. Comme le note l’un des artisans du projet : « C’est comme repeindre le pont du Golden Gate encore et encore. Plein de choses fonctionnent comme ça. La maintenance ne s’arrête jamais. […] Quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire, point final. Arrêtez de parler des coûts comme si c’est réel. L’argent n’est pas réel. Seul le travail est réel. » (chapitre 29).
Ces révolutions invisibles, faites de gestes en apparence minuscules, finissent par porter leurs fruits. À la veille de la COP58 (soit en 2052), le taux de dioxyde de carbone dans l’air a baissé, tandis que le monde de la finance a subi un assainissement général, aboutissant à la création d’une « démocratie directe de l’argent » (chapitre 89) et à la disparition des paradis fiscaux (n’oublions pas que le roman, baignant dans l’Alpenglow, se déroule largement en Suisse). Les changements exigés sont parfois radicaux : les porte-conteneurs détruits par des missiles-nuées ont été remplacés par des bateaux à voiles photovoltaïques, les avions par des dirigeables inspirés des romans de Jules Verne, tandis les petites villes dortoirs ont été rendues à la nature, leurs habitants recevant une indemnité substantielle pour rejoindre les grandes villes (chapitre 87). La création d’un « bon Anthropocène » est engagée, et Mary Murphy peut sereinement envisager sa retraite, contemplant comme un heureux augure la statue de Ganymède qui se dresse sur les bords du Zürichsee :
Que disait donc Ganymède ? Que l’humanité avait une chance de devenir un peuple magnifique, ou du moins intéressant. Que nous étions encore ce que nous étions au tout début : des enfants prodiges. Que nous n’avions pas d’autre foyer que celui-ci. Que nous allions nous en sortir malgré toutes nos bêtises. Que chaque couple était un drôle de couple. Que l’extinction était la seule catastrophe irréparable. Que nous pouvions faire du monde un bel endroit. Que les gens devaient prendre leur destin en main. Que le destin n’existait pas. (chapitre 106)
Cette image optimiste contraste fortement avec un autre souvenir de l’ex-dirigeante du Ministère, qui nous renvoie au contraire, avec une saisissante justesse, à l’absurde irresponsabilité de nos comportements quotidiens :
Mary se rappelait son dernier vol entre Londres et San Francisco, survolant le Groenland à midi, sans un nuage, la grande banquise aussi hostile que Titan ou Callisto, et tous les passagers, hublots baissés, regardant des films. Mary avait observé en alternance le paysage et les autres passagers avec fatalisme. Les êtres humains étaient foutus, avait-elle songé, trop bêtes pour survivre. Vainqueurs incontestés du prix Darwin. En route vers une mort minable. (chapitre 100)
À rebours de tout fatalisme, le roman de Kim Stanley Robinson invite donc à l’espoir et plus encore à l’action – sans exclure tout à fait, ainsi qu’on a essayé de le montrer plus haut, ses modalités les plus radicales. Le Ministère du futur marque à ce titre une inflexion significative dans la carrière de l’auteur : connu pour sa trilogie martienne, dont l’action se déroulait peu ou prou à la même époque, Robinson semble ici avoir fait vœu de revenir à la Terre, ou « d’atterrir » comme l’écrivait Bruno Latour. En donnant la voix à des personnages (migrants, réfugiés climatiques, propagandistes célébrant l’Inde moderne…) et à des entités diverses (du marché au photon en passant par la blockchain), il s’essaie lui-même à créer dans les pages de son roman un écosystème équilibré, où la voix de l’homme ne soit pas écrasante : on pourra s’étonner cependant de ne pas trouver un seul chapitre narré par un animal ou par une entité géologique à la façon des Parlements imaginés par Camille de Toledo. Plus encore, ainsi que le note très justement Bill McKibben dans The New York Review, Le Ministère du futur « n’est pas de la science-fiction ». Non que l’auteur, par souci de didactisme ou d’engagement, en vienne à négliger les ressources de la fiction : dans un très bel entretien donné à la revue En attendant Nadeau, Robinson souligne au contraire l’importance du principe de plaisir dans sa conception de la littérature. Son dernier roman n’invente pourtant rien qui n’existe déjà ou ne soit sur le point de voir le jour : ni les catastrophes annoncées, ni les solutions possibles (les modèles offerts par la communauté autonome de Mondragón, par la province indienne du Kerala, les principes de la théorie monétaire moderne ou TMM, etc.) n’appartiennent au domaine de l’imaginaire. C’est bel et bien notre monde qui se trouve décrit là par un auteur qui devient ainsi lui-même, à sa façon, « ministre du futur ». Tâchons donc de l’entendre tant qu’il en est encore temps et prenons pour boussole la magnifique énigme qu’en disciple fidèle de Frederic Jameson, dédicataire de ce texte, il consacre à l’Histoire :
Tout le monde me connaît mais personne ne peut me raconter. Personne ne me connaît même si tout le monde a entendu mon nom. Si tout le monde parle ensemble, cela donne quelque chose qui me ressemble mais n’est pas moi. Toutes les actions de tout le monde me construisent. Je suis le sang dans les rues, la catastrophe impossible à oublier. Je suis la marée à l’œuvre sous les fondations du monde, que personne ne voit ni ne sent. Je me déroule au présent mais ne suis contée que dans le futur, où l’on pense alors parler du passé sauf que l’on ne parle, encore et toujours, que du présent. Je n’existe pas mais je suis tout. Voilà, vous me reconnaissez. Je suis l’Histoire. Faites-moi belle. (chapitre 77)
Ninon Chavoz - Configurations littéraires