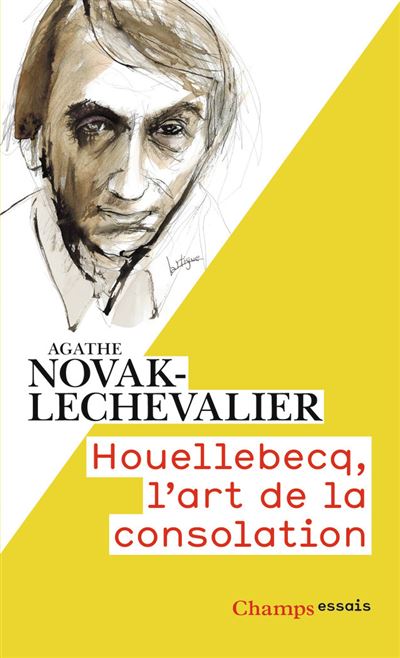Certains lecteurs pourront se demander si un auteur comme Michel Houellebecq a sa place, autrement que comme un contre-exemple, dans un dictionnaire consacré aux rapports entre éthique et arts. L’actualité littéraire du romancier français le plus lu au monde semble en effet avoir définitivement soldé la lecture qui avait pu, à ses débuts, faire de Houellebecq le représentant d’une nouvelle école du réalisme social, plutôt marquée à gauche même si l’auteur préférait, à la France des ronds-points et des gilets jaunes, celle des fichiers .xls et des anoraks, un monde de petits employés et de classes très moyennes qui constituent les laissés-pour-compte de la mondialisation des marchandises et des êtres. Ainsi, l’œuvre de l’auteur vient de s’enrichir d’un court texte autobiographique, Quelques mois dans ma vie. Octobre 2022 – mars 2023 (Flammarion, 2023), qui revient sur deux épisodes récents par lesquels il a, à nouveau, défrayé la chronique. Le premier ajoute une nouvelle touche au portrait de l’auteur en critique de l’Islam qui se dessine depuis le roman Soumission (Flammarion, 2015) et qui lui a fait intégrer, aux côtés de Yann Moix et Sylvain Tesson, le triumvirat de « l’extrême-droite littéraire », selon l’expression de François Krug dans Réactions françaises(Seuil, 2023) : lors d’un entretien avec Michel Onfray, que ce dernier a refusé de corriger lorsque l’auteur lui en a fait la demande, Houellebecq a en effet agité le chiffon rouge politique qui consiste à assimiler émigration et délinquance. Le second touche à une sordide déconvenue personnelle : l’écrivain de la misère sexuelle s’est retrouvé à jouer malgré lui dans un film à caractère pornographique, piégé – selon sa version – par un vidéaste véreux. Au-delà du caractère choquant ou ridicule des faits, c’est l’importance très dissymétrique que Quelques mois dans ma vie accorde à ces deux événements qui pose problème : si l’écrivain regrette amèrement d’avoir été l’objet, pour ses prises de position publiques, de ce qu’il considère comme un déchaînement médiatique infondé, il se concentre essentiellement sur l’épisode intime, qu’il vit comme une persécution personnelle. Sans s’excuser de ses propos, mais surtout fuyant la sphère du discours politique au profit de la lamentation sur des malheurs qui ne concernent que lui, c’est ici le Houellebecq metteur en scène de sa propre déchéance que l’on retrouve, loin de l’engagement à porter la voix des plus humbles que certains avaient cru déceler chez lui.
Mais c’est précisément dans ce contexte qu’il peut être utile de revenir à d’autres lectures possibles de l’œuvre de Houellebecq. Et parmi celles-ci, c’est sans doute l’ouvrage d’Agathe Novak-Lechevalier, Houellebecq et l’art de la consolation, qui prend le plus le lecteur récalcitrant ou échaudé à rebrousse-poil : Houellebecq, écrivain « déprimiste » ou « décliniste », au réalisme étriqué, à la perspective fataliste sur l’évolution du monde, aux intrigues marquées par la misogynie et la haine des autres, serait en réalité un écrivain de la « consolation ». Et ce serait même son intransigeance en la matière – laquelle lui fait récuser tout crédit à la « réparation » que promettent parfois les romanciers – qui occulterait, selon la critique, la croyance idéaliste en l’homme et en la littérature que Houellebecq maintient et entretient à sa manière. De manière significative, l’essai d’Agathe Novak-Lechevalier date de 2018, soit un an avant la publication de Sérotonine, roman dont le titre renvoie à l’hormone de la régulation de l’humeur, de l’anxiété et de la dépression : contre une vision contre l’idée si répandue en « happycratie » (Eva Illouz, Edgar Cabanas) qu’il existe une pilule du bonheur, l’œuvre de l’écrivain explorerait la ligne de crête qui consiste à faire un tableau sans concession du monde en en cartographiant méthodiquement les défauts, les injustices et les manques, pour mieux activer chez le lecteur la soif d’autre chose, même si cette espérance ne pourra sans doute prendre consistance que dans l’espace littéraire.
À cet égard, Agathe Novak-Lechevalier tient à réinscrire Houellebecq, dont elle rappelle qu’il est un lecteur vorace et un fin connaisseur de l’histoire de la littérature et de la philosophie, dans la tradition consolatoire qui, depuis l’Antiquité, dispose de ses règles et de ses méthodes pour apporter du réconfort à autrui. Or, de manière contre-intuitive pour les contemporains en quête d’efficacité, qui veulent voir leur souffrance se dissiper au plus vite, ce modèle classique ne fait pas de fausses promesses, mais propose une méditation sur le malheur et un accompagnement par les lettres : il n’est guère surprenant, dit la critique, que la célèbre consolation écrite en 1599 par le poète François de Malherbe à son ami Du Périer après la mort de la petite fille de ce dernier (« Et rose elle a vécu ce que vivent les roses / l’espace d’un matin. ») ait disparu des syllabi scolaires, puisqu’elle offre d’accepter le destin, qu’elle se contente de manifester son amitié et son empathie, sans promouvoir de grande révolte contre l’injustice du sort, ni produire de compensation immédiate. Pour lire Houellebecq, il faut garder en tête cet horizon consolatoire qui nous est devenu si peu familier : la noirceur que ses romans exsudent est la garantie éthique de ne pas égarer autrui en lui faisant miroiter un monde qui n’existe pas, et elle a pour corollaire l’assurance que ce monde-ci, a priori décevant, pourra être arpenté, cadastré en compagnie d’une âme compatissante, celle de l’écrivain.
Car, contre les lectures qui font de Houellebecq un écrivain de la dissension et de la rancœur, la critique souligne que l’horizon de son écriture est de resserrer les liens. Elle décèle sous le style réputé plat et pauvre de l’auteur une stratégie de mobilisation amicale et douce du lecteur : dans cette œuvre romanesque qui fourmille de doubles de l’écrivain, le lecteur est incité à voir l’homme derrière la figure de papier du personnage ; au sein d’une écriture apparemment blanche, marquée par un renoncement ascétique au vouloir-vivre de type schopenhaurien, l’humour ressurgit régulièrement pour forger une communauté d’un côté et de l’autre de la page. Mais c’est sans doute dans l’œuvre poétique que cet appel est le plus présent : « montre-toi, mon ami, mon double… » dit un des vers de l’auteur, qu’Agathe Novak-Lechevalier propose comme épigraphe à l’ensemble de son œuvre. De manière très baudelairienne, la poésie houellebecquienne interpelle souvent le lecteur pour en faire un frère, lui proposer une entraide mutuelle et la restauration de contacts que la modernité rendrait plus rares ou plus médiocres. Là où le roman enquête sur « la possibilité d’une île », c’est-à-dire d’une disparition totale des relations humaines, la poésie leur offre un refuge : la création de Houellebecq doit impérativement, rappelle la critique, s’appréhender à travers ce diptyque, qui ménage de surcroît de nombreuses zones de passage où l’espoir d’un monde revivifié perce jusque dans les pages des romans.
Lire les textes de Houellebecq comme une œuvre permet aussi de repenser ce que peut, selon lui, la littérature – c’est-à-dire pas tout, puisqu’il ne s’agit pas d’effacer ce que le réel peut avoir de dérangeant, mais malgré tout beaucoup, car l’espace littéraire, hanté par ce désir d’établir des liens avec le lecteur, devient alors le lieu où l’idéal reste vivant et vivace. Parce qu’il existe comme poumon de l’idéal, en particulier si on a la poésie de Houellebecq en ligne de mire, il contrecarre l’interprétation pessimiste de l’œuvre et réintègre, d’après la critique, l’écrivain contesté dans le panthéon des grands auteurs qui ont, comme Dostoïevski dont il est un lecteur passionné, « voulu guérir » (E-M. de Vogüé). Mais pas guérir n’importe quoi, à n’importe quel prix : guérir en connaissant le prix de la perte et en sachant que seule la relation établie à travers le livre peut vraiment y opposer une forme de résistance.
Bien sûr, on pourra opposer à l’autrice, malgré sa démonstration brillante et sa parfaite connaissance de l’œuvre, que ce lecteur désiré par Houellebecq n’est pas toujours au rendez-vous que lui propose l’écrivain. La réception de Houellebecq en bonne part se fait souvent chez des lecteurs soucieux d’entretenir leur diagnostic mélancolique sur le monde ; quant à ses antagonistes, cette part idéale, ténue, voire imperceptible leur semblera relever du saut de la foi au sein d’un univers houellebecquien où la violence, le sexe et la mort jouent un rôle régulateur – autant de signes frénétiques, dirait Schopenhauer, que l’auteur n’a pas vraiment troqué son vouloir-vivre contre une forme de paix intérieure. De fait, quand bien même elle structurerait la sphère poétique et théorique et aurait pour destin de se réaliser au sein du corpus romanesque, sa dissymétrie mathématique avec la prose du monde, voire la fange du réel qui garnit les romans de l’auteur, peut continuer à alimenter une lecture pessimiste, voire désespérée de l’œuvre. On retrouve ici l’ambivalence des pensées philosophiques de la consolation : elles ne proposent pas des expériences heureuses, mais imaginent comment traverser les catastrophes grâce à une forme de renoncement. Mais cette difficulté ne rend que plus visible la dimension éthique de l’exercice critique ici à l’œuvre, et qui consiste à donner sa chance à une œuvre piégée par des discours sociaux et littéraires qui la dévalorisent ou la font dévier vers des lectures uniquement conservatrices – sans pour autant exiger du lecteur qu’il suive la piste ouverte par l’essai : à l’issue de la lecture, certains seront convertis et ne regarderont plus jamais un anorak de la même manière – les autres pourront tranquillement continuer à détester Houellebecq.