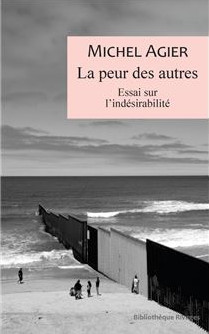Michel Agier, La peur des autres. Essai sur l’indésirabilité, Paris, Payot & Rivages, 2022
Le titre de l’ouvrage le suggère : Michel Agier conjugue ici ses réflexions sur le rapport à l’étranger et sur les peurs « en général » en focalisant le regard sur la notion d’indésirabilité, dans laquelle paraissent se cristalliser les dérèglements du monde. Elle est, semble-t-il, aussi bien l’expression d’un rapport immédiat à l’Autre que l’enjeu d’une politique de l’enfermement, et s’exprime donc du niveau global jusque dans les vies individuelles. La frontière en est la notion connexe, dans une dynamique de cocréation réciproque. Partant de l’expérience de la pandémie, qui a révélé la prégnance des peurs dans le monde contemporain, Agier distingue deux formes d’individualisme. Sur la toile de fond d’un capitalisme débridé sur lequel il revient régulièrement, il y a la « valorisation de soi » à laquelle chacun est invité et/ou contraint, dans une idéologie de la concurrence. Mais il y a aussi son pendant négatif : l’individu nu, dépourvu de ressources et de liens sociaux, mis au ban physiquement et socialement. Dans cette nouvelle condition humaine de la « vie liquide » (selon le concept de Zygmunt Bauman) la peur, « qui s’installe d’abord au creux des subjectivités dépersonnalisées » (p. 26) constitue un dénominateur commun, sans qu’il s’agisse bien sûr de mettre sur le même plan les héros/héraults et les victimes du capitalisme. Dépersonnalisée – dans le sens anthropologique d’une perte tant des liens traditionnels que d’une protection par l’État – le sujet semble hanté par « le fantasme de la vie nue » (p. 30) favorisant ainsi la convergence du sécuritaire et de l’immunitaire. Il s’agit, avant toute chose, de se protéger d’un extérieur, sentiment diffus mais perpétuellement réactivé, tant par le surgissement de l’inattendu que par les gouvernements, qui, par l’exercice même de leur pouvoir, tentent de réaffirmer la nécessité de leur existence à l’heure où la globalisation (économique, sociale, migratoire) la remet en cause. L’immunité n’est plus seulement sanitaire, mais devient un rapport apeuré au monde. Si la première nécessitait des « gestes barrières », l’obsession de la seconde engendre la démultiplication des frontières et l’indésirabilité de tout intrus – ce dont le traitement de la « crise » migratoire constitue l’expression la plus manifeste. Reprenant sa distinction entre les trois formes de peur, Michel Agier, empruntant à Tzvetan Todorov, Achille Mbembe ou Ghassan Hage, y ajoute ici une peur « postcoloniale », peur du ressentiment des peuples anciennement asservis nourrissant le fantasme de l’invasion de l’Europe. Face à cette prétendue menace, la réaction est « l’encampement comme une manière de gouvernement par la “pacification” et la séparation […] » (50). Il faut remarquer ici le glissement sémantique qui s’opère au sein même de la pensée de l’anthropologue. Si le terme désigne ailleurs – par exemple dans l’ouvrage Gérer les indésirables (2008) – une politique de « distribution des ‘populations’ » par les camps et les murs (« L’encampement du monde », Plein droit, n°90, 2011, p. 21-24, ici p. 23), il semble peu à peu dire, plus largement, un rapport national, mais aussi individuel et collectif au monde contemporain. La condition de réalisation de cet encampement est la frontière, « violente », à propos de laquelle Agier invoque l’image du Gouffre qu’Édouard Glissant utilise pour dire l’expérience de l’esclavagisme. La frontière ne stoppe pas les migrants, elle les engloutit. On pense ici aux drames en Méditerranée, dont l’auteur rappelle les chiffres ; mais ce gouffre est aussi celui de toutes les morts, de toutes les disparitions et de toutes les invisibilisations. L’indésirabilité est donc, au sens propre comme figuré, mortifère. Où y trouver des alternatives ? Partant de l’exemple de Patrick Chamoiseau, l’auteur, reprenant le fil laissé dans son ouvrage précédent, voit la possibilité d’autres récits dans les créations littéraires et artistiques. Non pas les écritures de l’exil – même si celles-ci doivent exister – mais les « écritures empathiques » (p. 63) qui « cherche[nt] les vraies vies, ordinaires et tragiques, qui se trouvent derrière le rideau mortuaire fait de violence, d’abandon et d’anonymat » (p. 65). Tout comme l’auteur lui-même, en collaborant à divers projets théâtraux, a fait converger la science et l’art, de telles productions culturelles accompagnent d’autres engagements – sociaux ceux-là. Au regard de la production artistique contemporaine, on serait tenter d’ajouter à cette fonction de dessillement la critique, par le traitement du langage, de la rhétorique dominante de la peur et de l’indésirabilité, telle que la pratique par exemple avec force l’auteure autrichienne Elfriede Jelinek, prix Nobel de littérature en 2004, dans une pièce comme Les suppliants (L’Arche éditeur, 2016 / Original : Die Schutzbefohlenen, 2013). S’il évoque la nécessité de ces récits et quelques exemples, l’auteur ne suit pas pour autant cette piste de réflexion. Pour mieux comprendre ce que recouvre l’indésirabilité, il s’agit d’en retracer l’histoire pour montrer ce qu’elle est réellement : un fait politique. Elle est politique, tout d’abord, parce qu’elle est une relation fondamentalement dissymétrique – où l’on retrouve la dissymétrie inhérente à l’hospitalité, mais cette fois sous une forme pervertie. Elle l’est aussi parce que, loin d’être un état, elle se manifeste dans des « situations d’indésirabilité » (toutes formes d’espaces et de lieux concrets où sont rassemblés les « indésirables »). Elle l’est enfin au regard de l’histoire de son usage, récemment retracée par les historiens. Utilisé dans divers pays dès le XIXe siècle pour désigner des minorités ethniques, elle devient une « catégorie d’action publique » (p. 81) au fil du XXe siècle, et les objets de son usage se diversifient : l’indésirable est aussi « l’immigrant pauvre, invalide, juif ou non blanc », « l’espion, le malfaiteur, le vagabond ». Cette absence de définition est en réalité la condition même de son opérabilité : jusque dans les politiques urbaines actuelles, qui refoulent des pans entiers de population, l’indésirabilité est une construction intimement liée à l’exercice d’un pouvoir. Sur le double critère d’une prétendue nuisance et d’une prétendue menace, elle s’exprime dans ce qui, avec l’encampement, semble devenir la marque d’un rapport au monde : le tri. Les pratiques de screening dans les camps de réfugiés et les centres d’accueil, soudain, deviennent le paradigme du contemporain.
Face à l’entretien politique, économique, médiatique des récits de l’indésirabilité, l’auteur oppose tout d’abord la nécessité d’un courage devant aller à rebours des peurs ressenties par chacun. Il faut aussi inventer de nouveaux épouvantails. Mais il s’agit surtout, pour échapper à l’obsession immuno-sécuritaire, d’accepter « l’incomplétude de l’humain » (p. 92), de reconnaître l’impossibilité fondamentale de la vie sans relation. S’il fait ici référence une fois encore à Todorov, la pensée d’Agier semble également croiser celle de Roberto Esposito – auquel il fait brièvement référence ailleurs dans l’ouvrage – qui repense la communauté non pas sur la base d’un surcroît partagé, qu’il soit matériel ou immatériel, passé ou en devenir (une religion, une nation, une utopie politique…) mais au contraire d’un manque : sa « communitas » est au contraire définie à partir de l’étymologie du mot munus, qui désigne un don obligatoire, « le don que l’on donne, pas celui que l’on reçoit [… ] tout entier orienté dans l’acte transitif qui conduit à donner », et qui est donc « une perte, une soustraction, une cession » (Roberto Esposito, Communitas. Origine et destin de la communauté, Presses Universitaires de France, 2000, p. 18). Pour illustrer la possibilité de cette « vie commune », Agier convoque des notions puisées dans ses terrains : le zumunci, qui désigne en langue haoussa aussi bien l’accueil que la dépendance de celui qui est hébergé, et la terenga, en wolof, qui dit une relation similaire, « évoquent une réciprocité qui prend la forme immédiate d’une dépendance et peut aller jusqu’à se prolonger en un cycle de don et de contre-don » (p. 96). Le concept d’ubuntu, usité dans les populations bantoues, rappelle sur un plan plus global « le principe de l’indispensable vie commune en même temps que celui de l’identité générique de tout humain sur la planète […]. C’est le principe d’une vie bonne [c’est nous qui soulignons] qui doit être autant collective qu’individuelle » (p. 96-97). La pensée anthropologique, on le voit, puise « ailleurs » la source d’une possible éthique du rapport au monde et à l’Autre. Ainsi – et il le suggère à demi-mots – l’auteur semble-t-il par sa pratique réflexive fournir un exemple d’une « méthode cosmopolitique » (p. 97) fondée une fois encore sur le décentrement.
Emmanuel Béhague - Professeur au Département d’études allemandes