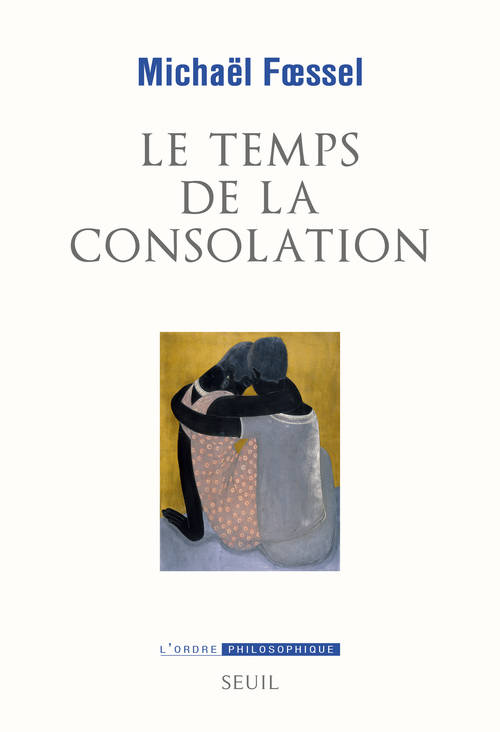« La philosophie moderne a abandonné la consolation, d’une part à la religion, de l’autre à la psychologie » (p. 11). C’est en dépit du discrédit philosophique dont la modernité a frappé la pratique consolatoire, soupçonnée d’être anachronique sinon stérile, que Michaël Fœssel entend penser la consolation à partir des instruments de la philosophie. Non que son propos soit de renouer avec la vocation consolatrice dont était investie la philosophie selon Platon, les stoïciens et plus encore Boèce. L’auteur soutient en revanche non seulement que la consolation est un sujet d’investigation philosophique majeur, mais, bien plus, que certaines « catégories maîtresses » de la philosophie témoignent, au prix d’inflexions subtiles, d’une paradoxale « permanence » du projet consolatoire (p. 218). En déjouant dès l’introduction le piège des injonctions au deuil réussi, qui ravaleraient la perte au statut de non-événement, l’auteur propose une passionnante enquête sur des affects (le chagrin, le deuil, ce revers de la consolation qu’est la désolation), sur des pratiques (philosophiques, littéraires, sociales), sur des figures (l’inconsolé, qui reste en droit réceptif au discours consolatoire ; l’inconsolable, qui – à l’instar d’Électre ou Niobé – refuse de se détourner de l’affliction).
La bipartition de l’ouvrage découle naturellement du constat initial : « l’abandon par le savoir moderne du projet de consoler », qui constitue un « événement philosophique à part entière » (p. 162). Après avoir rendu compte, dans leur grandeur et leurs paradoxes, des théories anciennes de la consolation, l’auteur analyse le malaise dans la consolation qui force les Modernes à inventer de nouvelles ressources pour affronter la désolation. Michaël Fœssel défend en effet l’historicité du concept de consolation, même s’il reconnaît la difficulté qu’il y aurait à dater la rupture entre le discours, hérité de l’Antiquité, qui célèbre les pouvoirs consolateurs de la raison, et le discours moderne qui tient les consolations d’autrefois pour inopérantes (p. 166). Comment la perte dont le sujet peine à se consoler a-t-elle pu aussi devenir celle de l’idéal de consolation lui-même ?
La première partie s’intitule « Grammaire », au sens où la consolation, qui fut un genre littéraire et philosophique à part entière, obéissait à des codes rhétoriques spécifiques. Ces pages donnent lieu à de belles réflexions sur l’acte consolateur comme « acte social » (p. 46) ou sur le rapport au temps (choix du moment opportun, vertu de l’écoulement temporel, articulation entre temps intime et temps social) induit par le discours de consolation. On retiendra l’une des thèses fortes de l’ouvrage, à savoir le fonctionnement métaphorique de la consolation. L’auteur, en s’appuyant sur les travaux de Ricœur, soutient que la consolation, comme la métaphore, fraie une voie entre « le sens littéral de la souffrance » et « un autre sens qui doit permettre au malheureux d’établir un rapport inédit avec lui-même » (p. 87). La consolation vise à superposer plusieurs univers référentiels de façon à éclairer l’expérience – ici celle de la souffrance – sous un jour nouveau. Elle requalifie le réel sans le trahir, en ménageant vers lui un accès autre qui reconfigure ce qu’il a de trop blessant. Si la deuxième partie commence par porter sur la « parole perdue », c’est au double sens du mot : discours et promesse. Après avoir envisagé les opérateurs modernes de la consolation que sont le progrès (notamment dans la philosophie kantienne de l’histoire) et la représentation (au sens de suppléance qui, à défaut de rendre effectivement l’objet perdu, le restitue symboliquement), l’auteur introduit en fin d’ouvrage un concept qu’il distingue de la consolation : celui de réconciliation. Dans la mesure où la réconciliation serait « le projet philosophique, mais aussi politique, de triompher de ce que l’on a perdu » (p. 268), elle permet de s’assimiler autrement la perte, en évitant l’écueil de la résignation et de l’abdication.
Le penseur par excellence de la réconciliation est Hegel, auquel une partie du dernier chapitre est consacré. De façon plus large, on peut apprécier la diversité du compagnonnage philosophique dans cet essai qui articule philosophie générale et histoire de la philosophie. Spécialiste de Kant, Michaël Foessel étudie le statut consolateur de l’espérance rationnelle dans la Critique de la raison pratique et l’Idée d’une histoire universelle. Il s’appuie sur Blumenberg, « un des rares penseurs contemporains à prendre la consolation au sérieux » (p. 10) et commente, pour distinguer consolation et guérison, telle phrase inspirante de Simmel sur la consolation qui « laisse certes subsister la souffrance, mais supprime pour ainsi dire la souffrance de la souffrance, n’atteint pas le mal lui-même, mais son reflet dans l’instance la plus profonde de l’âme » (p. 45). Peut-être peut-on ponctuellement nuancer certaines lectures : il est douteux que, chez Pascal, « l’individu se divertit pour autant qu’il refuse de s’envisager comme un être inconsolable » (p. 139), dans la mesure où le sujet qui fuit dans l’extériorité est inconscient des raisons profondes qui lui font rechercher le tracas plutôt que le repos. L’opposition entre la consolation qui affronte la perte et le divertissement qui se contente de l’esquiver (p. 28) est en tout cas l’une des nombreuses distinctions à la lumière desquelles l’auteur identifie le propre de la consolation.
L’ouvrage comporte de suggestifs « intermèdes », centrés notamment sur des figures mythologiques et littéraires : Électre, Niobé, Faust. La part des œuvres littéraires, de façon générale, est grande, qu’il s’agisse de textes canoniques (la « Consolation à Du Périer » de Malherbe) ou moins attendus. Les analyses de l’auteur peuvent trouver une résonance dans la mémoire livresque de ses lecteurs : on pense à Andromaque, grande figure d’inconsolable chez Virgile, Racine et Baudelaire ; à propos de « l’inconsolable qui rêve d’un temps statique dans l’existence, ce qui lui donne l’aspect d’un mort qui serait survécu » (p. 81), il est loisible de songer à Miss Havisham, qui dans De Grandes Espérances fait arrêter toutes les horloges à l’instant précis où son cœur s’est brisé. La page saisissante où Céline pastiche la lettre de consolation envoyée par Montaigne à sa femme fait office de pivot entre la première et la deuxième partie de l’ouvrage, bien que les analyses de Michaël Fœssel sur la « fraternité dans l’impuissance » des deux auteurs (p. 169) puissent être discutées (Jean Vigne, Exercices de rhétorique, « Sur la consolation », 2017). Au-delà de ce dialogue avec les œuvres, l’auteur de ce beau livre donne plus largement à penser sur les pouvoirs de la littérature. Outre qu’il envisage la consolation sur le modèle de la métaphore, il insiste en effet dans le dernier chapitre, en se réclamant de Karen Blixen citée par Hannah Arendt, sur la valeur consolatrice du récit, qui « met la tristesse en intrigue » : « en proposant une narration de ce qui semble figé hors du temps, le consolateur invite son destinataire à fictionnaliser sa propre existence, et cela jusqu’au point où son présent ne lui apparaîtra plus comme une fatalité, mais comme une variante réalisée au milieu d’une multitude d’autres possibles » (p. 295).