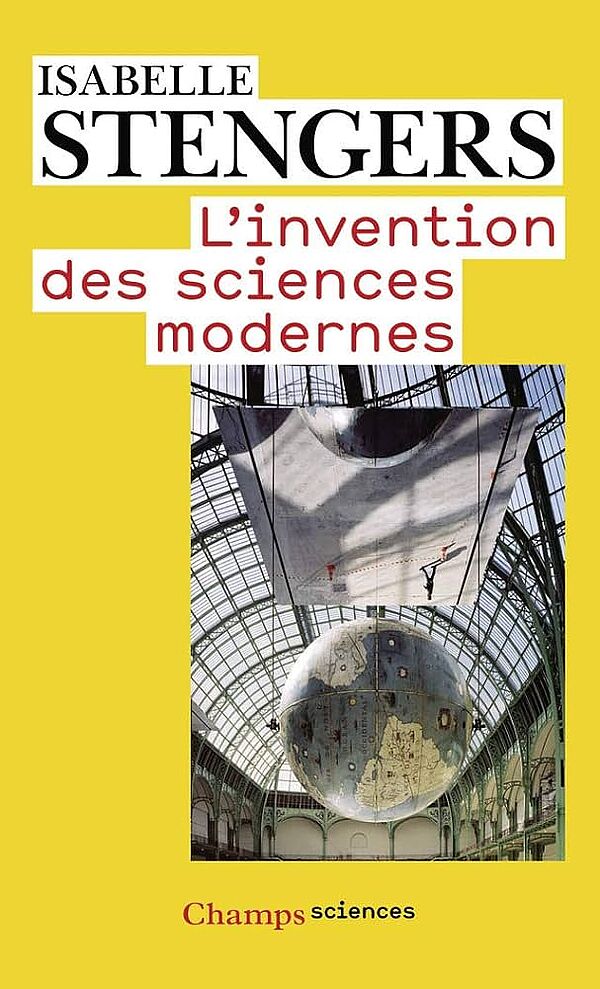Plus complexe que les autres livres de l’autrice, L’invention des sciences modernes a pour objet l’invention d’une posture. Écrivant dans un contexte de tension entre les sociologues des sciences et les scientifiques qu’ils prétendaient étudier, Isabelle Stengers se place dans la lignée des travaux de Bruno Latour, auquel est dédié le livre, mais elle suggère de changer la manière dont se déroule la discussion. Alors que Bruno Latour cultivait volontiers une forme de provocation, Stengers se fixe comme but d’étudier la science sans braquer les scientifiques, en suivant le principe controversé de Leibniz : « respecter les sentiments établis » (p. 24). L’enjeu serait de trouver une façon de décrire l’activité des gens de science dans laquelle ils puissent eux-mêmes se reconnaître, sur le modèle des films documentaires de Jean Rouch, qui intègrent les réactions des personnes filmées à leur propre représentation (p. 70).
Dans cette perspective, Isabelle Stengers commence par enquêter sur ce qui permet aux scientifiques d’opérer le « grand partage » entre la science et la non-science. L’enjeu est triple : comprendre ce qui définit la science ; comprendre pourquoi les scientifiques réagissent aussi violemment lorsqu’on essaie de flouter cette ligne de démarcation ; et se donner les moyens de questionner les autres « partages » qui en découlent, comme la séparation entre humains et animaux ou entre sociétés avancées et sociétés traditionnelles. Pour cela, la philosophe se lance dans une discussion serrée de la « tradition démarcationniste » (p. 44), c’est-à-dire des épistémologues qui ont proposé des critères pour différencier la science et la non-science. Les deux premiers chapitres examinent ainsi dans le détail les thèses de Karl Popper, d’Imre Lakatos, de Thomas Kuhn et de Paul Feyerabend afin de montrer leurs limites. Isabelle Stengers se rapproche des conclusions de Bruno Latour qui, dans Les Microbes. Guerre et paix (1984), avait montré qu’aucun critère épistémologique n'était capable d’expliquer pourquoi telle position scientifique triomphait aux dépens de telle autre lors d’une controverse. Ce ne sont pas les scientifiques qui raisonnent le mieux ou qui sont les plus méthodiques qui voient leurs idées s’imposer, mais ceux qui parviennent à trouver des « alliés » dans la société en intéressant d’autres groupes sociaux à leur objet d’étude. Isabelle Stengers ajoute l’idée que la référence à l’histoire est cruciale pour apprécier la scientificité d’une thèse : on finit toujours par juger après-coup, au nom du progrès, que la thèse qui a triomphé était de la « vraie science ».
À partir de ce constat, Isabelle Stengers estime qu’il ne s’agit donc plus tant de « faire l’histoire des scientifiques » que de « faire histoire avec les scientifiques » (p. 123), c’est-à-dire de comprendre comment ceux-ci s’y prennent concrètement pour créer des faits résistants. En revenant sur l’exemple séminal de Galilée, et en analysant de près son dialogue entre trois personnages fictifs, Salviati, Sagreo et Simplicio, Stengers montre que la « science moderne » se définit par sa capacité à faire taire le détracteur qui dirait : « ce n’est qu’une fiction ». L’instauration d’une scène expérimentale vise ainsi à « faire parler les faits » d’une façon qui fasse taire les fabulateurs (p. 97). Grâce à un détour inattendu par le conte des trois petits cochons (p. 179), Isabelle Stengers précise alors sa position par rapport aux sciences. Il ne s’agit pas de nier que les « faits » construits par les scientifiques résistent bel et bien à l’épreuve du réel, comme le fait la maison de pierre comparée aux maisons de paille et de brindilles des petits cochons. Cependant, admettre cette spécificité des sciences n’empêche pas de poser d’autres questions : « ne serait-il pas possible d’inventer d’autres rapports avec le loup ? De quoi dépend la définition du loup en tant que menace […] ? » (p. 179).
Cette posture, qui reconnaît à la fois la singularité des sciences et le fait qu’elle est prise dans un contexte historique et social, Isabelle Stengers l’appelle « humour », et lui donne comme modèle le rapport de Diderot au mathématicien D’Alembert dans Le Rêve de D’Alembert (p. 128). Dans deux pages cruciales de l’ouvrage, Stengers définit l’humour comme « la capacité de se reconnaître soi-même produit de l’histoire dont on cherche à suivre la construction » (p. 79) et oppose cet « art de l’immanence » à la posture de l’ironiste, qui ne s’en laisse pas conter, et qui se prétend supérieur à ceux qu’il juge.
Sur la base de cette posture, les derniers chapitres de l’ouvrage avancent alors quelques propositions plus concrètes. Isabelle Stengers propose ainsi de maintenir la distinction entre le sujet et l’objet ainsi que le mythe du progrès mais en leur donnant un nouveau sens : l’objet doit être construit de manière à mettre le sujet à l’épreuve (p. 151), et la honte envers ce que nous avons cru, générée par la croyance au progrès, doit être utilisée comme une incitation à penser (p. 170-171). Enfin, la philosophe revient sur l’idée d’un « Parlement des choses », imaginé par Bruno Latour comme un lieu où les différents groupes sociaux intéressés par un même objet (les microbes, le trou de la couche d’ozone, etc.) pourraient débattre entre eux.
Lucien Derainne – Configurations littéraires