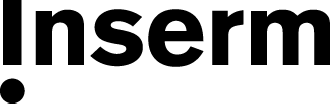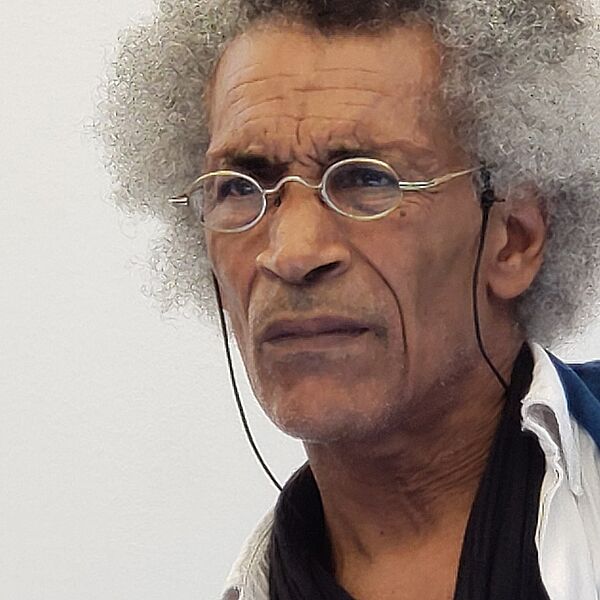Né en 1950 dans l’Aïr, massif montagneux du Niger, Hawad est un poète, romancier et peintre touareg. Révolté par la négation de l’autre, en particulier des Touaregs et plus généralement des Amazighs, l’auteur utilise sa langue, la tamajaght, pour libérer les êtres asservis et déshumanisés par les États qui les oppriment. Les titres de ses livres illustrent à la fois la situation funeste des Touaregs - Testament nomade (Sillages, 1987), Visions atomiques (Paris-Méditerranée, 2003), Dans la nasse (Non lieu, 2014), Fiel de cuivre (la rumeur libre, 2024) - et le dépassement de cette tragédie : Caravane de la soif (Édisud, 1985), Froissevent (Noël Blandin, 1991), Notre horizon de gamelles pour une gamelle d’horizons (Paris-Méditerranée, 2001).En refusant toute rhétorique de la plainte, Hawad construit une poétique du dépassement : vers le néant, la liberté et l’absolu.
Selon l’auteur, la seule possibilité pour l’individu de se libérer du joug des puissances étatiques est de s’amoindrir davantage, de pratiquer l’autodérision, et d’échapper alors au regard que le dominant pose sur le dominé. Son dernier livre paru en France, Fiel de cuivre, est construit sur ce modèle avec les trois parties : « Fiel de cuivre nous t’avons bu », « Fiel de cuivre tu nous as enivrés » et « Fiel de cuivre nous te vomirons ».
S’il est engagé, Hawad est aussi mystique. Il puise ses visions dans le soufisme touareg, chez les poètes soufis Hallaj, Rumi, Djami, ainsi que dans l’ésotérisme juif. Dans son œuvre, l’anéantissement est l’étape métaphysique indispensable pour atteindre l’absolu. Si cette dimension spirituelle est particulièrement sensible dans Caravane de la soif, elle est moins évidente pour le non-initié dans les autres textes. Car telle est la force de la poésie de Hawad : les niveaux de lecture se multiplient, les mots sont chargés de plusieurs sens et empruntent plusieurs directions, jusqu’à l’éclatement de la camisole qu’une lecture unilatérale voudrait leur imposer.
La Furigraphie, titre de l’anthologie parue dans la collection Poésie /Gallimard en 2017, est un concept forgé par l’auteur lui-même pour désigner l’ensemble de son œuvre. À l’origine, il s’agit du mot touareg zardazgheneb qui est intraduisible ; pour contourner cet écueil, Hawad allie dans un néologisme la furie et la graphie. La furie, pour « fureur », désigne chez l’auteur ce qui est volcanique, ce qui déborde sans joug, ce qui détruit toute restriction de parole et donc toute règle linguistique ; ainsi les vers du poète sont parfois abrupts, sans prépositions ou articles, dépouillés de la syntaxe classique. Les mots s’entrechoquent jusqu’à produire des sons et des sens inédits, un rythme effréné, un « halètement ». Quant à la conception du mot fureur à la Renaissance, liée à la subjectivité créatrice, Hawad en prend le contre-pied : la fureur est ce par quoi le poète terrorise le poème. L’éclair de l’inspiration qui le frappe, il le saisit, le transforme et le renvoie dans la poésie avec fracas, toujours avec l’idée d’aller contre. Non pour s’enfermer dans un pure opposition, mais pour se libérer de tout schéma et créer ainsi une nouvelle voix, la sienne. Cette fureur, il l’associe au mot « graphie » puisqu’elle est incarnée dans l’alphabet touareg et se manifeste dans ses calligraphies et ses toiles.
Les furigraphies sont écrites en tifinagh, l’alphabet amazigh préservé par les Touaregs depuis 3000 ans. Hawad est d’abord un érudit des mots, un véritable linguiste : il a fait évoluer la tamajaght en dehors de l’effort de préservation scientifique ou de toute habitude de langage qui signeraient la mort de cette langue. Par sa poésie, il fait vivre la tamajaght, il la met en mouvement. Cet effort de création linguistique se perçoit aussi dans la traduction française qu’il réalise avec l’aide de son épouse Hélène Claudot-Hawad, anthropologue et linguiste spécialiste du monde touareg.
Si l’écriture est le moyen pour l’auteur de dévoiler une vision de l’absolu, elle lui permet également d’échapper aux pouvoirs politiques. D’apparence inoffensive, la poésie semble bien dérisoire au regard des puissances militaires. Pourtant l’œuvre de Hawad est d’une violence singulière. Ses « gémissements », c’est le rythme des chèvres empoisonnées qui extériorisent le mal, « l’halètement », c’est la respiration des chauves-souris exilées que sont les Touaregs dans le désert, « l’insecterie », c’est tout peuple asservi, si nombreux, et si petit. Hawad se métamorphose, il est un vivant qui s’inspire des bêtes et de la nature pour trouver le rythme qui permet une émancipation totale de la mélancolie et de l’oppression. Ce rythme, cette poésie, il les nomme « le son du moustique face aux drones, aux tirailleurs, à la radioactivité, à la conquête, à l’écartèlement de Tamazgha ». Les poètes touaregs deviennent des aiguiseurs de sons de moustique, des « fourmis » qui inventent une insecterie révolutionnaire.
Cette disproportion entre l’apparente insignifiance de l’écriture et la violence exercée par les États sur les Touaregs met en évidence l’impuissance des dominés ainsi que la catastrophe humaine et écologique au Sahara. Elle pose aussi la question suivante : quand est-ce que ces petits sons renverseront la logique destructrice des puissances mondiales ? Une question qui non seulement reste sans réponse, mais à laquelle Hawad n’accorde pas d’importance : il lapide le silence du monde jusqu’à ne plus avoir de souffle, et des centaines de manuscrits dorment chez lui, non traduits. L’auteur n’est plus dans la résistance, mais dans l’endurance, car sa révolte dure depuis les essais atomiques perpétrés par la France au Sahara, entre 1960 et 1967 avec l’accord de l’Algérie indépendante, essais auxquels il assistait quand il était enfant, protégé par une casserole trouée pour voir l’explosion et ressortir avec une vision irradiée pour toujours.
Samir Moinet, Master LFGC