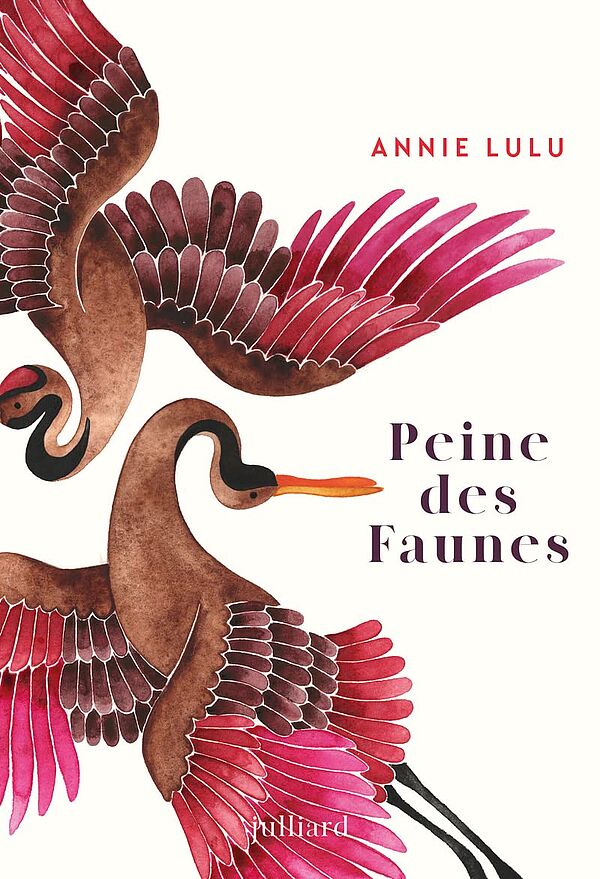Saga familiale, le deuxième roman d’Annie Lulu s’étend sur plus d’un demi-siècle et cinq générations. L’histoire commence dans la Tanzanie des années 1980, pour s’achever dans l’Écosse des années 2040 ; elle met en scène les luttes d’une lignée de femmes, d’Omra l’ancienne, qui coordonne la résistance d’un village aux tentatives d’expropriation d’une compagnie pétrolière venue racheter et creuser les terres ancestrales pour y faire passer un oléoduc, à Jina et Viviane, qui fuient leur père assassin, en passant par « Rébecca, que tout le monde surnommait Nyanya, grand-mère, à cause de la ressemblance frappante qu’elle avait avec sa grand-mère maternelle morte en couches » (p. 17), et qui transmet à sa fille Margaret un profond respect pour tous les vivants, qu’elle a elle-même hérité d’Omra. Dans cette famille, en effet, « une mère ne mange pas les enfants des autres mères » (p. 44), mais plus que dans les traditions animistes africaines, ce véganisme pionnier s’ancre d’abord dans une réinterprétation radicale de la Genèse : « C’est dans un jardin qu’Il nous a placés en premier, pas dans une boucherie. […] Il nous a dit d’abord, il nous a ordonné en premier : Tous les arbres du jardin, tu peux t’en nourrir » (p. 45).
Le refus du sang et de la nécessité de tuer d’autres animaux débouche alors sur une condamnation générale de la violence ainsi que sur une défiance foncière envers les hommes qui « aiment la viande » (p. 44) et, partant, sont d’une agressivité sans frein : « ils nous tuent, ils nous violent, ils nous battent, […] ils font la même chose à toutes les femelles qui habitent sur terre, qu’on soit leur vache, leur mère, leur fille ou leur femme » (p. 127). Malgré cet avertissement reçu de sa mère, qui revient comme un leitmotiv tout au long du récit (p. 179, p. 185), Margaret n’échappe pas à son destin de victime, mais son féminicide est aussi l’occasion romanesque de resserrer les liens intergénérationnels entre ses filles, Jina et Viviane, et leur grand-mère Rebecca (« Nyanya »).
Quand cette dernière décède à son tour, fin 2022, le récit bascule résolument dans l’anticipation : Jina retourne en Tanzanie, dans le village de sa grand-mère Omra, tandis que Viviane, devenue mère, part s’installer en Écosse avec son mari, Ari, et leur fils Jacob. En quelques pages s’installe alors l’apocalypse. « L’arrivée massive de nombreux réfugiés économiques et climatiques » (p. 252) bouleverse en effet profondément les sociétés européennes, tandis que « la situation catastrophique des espèces animales » (p. 253), menacées d’une extinction de masse, engendre leurs propres migrations incontrôlées : c’est « la Peine des faunes » (p. 253), qui donne son titre au roman et divise bientôt les populations humaines en tueurs ou en protecteurs des faunes. Une forme d’utopie n’en voit pas moins le jour : « ce pour quoi Omra s’était battue toute sa vie durant, la reconnaissance des faunes, de leur personnalité juridique, l’adoption générale d’une alimentation à base de plantes, l’interdiction absolue de tuer, se produisait et était devenu le nouvel idéal sociétal, la nouvelle normalité culturelle » (p. 254-255).
La dernière partie du roman (« Un ») ouvre alors la voie à une forme de réconciliation entre hommes et femmes, tout comme entre bêtes et humains : avec la mort naturelle de Samuel, l’assassin de Margaret, c’est aussi « un vieux monde » qui entre « dans sa tombe » (p. 311), tandis qu’une nouvelle génération d’hommes – à commencer par Jacob, l’enfant de Viviane, et son propre fils à naître, dans la dernière page du récit – se tient désormais « dans le sillage des femmes avec la vie au poing » (p. 312).
Peine des Faunes relève, à de nombreux égards, de la fiction slipstream : cette saga familiale, comme on l’a présentée d’emblée, se déploie en effet à la croisée de plusieurs genres littéraires ou sous-genres romanesques, glissant insensiblement de l’un à l’autre au fil de ses trois parties. Ce qu’on pouvait initialement lire comme un roman réaliste de la filiation et de la transmission, avec des liens maintenus, rompus, ou renoués selon que le récit se centre sur telle ou telle figure féminine dans la première partie (« Piliers de la création », p. 1-143), se mue en roman de la migration – que cette dernière soit interafricaine, de l’Éthiopie à la Tanzanie, extra-africaine, avec les départs consécutifs pour l’Europe de Samuel, de sa famille, puis de Nyanya venue rejoindre ses petites filles, après l’assassinat de leur mère Margaret, ou encore intra-européenne, avec les allers-retours de Viviane et Nyanya entre l’Angleterre et la France – dans sa deuxième partie (« Géographie des vivants », p. 145-266). Mais dès la page 244, le récit s’engage également dans la voie de l’anticipation, par une série d’ellipses et de résumés des catastrophes écologiques, économiques, politiques, sanitaires, sociales qui frappent les sociétés européennes et africaines à compter des années 2030. La dernière partie (« Un ») offre une clôture provisoire avec la résolution inattendue de l’intrigue familiale et l’apparition de quelques lueurs d’espoir qui tiennent alors autant au fantastique (le regain de « l’Éclat » qui habite les femmes et qu’incarne au premier chef l’aïeule éthiopienne, Omra, désormais âgée de plus de 130 ans) qu’à une forme renouvelée d’animisme (les manifestations de l’esprit de Nyanya à travers divers oiseaux qui accompagnent les personnages).
En empruntant à divers genres, Peine des faunes intéresse aussi son lecteur par sa combinaison de duplicité et de binarité. L’intrigue est en effet constamment double, tout à la fois centrée sur la condition des femmes et celle des faunes, face aux hommes qui exercent sur elles une domination dégénérant en violences physiques et sexuelles pouvant aller jusqu’aux meurtres. Passé et futur sont également mêlés, la philosophie anti-spéciste d’Omra s’exprimant tout aussi bien dans le passé (les années 1980, p. 59) que dans le futur (les années 2030, p. 254), tandis que son combat écologique contre l’installation d’un oléoduc, initié dans les années 1980, se voit aussi reconduit dans les années 2030. Enfin, dystopie et utopie s’imbriquent sans cesse – cette dernière s’incarnant notamment dans des lieux refuges, comme le jardin d’Omra, celui de Nyanya, ou encore dans les repaires conçus par les militants écologistes pour protéger les animaux des violences des fauneurs, dans la deuxième partie du roman.
On voit enfin, par ces quelques espaces utopiques, comment la fiction d’Annie Lulu se joue subtilement d’un imaginaire biblique, tout à la fois repris et détourné. Si la défense de l’environnement contre les exactions extractivistes des puissances pétrolières et leur projet de pipeline s’apparente à la préservation d’un jardin d’Éden contre l’immixtion d’un serpent noir (p. 70, p. 73, p. 75, p. 85, p. 248), et si la catastrophe climatique et la lutte contre la sixième extinction des espèces ressemblent respectivement au déluge et à la salvation offerte par l’Arche de Noé dans le livre de la Genèse, un infléchissement significatif s’opère dès le début du récit. Ce n’est plus en effet la femme mais bien l’homme qui, par sa convoitise et son tempérament violent, introduit le péché dans le paradis terrestre, tandis que la matriarche Omra incarne plutôt un lien privilégié avec le divin : « fille d’un ange ou bien d’un séraphin et de sa mère morte en couches, descendante de la tribu de Dan dont tous les habitants du Gondar vantaient la ressemblance exacte avec Ève » (p. 60), elle se caractérise autant par « l’Éclat » qu’elle transmet uniquement à ses filles que par ses superpouvoirs naturels – elle possède en effet le « don de faire croître n’importe quelle semence » et celui de « purifier l’eau » (p. 60). Enfin son arrière-petit fils, Jacob, qui mettra fin à l’intrigue familiale en refusant finalement de tuer Samuel pour venger sa grand-mère Margaret, est lui-même affecté d’une claudication – non point, comme le Jacob biblique, à la suite d’un combat avec un ange, mais parce qu’en tant qu’homme il porte ainsi « la séquelle du combat de toutes les femmes dont je suis le fils, contre les forces obscures et humaines de la nuit du monde. Et ce cadeau me fait voir les choses telles qu’elles sont. De travers », affirme-t-il au début de la troisième partie (p. 269). En refusant d’obéir à la loi du talion pour choisir finalement la voie complexe du pardon et de la non-violence, Jacob introduit donc un basculement éthique qui fait par ailleurs résonner ce récit avec plusieurs thématiques de Lethica.
Il y a d’abord la question du faire cas ou des différentes manières de prendre soin, à commencer par celles des femmes entre elles, selon une forme de solidarité sororale ou intergénérationnelle où se découvrent malgré tout quelques erreurs fatales – Rebecca ne s’est pas toujours bien occupée de ses enfants selon Omra, et a ainsi perdu « l’Éclat », délaissant notamment sa dernière née, Oria, et abandonnant finalement Margaret à son sort de femme battue et violée, quand elle aurait dû l’inciter à partir en montrant elle-même l’exemple, plutôt que de se résigner au confort d’une vie conjugale sans autonomie (p. 152-153). Il y a ensuite l’enjeu récurrent de l’éthique animale ou de la reconnaissance, du respect et de la protection à accorder aux diverses faunes, selon l’exigence d’Omra en Afrique (p. 59, p. 68, p. 84-85) ou celle des Protecteurs en Europe (p. 197, p. 214, p. 236). Il y a enfin la question des révolutions morales, ou des changements de la sensibilité et des mutations des comportements, face aux violences spécistes et carnistes.
Et la Peine des faunes arriva, stupéfiante : des animaux sauvages ou domestiques se regroupaient, se mêlaient, affolés, et traversaient en hordes, indistinctement, des zones agricoles et des villes dans certaines directions, la plupart du temps des forêts, sans que personne ne sache pourquoi. Cela avait lieu aussi avec des bancs d’animaux marins. Des images impressionnantes de ces hordes circulèrent partout. Des défenseurs des droits humains s’étaient joints massivement aux défenseurs des droits des animaux pour la première fois et bloquaient les fermes, libéraient et emmenaient par camions vers des refuges subventionnés les animaux qui y étaient enfermés, menaient des actions en faveur de la fin des contrats des employés des derniers abattoirs avec indemnisations pour dommages psychologiques et reconversions. […] Les pertes économiques faramineuses, la banqueroute de plusieurs grandes fermes laitières, les scandales successifs d’hygiène et de santé publique, finirent par convaincre une partie importante de l’opinion que l’arrêt de l’exploitation animale était souhaitable et même indispensable à la protection des droits humains. […] Ce à quoi Viviane et Ari rêvaient vingt-cinq ans auparavant, ce pour quoi Omra s’était battue toute sa vie durant, la reconnaissance des faunes, de leur personnalité juridique, l’adoption générale d’une alimentation à base de plantes, l’interdiction absolue de tuer, se produisait et était devenu le nouvel idéal sociétal, la nouvelle normalité culturelle. […] Les mesures de protection animale étaient acceptées en général comme des ajustements nécessaires pour le climat, des mesures de prophylaxie au profit des humains et des autres faunes, mais toujours pas unanimement et Jacob vit donc, de ses yeux, la folie aveugle des fauneurs, issue de leur entêtement stupide ou bien de leur illusion de la permanence, ou bien d’un mélange des deux. (p. 253-254 et p. 263).
Le récit montre également que les propositions peuvent radicalement varier, en matière de protection des droits des animaux : l’arrière petit-fils d’Omra, Jacob Taub, devient en effet d’abord célèbre pour avoir défendu, dans un « court et percutant essai : Théorie de la légitime défense par substitution, […] la possibilité pour tout animal humain d’intervenir y compris en donnant la mort dans un cas de meurtre imminent d’une créature » (p. 266). Inversement, son épouse Éti continue de maintenir l’exigence d’une éthique non-violente plutôt que de céder à la tentation du talion ou à la légitimation de l’homicide au nom de l’anti-spécisme : « Tu ne peux pas ôter la vie à quelqu’un sur la base d’un raisonnement a posteriori, Jacob. Ce n’est pas la justice, ce n’est pas de la protection, mais de la vengeance » (p. 276).
Dans les conflits qui structurent sa narration, comme dans les dissensions qui traversent régulièrement les échanges entre ses principaux personnages, Annie Lulu a de toute évidence choisi, avec Peine des Faunes, d’inquiéter plutôt que de réconforter ses lecteurs. Sa fiction relève pleinement, de ce point de vue, du genre émergent du Near Chaos qui, selon ses théoriciens Simon Bréan et Guillaume Bridet, consiste aujourd’hui à « situer l’histoire dans un avenir proche », « pousser très loin tous les curseurs », « faire de notre monde en crise un ressort de l’intrigue », « imposer des fictions heuristiques et critiques » et finalement « mettre le lecteur en alerte ».
Anthony Mangeon - Configurations littéraires