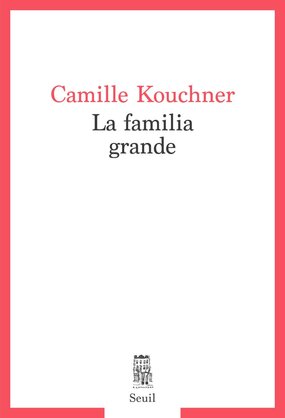Comme L’Inceste de Christine Angot en 1999, dont Quitter la ville (2000) raconte le succès de scandale et le tapage médiatique, La Familia grande de Camille Kouchner provoque dès sa sortie en janvier 2021 un raz-de-marée social, politique, scientifique et littéraire. Un an après Le Consentement de Vanessa Springora, le séisme provoqué par cette publication s’explique par la nature de son sujet et le statut des acteurs. Après des années passées à garder le secret, Camille Kouchner dénonce les viols et agressions sexuelles commis par son beau-père, Olivier Duhamel, sur son frère jumeau, « Victor », âgé d’environ 14 ans au début des faits, ainsi que l’inertie du clan réuni autour du célèbre homme politique, qui a accueilli la révélation de l’inceste par un silence complice.
La Familia Grande est l’histoire d’un inceste raconté de biais, entraperçu depuis la « chambre-péage » ou la « chambre-témoin » (p. 107) de l’autrice, par laquelle le beau-père transite de nuit pour rejoindre la sienne. Mené depuis le point de vue du témoin, le récit génère selon Neige Sinno dans Triste Tigre (2023) une « perspective qui produit de la lisibilité » (p. 98), en ce qu’elle permet de « parler du phénomène de société sans entrer dans le pathos insupportable de la souffrance directe » (p. 97). Le mode de narration et la position du narrateur apparaissent comme des critères de recevabilité et d’acceptabilité des récits qui prennent en charge des « sujets sensibles », tout en soulevant un questionnement éthique autour de la difficulté et de la légitimité pour un tiers de se faire le porte-parole d’une histoire autre, ainsi exposée sur la scène publique. Aussi le livre est-il parcouru par l’hésitation et la réticence, l’appréhension des effets induits par ses choix de focalisation et de narration : la narratrice fait part du « remords de voler à mon frère la violence qu’il a, seul, subie » (p. 125), et le remerciement de clôture témoigne de la tension entre le caractère invivable du secret et le coût de la transparence : « Pour m’avoir laissée écrire ce livre alors qu’il ne souhaite que le calme, je remercie Victor » (p. 205).
Histoire d’un inceste, La Familia grande est également celle d’un secret et d’un silence, résultats d’une triple contrainte : la promesse faite au frère (« Il me dit aussi : “Respecte ce secret. Je lui ai promis, alors tu promets. Si tu parles, je meurs. J’ai trop honte. Aide-moi à lui dire non, s’il te plaît”. », p. 105) ; l’amour malgré tout porté au beau-père, qu’il est impossible de dénoncer (« Il [le beau-père] entrait dans ma chambre, et par sa tendresse et notre intimité, par la confiance que j’avais pour lui, tout doucement, sans violence, en moi, enracinait le silence », p. 107) ; la peur des répercussions sur la mère, fragilisée après le suicide de son père et de sa mère (« […] fais comme si de rien n’était. Fais-le, pour Évelyne. Lui aussi va se suicider et elle va pas le supporter », p. 116-117).
Analysant les mécanismes du secret et du silence, qui reposent sur les liens affectifs entre l’incesteur et l’incesté, La Familia grande met le lecteur face aux dilemmes éthiques liés au statut de témoin indirectement touché par la violence incestueuse mais directement engagé dans la structure familiale. Parler ou se taire, c’est devoir choisir entre la traîtrise et la complicité : soit briser une promesse, forcer l’aveu (« C’était sa vie. Pas la mienne. De quoi je me mêlais ? », p. 155), atomiser la famille (« Fin 2008. Fin du secret. Fin 2008, le monde s’est écroulé », p. 164), pour protéger la génération suivante ; soit respecter le secret d’autrui et préserver l’unité familiale, au risque de la reconduction des violences et au détriment de soi. En effet, l’embolie pulmonaire de Camille Kouchner est interprétée comme la somatisation d’un « corps auto-intoxiqué » (p. 140) par le secret et la culpabilité, symbolisés au long du récit par une hydre grandissante (p. 141).
En parallèle de la sortie d’inceste de son frère, La Familia grande relate la trajectoire de la narratrice-témoin, qui passe d’un sentiment de culpabilité face à sa complicité passive à la réalisation de son statut de victime collatérale. Durant « des années de coupable adoration » (p. 116), elle estime que « [sa] culpabilité est celle du consentement », pour avoir « participé à l’inceste » en « ne désignant pas ce qui arrivait » (p. 124), et donc « protégé [s]on beau-père » (p. 116). À la fin, le discours se retourne, désigne les véritables coupables et réintègre le chœur des victimes auquel #MeToo a donné voix : « Je n’ai pas protégé mon frère, mais moi aussi j’ai été agressée. Je ne l’ai compris qu’il y a peu : notre beau-père a aussi fait de moi sa victime. Mon beau-père a fait de moi sa prisonnière. Je suis aussi l’une de ses victimes. » (p. 202-203).
Ainsi, depuis la distance permise par le statut de témoin, La Familia grande porte un questionnement autour de la notion de responsabilité face à l’inceste : à la responsabilité pénale et morale du beau-père violemment pris à parti (p. 167-169) et à l’irresponsabilité des adultes répondent la non-responsabilité des enfants (« Ce sont les parents qui font taire les enfants. Pas les frères. Pas directement. Votre désir, le tien et celui de ton mari dérangé, pour nous, est une terreur jamais égalée. Voilà mon silence, maman. », p. 202) et la responsabilité éthique du je écrivaine : « C’est pour toutes les victimes que j’écris, celles, si nombreuses, que l’on n’évoque jamais parce qu’on ne sait pas les regarder » (p. 204).
La Familia grande fait aussi une archéologie et une sociologie de l’inceste. En amont, Camille Kouchner décrit l’atmosphère incestuelle latente côté Pisier et à Sanary, qui crée le contexte de permissivité facilitant le passage à l’acte du beau-père. Avant la confidence de Victor à sa sœur (p. 99), le lecteur est frappé par l’intrusion dans la vie privée et sexuelle des enfants par des remarques et des gestes déplacés des parents :
Il arrive aussi que, à peine ados, les enfants se roulent des pelles. Du haut de mes 7 ou 8 ans, je demande à ma mère : “Évelyne, regarde, regarde, comment font-ils ça ?” Hilare, elle m’attrape par le bras. “Ouvre la bouche. Tu veux essayer ?” Les adultes sont très amusés. (p. 65-66)
À Sanary règne un exhibitionnisme généralisé entre adultes et enfants : injonction à la nudité (« […] mon beau-père surveille l’évolution des corps : “Dis donc, ça pousse, ma Camouche ! Mais tu ne vas pas tout de même pas garder le haut ?” », p. 63) et jeux à caractère sexuel (« Je me souviens de ce que, à peine adolescente, j’ai eu à mimer : “Camille, viens ici. À ton équipe tu feras deviner La Chatte sur un toit brûlant… Tu connais pas ? C’est un film de cul.” […] Me voilà faisant mine de baiser devant les parents. », p. 66-67) sont de mise, dans un brouillage des frontières familiales et générationnelles que traduit le motif des photographies des corps enfantins, soumis au male gaze et mis à la disposition des adultes :
À peine 15 ans, et mon beau-père se fait photographe. Les culs, les seins, les peaux, les caresses. Tout y passe. Sur les murs de la Ferme, les images sont exposées en grand. Dans la cuisine de cette maison des enfants, une photo de sa vieille mère, quasi nue dans le jacuzzi, seins flottants à la surface de l’eau. En quatre par quatre, un gros plan des miens et une photo des fesses de ma sœur dévalant le chemin. (p. 112)
Surtout, au nom d’une « liberté » soixante-huitarde, une dictature sexuelle s’impose à Sanary, transformant les « prudes » en parias (« “T’es pas comme Mumu, la coincée ?” », p. 63) et les victimes en boucs émissaires (après avoir déposé une main courante pour agression, une « jeune femme a été répudiée, vilipendée par mon beau-père et ma mère, effarés par tant de vulgarité », p. 106). Les effets pervers de cette rhétorique d’inversion se font sentir jusque dans les échanges entre les jumeaux après les premières agressions. Ventriloqués par leurs parents, les adolescents sont incapables de mesurer la violence imposée au nom de la liberté : « “C’est mal, tu crois ?” Ben non, je ne crois pas. Puisque c’est lui, c’est forcément rien. Il nous apprend, c’est tout. On n’est pas des coincés ! » (p. 105). Plus âgée, la narratrice restituera la portée réelle de ces discours délétères : « À l’unisson, vous avez forcé nos leçons » (p. 168).
Ce cadre donne son ampleur aux pages suivant la révélation de l’inceste dans la communauté des « Sanaryens », où « beaucoup savaient et la plupart on fait comme si de rien n’était » (p. 172) : l’utopie de gauche, censée ré-« inventer les rapports entre les parents et les enfants » (p. 63), est en aval montrée pour ce qu’elle est, une microsociété tyrannique dominée par le beau-père « roi » (p. 110), posée comme le strict équivalent de la société. À Sanary comme ailleurs, le système de silence et de défense caractéristique de l’inceste, analysé par Dorothée Dussy dans Le Berceau des dominations, se met en place : déni, minimisation des faits et retournement du stigmate par la mère (« “Il n’y a pas eu de violence. Ton frère n’a jamais été forcé. Mon mari n’a rien fait. C’est ton frère qui m’a trompée.” », p. 189), ostracisation des victimes (« Je n’ai vu personne tenter de nous déculpabiliser, venir nous réconforter », p. 192), contestation de la parole (« Je n’avais pas anticipé que, pour se dédouaner, le beau-père inventerait une histoire d’amour, la reprocherait à mon frère, et que certains d’entre eux le croiraient », p. 172), levée de boucliers autour du chef de famille, et retour au silence. L’allusion à La Princesse de Clèves clôt l’analyse quasi ethnographique de ce « microcosme des gens de pouvoir » (p. 172) d’une incroyable banalité. Sous couvert de subversion, Sanary est un espace de domination comme les autres, qui fait de l’inceste un rouage social :
Ce silence n’est pas seulement de la lâcheté. Certains d’entre eux sont ravis d’avoir à se taire. Un tel devoir atteste de leur appartenance à un monde. Il est une marque supplémentaire et toujours nécessaire de leur identité. À gauche comme dans la grande bourgeoisie, « on lave son linge sale en famille ». Comme chez Mme de La Fayette, la petite société se repaît de toutes les perversités et ne veut surtout pas partager. Même quand il s’agit de crimes, sur des enfants de 14 ans qui plus est. Il faut être dans le secret pour appartenir à la Cour, la familia grande, occupée à comploter. (p. 192-193)
Sans doute cette attention au contexte et aux conséquences de l’inceste a-t-elle joué dans le retentissement de La Familia grande, qui a fait cas. Chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales ont en effet pu voir dans le texte de Camille Kouchner un « cas d’école », illustrant de façon exemplaire les logiques de l’inceste et des incesteurs, comme le dit Dorothée Dussy dans un entretien donné à Libération. Pour Laurence Joseph dans son article « Le déni de l’inceste. Entre silences et malentendus » (2021), La Familia grande est « un témoignage clinique pur » (p. 31). Liée par le secret professionnel, elle passe par le récit publié pour illustrer et analyser la confusion des langages entre l’adulte et l’enfant (Ferenczi, 1932) et l’impossibilité pour ce dernier de dénoncer celui ou celle qui doit l’élever et le protéger, mais pervertit la relation par l’inceste.
En plus de faire cas, La Familia grande est un texte qui a fait date, par son rôle dans la création de #MeTooInceste en janvier 2021, dans le sillage de #MeToo en 2017, et dans la mise en place en mars 2021 de la Ciivise (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants). Selon Laurence Joseph, le témoignage « a fonctionné […] comme discours princeps, comme énoncé premier et moteur permettant par ces qualités “cliniques” de briser le silence, jusqu’ici de mise, sur ce tabou qu’est l’inceste » (p. 32). Si la révolution morale opérée par La Familia grande est indéniable, des historiens comme Anne-Claude Ambroise-Rendu ont invité à nuancer son caractère inaugural (la levée du tabou) et conclusif (la fin du tabou), répété par les médias depuis une trentaine d’années. Dans un dossier publié dans le Figaro, la chercheuse réinsère l’affaire Duhamel dans l’histoire longue de la médiatisation de l’inceste, en revenant sur les jalons constitués par l’affaire Violette Nozière (1933), l’interview à visage découvert d’Eva Thomas sur le plateau d’Antenne 2 (1986) et la campagne publicitaire autour de L’Inceste de Christine Angot (1999), invitée chez Thierry Ardisson. L’évolution des réactions du public et des médias, passant par les stades de la contestation, de la mise en doute et de la moquerie, avant que la parole ne soit écoutée et respectée, témoigne selon elle des évolutions d’une société plus à même de croire et de réagir aux témoignages des victimes d’inceste.
Une double dynamique serait donc à l’œuvre. L’indignation cyclique tend à indiquer que la réalité de l’inceste, loin de reculer, retombe dans le silence jusqu’à la prochaine affaire, comme le constate Charlotte Pudlowski dans Ou peut-être une nuit (2022), qui s’ouvre sur l’évocation de La Familia grande, de l’effervescence collective et des retombées ultérieures : « Le silence revient trop vite pour qu’aboutissent les révolutions » (p. 16). Cette inertie structurelle est toutefois traversée par une lame de fond. Le crédit accordé aux victimes témoigne d’une sensibilité accrue de la société à l’inceste, dont le caractère systémique se dégage des prises de parole de plus en plus nombreuses et fréquentes. Mais pour qu’une révolution morale ait lieu, doit encore se résorber le hiatus entre les sensibilités et les pratiques dans une société où l’inceste continue d’être commis et où le tabou porte davantage sur le dire que le faire, comme le révèle un commentaire glaçant tenu par un membre de la coterie Sanary et rapporté par la narratrice : « “L’inceste, il ne faut pas. Mais crier avec la meute, certainement pas !” » (p. 172). Électrochocs ou piqûres de rappel, les récits d’inceste jouent un rôle capital, en faisant éclater le silence pour dévoiler ce que la société continue de rendre possible.
Bibliographie :
- Christine Angot, L’Inceste, Paris, Stock, 1999.
Dire l’inceste, revue Sociétés & Représentations, 2016/2, n° 42, 2016.
Dorothée Dussy, Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste [2013], Paris, Pocket, 2021.
Laurence Joseph, « Le déni de l’inceste. Entre silences et malentendus », Études, 2021/4 (avril), p. 31-42.
Charlotte Pudlowski, Ou peut-être une nuit, Paris, Grasset, 2022.
Neige Sinno, Triste Tigre, Paris, POL, 2023.
Eva Thomas, Le Viol du silence, Paris, Aubier-Montaigne, 1986.