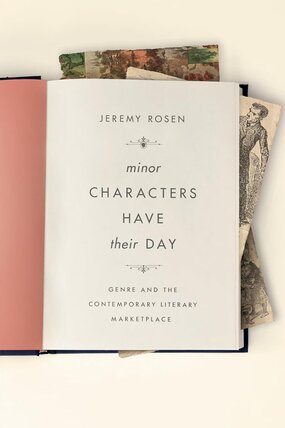L’étude de Jeremy Rosen se penche sur un phénomène qui voit le jour à la fin des années 1960 mais qui continue de jouir d’une grande attention critique et médiatique : l’émergence de celles que Rosen lui-même appelle les « Minor-Character Elaborations » (p. 7). Ces récits littéraires conçus comme des sequel, des prequel ou encore des spin-off des grands classiques de la littérature occidentale se caractérisent par le rôle accordé aux personnages secondaires, qui deviennent les véritables protagonistes d’un texte censé remettre à l’honneur leur destin de figures dévalorisées, marginalisées ou rendues muettes par une narration dominante et dont les biais reflètent ceux en place dans la société. Ce genre d’œuvres (parmi lesquelles on compte le pionnier Sargasso Sea de Jean Rhys, The Penelopiad de Margaret Atwood, mais aussi Foe de J. M. Coetzee) participe au débat, répandu aux États-Unis entre les années 1980 et 1990 et récemment ravivé en Europe, sur le rapport entre représentation et représentativité. L’essor de ce phénomène, affirme Rosen, est lié à trois facteurs : la mort prétendue de l’auteur ou du moins la mise en crise de son autorité sur le texte ; la diffusion de techniques métafictionnelles permettant à un personnage narrateur de prendre sa revanche sur un autre univers fictif ; et surtout l’attention majeure accordée aux groupes sociaux marginalisés au sein de ce que Jacques Rancière appellerait le « partage du sensible », à savoir la manière dont nous nous servons de catégories comme race, classe ou genre pour organiser notre expérience esthétique et politique collective.
Si la révision du canon vise à refléter plus fidèlement la diversité sociale, l’élaboration de personnages mineurs cherche à générer une gamme de protagonistes qui soit également représentative. En reprenant de John Guillory la notion de Imaginary Politics of Représentation (« politique de l’imaginaire représentatif »), Rosen réfléchit à la croyance selon laquelle les œuvres littéraires seraient à même non seulement de représenter une réalité préexistante, mais aussi d’influencer l’avènement d’une réalité future. Si le portrait d’une Pénélope qui enfin prend la parole et raconte l’abandon et les trahisons d’Ulysse peut bien changer la façon dont les lecteurs pensent au rôle des femmes dans la société, ce n’est que par une voie indirecte qu’il pourra contribuer à démocratiser ou à modifier les relations matérielles dans la société. Certes, il doit y avoir une relation entre les catégories vulnérables et les types généralement présentés comme mineurs dans les œuvres de fiction. Mais selon Rosen, cette relation n’est pas une relation d’identité : par le fait de rendre des personnages mineurs protagonistes d’un récit qui est censé amender l’œuvre dont il est le développement, les auteurs des Minor-Character Elaborations ne parviennent pas à remédier aux inégalités structurelles auxquelles nous assistons au quotidien, se limitant à « surévaluer l’efficacité politique des textes littéraires » (p. 134). En présentant des personnages, autrefois subordonnés, comme des sujets désormais autonomes et capables de parler en leur propre nom, les auteurs acceptent de leur céder une partie d’autorité narrative (Atwood déclare par exemple dans les premières pages de The Penelopiad qu’elle a choisi de confier l’histoire à Pénélope pour lui rendre la prise de parole qu’un autre, Homère, lui aurait enlevé). Les représentations antérieures présentes dans les œuvres canoniques sont ainsi perçues non seulement comme le fruit d’une convention idéologiquement déterminée, mais aussi comme des véritables « injustices commises à l’encontre de personnages mineurs » (p. 54). L’absence de justesse dans la représentation dans l’œuvre littéraire devient par-là l’expression d’une absence de représentativité politique, voire un acte d’oppression délibérée.
Dans le glissement opéré entre le fait de considérer les personnages socialement marginalisés comme redevables d’une « deuxième occasion » (p. 70), et le fait de saluer la découverte de leur voix comme un geste éthique ayant des conséquences réelles sur nos vies, ces œuvres incarneraient selon Rosen « une politique de la forme littéraire qui conçoit la représentation de la voix narrative et de l’intériorité d’un personnage non seulement comme un moyen d’exprimer son statut de protagoniste, mais aussi comme la mise en place d’un principe démocratique » (ibid.). Ces élaborations tendent dès lors à perpétuer le problème épistémologique qu’elles s’efforcent de résoudre : les récits fictifs qu’elles contestent et dont elles veulent offrir une version non biaisée s’avèrent tout aussi subjectifs. De plus, dans un système éditorial et académique qui se fonde sur le primat accordé au canon, elles finissent par exploiter le capital symbolique et économique de leurs prédécesseurs. Une réécriture de Flaubert qui verrait Emma Bovary échapper à son destin ne risque-t-elle pas d’exploiter simultanément la valeur intemporelle du classique contre lequel elle se dresse et d’encourager ainsi « une industrie culturelle qui […] échange le prestige du canon littéraire traditionnel » (p. 206) en prétendant accueillir des voix provenant des marges ?
Matilde Manara - Configurations littéraires