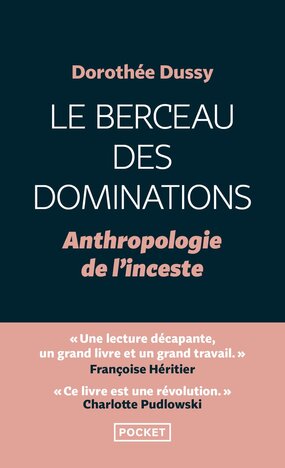Inspirés par la sociologie, les récits d’inceste récents font des travaux de l’anthropologue Dorothée Dussy une référence incontournable. Sur le mode de la source (Ravaloson, Tribunal des cailloux, Dodo vole, 2024) ou de l’intertexte (Sinno, Triste Tigre, POL, 2023), leur convocation dépasse la simple caution scientifique pour nourrir la démarche esthétique et éthique de ces textes, qui se demandent dans quelle langue et depuis quelle perspective écrire l’inceste.
Publié en 2013 et réédité seulement en 2021, Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste, s’attaque au silence le mieux gardé dans le continent des violences sexuelles, en partie dévoilées par #MeToo puis les révélations de Judith Godrèche sur la « grande famille » du cinéma. À l’heure des révolutions morales qui secouent une société sommée, sous l’afflux des témoignages, de reconnaitre la culture du viol qui la sous-tend, force est de constater que cette prise de conscience peine à intégrer l’inceste, comme intouché par la libération de la parole. Pour cause : l’inceste étant fondé sur une « grammaire du silence » (p. 65), sa révélation est rendue impossible à soi-même et inaudible aux autres.
C’est à un véritable « système inceste » (p. 36) que Dussy s’intéresse à partir d’entretiens menés auprès de 22 incesteurs incarcérés dans une prison du Grand Ouest. S’inscrivant dans l’angle mort de l’anthropologie, occupée de « l’interdit de l’inceste » (p. 26) plus que de sa réalité, la chercheuse décèle dans cet aveuglement une « aubaine » (p. 384) pour l’incesteur : empêchant tout discours, toute pensée, l’interdit de l’inceste rend paradoxalement possible sa pratique, qui soumet l’inceste à une « pédagogie érotisée de l’écrasement » (p. 284) à l’issue de laquelle sont intériorisées les normes de la domination. Le « système silence » (p. 173-174) socialise l’enfant dans un secret transparent : « secrets de Polichinelle » (p. 246), les viols se commettent souvent au vu et au su de tous, comme l’attestent les incesteurs interrogés, informés des abus intrafamiliaux passés et présents. Ce constat opère dans le livre à la manière d’une péripétie méthodologique et heuristique, qui amène Dussy à changer d’angle : réalisant que « “ce qui est dit et ce qui est tu de l’inceste” » (p. 30) importe moins que « la règle qui impose que rien ne soit “dit” et que tout soit “tu” » (p. 247), la chercheuse substitue au silence effectif « la règle de l’injonction au silence » (p. 247), dont le respect, forcé ou commode, recouvre le viol pour en reconduire la possibilité. Dès lors qu’on passe du fait à la norme, c’est l’intégration, si ce n’est la participation, de l’ensemble des structures familiale et sociale au « système inceste » qui se trouve révélée.
L’ouvrage est divisé en sept sections qui progressent par cercles concentriques de plus en plus vastes. Partant du duo formé par les incestés, dont le nombre, statistiquement marginal mais empiriquement frappant, constitue une donnée faussée par les questionnaires et les représentations faisant écran au viol, et les incesteurs, dont Dussy récolte les témoignages, biaisés par la littérature scientifique et le cadre de l’entretien, le livre construit sa démonstration par séries d’observations, issues des échanges en partie retranscrits. Reconstituant « le monde de l’incesteur », où sont distordus les mots, les faits et les lois suivant le bon plaisir du « maître du jeu » (p. 163) qui « se sert » (p. 113) parmi « les femmes et les enfants à [sa] disposition sexuelle » (p. 139), Dussy dégage les principes organisant les conduites en « système », aux antipodes du mythe de la « pulsion ». C’est à cette lumière que sont scrutées les familles incestueuses, où il s’avère, arbres généalogiques à l’appui, que les abus se perpétuent de génération en génération, à la faveur non pas d’un déterminisme génétique (le modèle zolien) ou psychologique (l’incesteur incesté), mais de l’intériorisation de la relation incestueuse, reconduite du fait de la normalisation et de l’impunité.
L’historique de la famille fait place à l’examen de son devenir, une fois qu’une « brèche dans le silence » (p. 298) a été rendue pensable par un « annonciateur » venu « bousculer, contrer, renverser la représentation du monde et de l’ordre » de l’inceste, reconnaissant dans son vécu un fait non « anomique » mais « social » (p. 306). Étudiant les réactions de défense à la verbalisation de l’inceste, du déni aux retournements de culpabilité, Dussy constate que l’inertie l’emporte : la structure familiale, où la place affective et hiérarchique de l’incesteur reste intacte, retombe dans sa gangue de silence. À cela rien d’étonnant, selon la section finale : l’ordre familial duplique dans ses logiques de minimisation et de protection l’ordre social qui profite à l’incesteur. Décapant le vernis universaliste d’une justice masculine, dont les procédures (délai de prescription, présomption d’innocence, charge de la preuve) et les décisions (qualification des abus, mesure de la gravité, calcul des préjudices) découlent de biais patriarcaux sourds au vécu des victimes, Le Berceau des dominations s’achève sur un constat glaçant : alignant « leur représentation de l’admissible et du répréhensible sur celui des incesteurs » (p. 357), les hommes de loi « se font les vecteurs efficaces de la reconduction de l’ordre social incestueux fondé sur le silence et la domination » (p. 360), dans lequel « nous sommes tous socialisés » (p. 378).
Le Berceau des dominations frappe par sa spécificité stylistique, sur laquelle le chercheur en sciences humaines est invité à revenir, dans la mesure où elle écorne l’idéal d’objectivité scientifique, ravalé au rang d’idéologie. À rebours de l’écriture académique, donnée comme « l’une des modalités d’expression et de transmission de l’ordre dominant, c’est-à-dire masculin et patriarcal », « traditionnellement chargée de […] taire » l’inceste (p. 33-34), l’autrice revendique une « rupture dans l’écriture » (p. 33). Une partie du protocole stylistique est livrée : contre la « confusion des langues » (Ferenczi, 1932) et son « lexique de l’amour et des sentiments » (p. 187) euphorisant les abus, les néologismes forgés par les victimes ; contre le postulat d’impersonnalité, une « anthropologie du très proche » (p. 34) traversée par les pronoms je et vous, courroie de l’identification ; contre la technicité de la science ou de la justice, « une langue du quotidien et du domestique », familière et concrète, voire crue, inscrite dans « l’espace de l’inceste » (p. 35) pour examiner de l’intérieur ses ressorts, de son rôle de « soupape à libido » (p. 133) à la « gestion pitbull » (p. 147) des relations affectives. Contre le mythe de la neutralité enfin, l’ethnologue écrit avec son « cœur » et sa « morale » (p. 162), afin de battre en brèche, par l’axiologisation du discours, la logique de l’incesteur et de la société qui le tolère.
En appelant l’universitaire incesteur le Diable, j’essaie de révéler davantage que ma gêne. […] Je tente de jeter un spot sur l’une des mille et une modalités par lesquelles la violence est rendue invisible ou acceptable, qui consiste à stigmatiser l’acte mais à banaliser l’acteur et à poursuivre son petit bonhomme de chemin à ses côtés. (P. 149)
On ajoutera la pratique d’une ironie à double face, à la fois en dehors et au-dedans du système inceste. Antiphrastique, elle met à nu l’absurdité de la rhétorique des incesteurs, dont l’armature fallacieuse légitime la tyrannie arbitraire du plaisir de subjectivant.
Une belle-fille n’est pas une fille […]. Le « tabou de l’inceste », comme on dit en langue populaire, serait alors une construction sociale destinée à défendre l’exogamie en tant que fondement de la société. C’est ce que dit grosso modo l’article « Inceste » de Wikipédia, plus facile à comprendre – et plus lu – que Lévi-Strauss. CQFD : on ne fait rien d’interdit et pas de mal à la société en couchant avec les filles de sa femme. (p. 138)
Mais l’ironie va plus loin. Installé au cœur de l’argumentaire de l’incesteur, le lecteur est forcé à un retour réflexif sur son propre discours, tramé par une terminologie commune révélant un point de contact, de contagion, entre le monde de l’incesteur et le sien.
Le consentement du partenaire n’entre pas en ligne de compte dans la définition commune du viol. L’appétit vient en mangeant, comme le dit le proverbe, et dans une langue ad hoc le désir peut s’obtenir en cours de « repas ». Tout le monde le sait, se passer du consentement de son/sa partenaire pour démarrer un rapport sexuel est tout à fait banal. Sur le continuum du consentement […], les options séparant les deux pôles sont nombreuses. […] Au bout du compte, difficile pour quiconque de savoir à quel endroit du continuum on se situe et les incesteurs ont des raisons logiques, donc légitimes, de considérer qu’ils ne sont pas des violeurs. (p. 118-119)
La reprise ironique interroge la reconduction inconsciente de l’ordre symbolique interdisant et autorisant l’inceste, auquel la langue du livre, opérant à la manière d’un électrochoc, montre l’insidieuse participation.