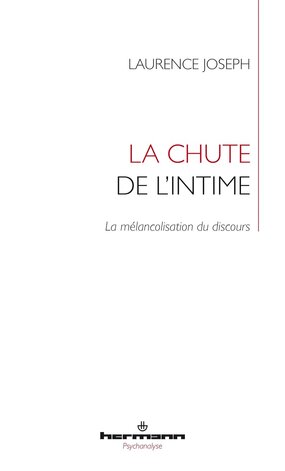Le livre de Laurence Joseph prend forme au cours de la pandémie mondiale de Covid-19, qui a obligé la clinique à réaménager ses pratiques de soin pour contourner le confinement et répondre aux besoins croissants d’écoute. Au contact des patientes et des patients les plus isolés et vulnérables, notamment les personnes âgées coupées de tout contact avec l’extérieur dans les EHPAD, la psychanalyste-clinicienne observe une modification, une unification des discours, présentant dans leur double tendance dépressive et colérique un aspect « mélancoliforme » (p. 7), qu’elle se propose d’interroger. Laurence Joseph pose ainsi l’hypothèse d’une « mélancolisation du discours », liée à une « chute de l’intime » provoquée par une rupture d’un rapport vital à l’Autre et à la parole, pour déployer les implications politiques et éthiques de la perte d’un lien à soi et à autrui tout à la fois.
La « chute de l’intime » (où chuter renvoie à l’action de choir, mais aussi de faire taire, liant ainsi la perte et le silence) repose d’abord sur une pensée de l’intime fondée sur la « réfutation de l’idée selon laquelle le sujet humain serait forclos » (p. 57). Selon Laurence Joseph, qui transpose dans le champ psychanalytique la philosophie augustinienne de l’intériorité (l’intimité du sujet est constituée par l’altérité de Dieu), « l’intime inclut en son for intérieur une part d’étranger » (p. 59), un « bord interne abritant une part étrangère en nous » (p. 28), proche en cela de « l’ex-time » lacanien. Loin de la « plongée en soi » ou de l’« union avec soi » (p. 42), l’intime repose sur une « dialectique fragile » entre « exposition » et « exclusion » (p. 8-9) d’une altérité dont la participation est essentielle à l’individu en tant que sujet (versant psychique) et en tant que citoyen (versant démocratique). De là deux mouvements symétriques vitaux : l’exigence d’une retraite solitaire d’une part, « celle du corps qui se retrouve dans ses gestes intimes » (p. 29), d’autre part la rencontre avec autrui au moyen d’une parole qui permet de « faire l’épreuve d’une différence à l’intérieur de soi » (p. 39) et de se découvrir en tant qu’espace traversé par l’étrangeté. Autrui, plus particulièrement « l’ami intime », offre selon Laurence Joseph cette extériorité avec laquelle se fabrique un langage commun « qui permet ensuite de bâtir […] des citoyens, des sujets aptes à vivre ensemble » (p. 68).
Telle conception de l’intimité, qui en tant qu’elle est « un appel à l’autre, au respect de l’autre » constitue une « éthique de l’autre » (p. 8), est aussi une politique. Dans le sillage de Michaël Fœssel (La Privation de l’intime, Seuil, 2009), Laurence Joseph défend dans une perspective psychologique plutôt que sociologique l’idée que « l’intime est politique » (p. 131). Aussi sa « chute » a-t-elle non seulement des conséquences psychiques et physiques, mais elle est aussi un « signal politique » (p. 42), « un point tournant pour l’éthique de chacun » (p. 94). La chute de l’intime s’origine dans le sentiment d’une trahison, d’une perte d’écoute et de soin, exacerbé par les décisions prises par l’État lors de la pandémie de Covid-19, qui engendre une « crise de confiance » (p. 100) envers l’autre et sa parole. En se détournant du contact avec l’extériorité, l’intime, vidé d’une part de lui-même, désinvestit le territoire des mots communs et s’appauvrit, jusqu’à se laisser envahir par le silence et un discours desséché, uniformisé, mélancolisé. Cette mélancolisation du discours, signe d’une « déliaison avec autrui » (p. 94), peut soit conduire à la destruction de l’intime, soit prendre une portée plus politique. En effet, faute de dialogue, la mélancolie peut engendrer « un abandon de l’agora classique pour en créer une autre aux valeurs inversées » (p. 95), un « semblant d’agora » (p. 96) offert par les communautés complotistes et virtuelles qui, en créant un désintérêt pour une res publica alors désinvestie, détériorent le lien social. C’est en cela que la « chute de l’intime » fait planer le « risque d’une mélancolisation commune et continue qui menace la démocratie, ses institutions et sa vitalité » (p. 131).
Une fois ce cadre de pensée posé, on comprend pourquoi La Chute de l’intime fait de Mélusine une « allégorie de l’intime » (p. 42). La fée bâtisseuse des romans médiévaux de Jean d’Arras et de Coudrette, frappée par une malédiction qui l’oblige à faire retraite chaque samedi pour dérober aux regards sa queue de serpent, incarne pour Laurence Joseph l’alliance paradigmatique du privé et du politique, du repli sur soi et de l’élan vers le monde : de même que « Mélusine ne peut accomplir son destin de bâtisseuse et de créatrice dans la Cité que si elle agit loin des regards » (p. 26), il n’est « point d’action politique sans temps de retrait pour abriter un secret » (p. 25). Sa trahison par son époux, qui, pris de jalousie et de doute, l’espionne à travers la porte de sa chambre et la surprend dans son intimité, provoque d’ailleurs la chute de Mélusine qui, dans une des versions, se jette par la fenêtre avant de se transformer in extremis en serpente à ailes, venant hanter ses anciens châteaux et ses enfants, mais sans retour possible dans la Cité.
L’intérêt de La Chute de l’intime tient à cette volonté de penser ensemble psychanalyse, clinique, éthique et politique, et plus précisément de montrer que la tâche de prendre soin des vulnérabilités, laissées pour compte lors de la crise du Covid-19, revêt une importance éthique dont l’enjeu est politique. Les moments de crise, lorsqu’ils bouleversent les rapports à l’altérité, mettent en péril l’intimité. Sa chute est à l’origine d’une mélancolie qui peut donner lieu à un renversement des valeurs, et par conséquent à une remise en cause du socle des institutions démocratiques. À la clinique, il revient d’aider à réparer et maintenir le lien avec l’altérité ; mais aux sociétés et aux gouvernements, pour éviter que la mélancolie ne s’empare des sujets et des discours, il incombe aussi et avant tout de trouver des remèdes à la mélancolie et des solutions pour lutter contre les ruptures de sociabilité responsables des sentiments de trahison, d’injustice et d’indésirabilité sociale. Au croisement de la philosophie, de la médecine et de l’art, la mélancolie, dont l’expérience n’est pas seulement celle du génie créateur mais aussi du citoyen ordinaire, appelle ainsi une clinique et une éthique.