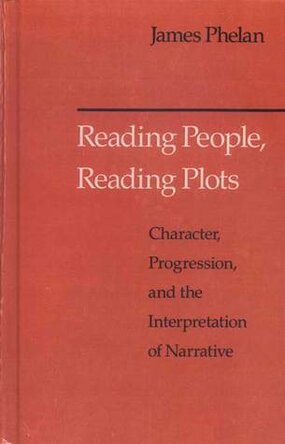Livre pionnier en théorie du personnage, Reading People, Reading Plots se propose d’offrir une série de distinctions narratologiques utiles pour comprendre les principes sur lesquels sont construits les personnages littéraires. S’opposant aux modèles structuralistes qui considèrent le personnage comme un objet purement textuel, Phelanplaidepour une approche rhétorique du personnage capable de « mettre au premier plan le texte comme communication entre l’auteur et le lecteur »(p. 2). Dans la construction et le développement d’un personnage, trois composantes l’intéressent : la composante mimétique, c’est-à-dire la manière dont un personnage se donne à voir en tant qu’« image d’une personne possible » (ibid.) ; la composante thématique, c’est-à-dire la manière dont un personnage génère des « énoncés de signification » (p. 3) qui le rendent représentatif d’un certain groupe ou catégorie ; la composante synthétique, c’est-à-dire la manière dont un personnage est le fruit d’une « construction » (p. 4) formelle visant à engendrer différents effets (de connaissance, de sympathie, d’identification) chez le lecteur.
Notre compréhension d’autrui dans la vie, affirme Phelan, a elle aussi une composante thématique.
Nous disons : "c’est un hippie" ou "C’est une féministe radicale", et nous impliquons que les identités de ces personnes peuvent être résumées à un ensemble d’idées ou de valeurs associées à ces descriptions. En même temps, nous […] nous considérons généralement comme plus éclairés, plus ouverts, plus tolérants précisément parce que nous prétendons nous abstenir de sauts aussi rapides du mimétique au thématique et qualifions de racistes ou de sexistes ceux qui partent de la couleur de la peau ou du genre pour avancer des hypothèses sur une personne (p. 79).
Là où l’approche structuraliste « reste ancrée à l’idée que le discours du récit va définir les demandes et les attentes de son public », Phelan maintient en somme que « les présupposés et les croyances qui opèrent dans les différents publics » sont « toujours et déjà présents dans notre appréhension du récit » (p. 109).
En s’appuyant sur la lecture de près de différentes œuvres canoniques (Jane Austen, Henry James, Italo Calvino entre autres), il distingue la « dimension » et la « fonction » d’un personnage. La dimension coïncide avec tout attribut qu’un personnage peut posséder lorsqu’il est isolé du texte dans lequel il apparaît, tandis que la fonction est l’application particulière de cet attribut dans le texte. Ce qui importe pour Phelan, c’est tout particulièrement l’effet que la progression narrative a sur notre façon d’appréhender le personnage. Puisque les dimensions peuvent être converties en fonctions par la progression de l’œuvre, chaque fonction dépend nécessairement d’une dimension, mais chaque dimension ne correspond pas nécessairement à une fonction.L’auteur identifie la dimension mimétique d’un personnage avec les attributs, qui permettent à la fois de donner l’illusion qu’il s’agit d’une personne réelle, et de restituer des traits pertinents pour ses actions ultérieures. Les auteurs, affirme Phelan, peuvent tirer parti de nombreuses variables narratives pour générer le mouvement dans le récit.
Deux types de variables sont étudiées dans le livre : les premières sont les instabilités produites au sein de l’histoire, dans des situations qui compliquent l’intrigue et demandent à être résolues par des actions des personnages. Les deuxièmes sont les tensions créées par le discours : ces instabilités – de valeur, de croyance, d’opinion, de connaissance, d’attente – s’établissent entre l’auteur ou les narrateurs d’une part, et les lecteurs ou le public d’autre part. Si les réponses à la composante mimétique impliquent l’intérêt du public pour les personnages en tant que personnes plausibles, et pour le monde narratif en tant que semblable au nôtre, les réponses à la composante thématique impliquent un intérêt pour la fonction idéologique des personnages et pour les questions culturelles, idéologiques, philosophiques ou éthiques abordées par le récit, tandis que les réponses à la composante synthétique impliquent l’intérêt et l’attention du public à l’égard des personnages et du récit dans son ensemble en tant que constructions artificielles.
L’acte de « répudier » un récit, suggère Phelan dans la dernière partie du volume, dérive le plus souvent du désaccord que nous ressentons à l’égard des éléments thématiques de l’œuvre. Un tel désaccord peut être productif si nous continuons de reconnaître au texte la capacité de produire une synthèse entre ces éléments avec les composantes mimétiques qui rendent le récit plausible, sans ainsi perdre totalement notre respect pour lui. Dans ce cas, « nous parlons avec le texte et son auteur plus comme des égaux, nous reconnaissons leur pouvoir, mais pour cette raison même, sommes obligés de réfléchir sérieusement à la nature et à la signification de leurs limites » (p. 201). C’est du dialogue qui s’établit à partir de ces moments de rejet que nous sommes amenés à repenser nos croyances et engagements les plus fondamentaux, non seulement ceux que nous entretenons avec la littérature, mais aussi et surtout avec notre vie.
Matilde Manara - Configurations littéraires