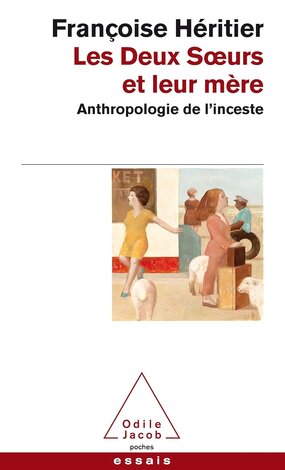La démarche de Françoise Héritier dans Les Deux Sœurs et leur mère (1994) a pour point de départ la perplexité : comment expliquer que des situations qui ne relèvent pas de l’inceste tel qu’il est ordinairement conçu, à savoir comme « conjonction illicite entre des personnes qui sont parentes ou alliées au degré prohibé par les lois » (Le Grand Littré), soient pourtant considérées comme tel, voire prohibées et condamnées au même titre ? En quoi le triangle formé par deux sœurs et leur amant commun est-il incestueux ? Pourquoi, dans le Coran, une relation sexuelle entre un homme et la fille de son épouse est-elle autorisée avant l’union charnelle avec la mère, et proscrite après ? Comment comprendre le malaise d’un professeur de psychologie américain déclarant au sujet de la liaison de Woody Allen avec Soon-Yi, la fille adoptive de son ex-compagne Mia Farrow : « c’est de l’inceste, même si cela n’en est pas vraiment » (p. 357) ?
Cette nébuleuse de cas, présents au cours de l’histoire sous une multitude de configurations dans toutes les aires géoculturelles, met en déroute les théories de l’inceste (Durkheim, Freud, Lévi-Strauss). Pour combler ce blanc, Françoise Héritier apporte une double réponse conceptuelle et théorique. D’une part, plaidant en faveur d’un élargissement de l’inceste par rapport à sa « définition usuelle, mais trop étroite », elle introduit le concept d’« inceste du deuxième type » (p. 11), que l’on pourrait définir comme le partage d’un partenaire sexuel par deux personnes apparentées (deux sœurs, une mère et sa fille, deux frères, un père et son fils), et qui, contrairement à l’inceste du premier type ne fait pas l’objet d’une prohibition universelle. Selon elle, et il s’agit là d’une révolution épistémique, l’inceste du deuxième type serait « l’origine et la raison d’être de la prohibition de l’inceste » (p. 13) du premier type, ou du moins il en constituerait « la seule explication anthropologique cohérente » (p. 305). C’est là que, d’autre part, prenant ses distances avec la théorie jugée incomplète de Lévi-Strauss (p. 203-204), elle déplace la compréhension de la prohibition de l’inceste d’une économie sociale, fondée sur l’échange des biens et des femmes, vers le « primat du symbolique » (p. 23, 365) ancré dans le biologique. À travers le partenaire sexuel commun, l’inceste du deuxième type réalise une « mise en contact » (p. 11) d’humeurs corporelles identiques : une mère et sa fille, « qui partagent une substance corporelle commune », risquent en ayant le même partenaire « de faire se toucher cette identité de chair » (p. 38). Ce qui est toujours mis en jeu, c’est le partage structurant dans les systèmes de représentations humains entre l’identique et le différent, qui culmine selon Françoise Héritier dans la différence des sexes. Selon elle, « l’identité la plus fondamentale est celle du genre et non celle qui naît des rapports biologiques ou sociaux de consanguinité » (p. 14). Si l’inceste du premier type est scandaleux dans une société qui évite le cumul de l’identique, c’est parce qu’il met en contact le même (par exemple, le père et le fils) à travers un partenaire commun (la mère), renvoyant ainsi à l’inceste du deuxième type. Le vrai crime d’Œdipe, selon Françoise Héritier, serait alors moins d’avoir couché avec sa mère, que d’avoir, en elle, couché avec son père (p. 308). C’est à la lumière de cette structure que Françoise Héritier interprète les variations ethnologiques sur l’interdit majeur : la définition de l’inceste, partant sa prohibition, se comprend en fonction de la « définition de l’identique propre à chaque société » (p. 195-196), ainsi que de la valeur attribuée à chaque pôle :
Si le « cumul de l’identique » est censé produire des effets néfastes, il sera prohibé, tandis que la juxtaposition ou la combinaison d’éléments différents sera recherchée. Inversement, si le cumul de l’identique produit des effets fastes, il sera recherché et on évitera d’associer des choses différentes. (p. 235)
Ce cadre posé, Françoise Héritier montre la prégnance de l’inceste du deuxième type dans l’histoire des sociétés humaines en combinant trois approches. La première partie traque l’interdit des « deux sœurs » dans les textes juridiques (textes hittites et assyriens, Code civil, loi roumaine), religieux (Bible, Coran, pensée chrétienne médiévale), philosophiques (Platon, Aristote) et littéraires (tragédies grecques, Ovide). Rarement explicité pour passer « par le sous-entendu des mots » (p. 53), la prohibition de l’inceste du deuxième type au nom d’une « identité de substance » (p. 38) entre parents, dont le rapprochement, par un tiers, fait courir le risque du « court-circuit avec soi-même » (p. 74), se décèle « à partir des entours des textes, de leur construction et du sens réel des mots qui ont été choisis » (p. 84). À l’approche historique s’articule donc l’examen philologique des expressions servant à dire et à interdire l’inceste dans une civilisation donnée (en un même lieu, nudité, una caro). La deuxième partie, ethnologique, étudie le système matrimonial des Samo (Nord-Ouest du Burkina-Faso), qui constitue le premier cas africain recensé de système de parenté type « omaha », un système de filiation patrilinéaire qui ne prescrit ni ne recommande d’alliance préférentielle, mais interdit certains lignages, en l’occurrence le sien propre, le maternel et le grand-maternel. Il apparaît que ce système complexe en apparence prohibitif, qui semble pousser à l’exogamie, permet au contraire de rester entre soi : « c’est la prolifération même des interdits qui permettait de choisir son conjoint au plus près, sans enfreindre de règle » (p. 152). Une condition à cela : ne pas « apparier des identiques » (p. 156), l’identité passant par le sexe – s’il est interdit pour une femme d’épouser le mari ou le frère du mari de sa sœur, il est en revanche possible d’épouser le frère de l’épouse de son frère. Dans cette répugnance à mettre en contact, par partenaires interposés, le même, il y a bien, selon Françoise Héritier, « la conscience et le refus de l’inceste du deuxième type » (p. 196), dont la troisième partie interroge le fond anthropologique. Remontant aux invariants du partage de l’identique et du différent, l’anthropologue entend « débusquer la raison d’être des interdits en explicitant le système de représentations qui leur donne une justification et leur confère une légitimité » (p. 238), ce qui lui permet de rassembler des prohibitions de parenté (parenté de sang, parenté spirituelle) et des délits sexuels très divers sous le même paradigme d’interdit des « deux sœurs ».
La théorie unitaire de Françoise Héritier, mise en perspective par la critique de Bernard Vernier, laisse des zones d’ombre et induit des biais. Premièrement, le primat accordé au corporel dans la relation entre deux sœurs ou entre la mère et la fille, occulte sa dimension psychologique, brièvement évoquée (p. 353-354), sans que les mécanismes de rivalité, de procuration, d’emprise ou de fusion narcissique soient exploités. Deuxièmement, même si l’inceste du deuxième type concerne des situations extra-maritales, son identification, en raison de son caractère implicite, continue de passer principalement par les lois et les normes régissant l’échange matrimonial, et plus marginalement par les interdits sexuels. Attirer « l’attention sur cette part oubliée de la prohibition de l’inceste » (p. 23) a pour conséquence de rejeter dans l’ombre tout un pan de l’inceste, notamment l’une des configurations auxquelles le XXIe siècle semble faire cas : le viol incestueux perpétré sur les mineurs au sein de la famille, que la théorie et la terminologie proposées par Françoise Héritier ne parviennent guère à saisir dans sa spécificité. C’est notamment, et ce serait là le troisième point, parce que l’inceste appelle aussi une analyse sociologique, à même de comprendre en quoi sa prohibition n’empêche en rien, au contraire, sa pratique, qui tient aux mécanismes de la domination, du silence et du secret, analysés par Dorothée Dussy dans Le Berceau des dominations, ainsi qu’au poids d’une « culture de l’inceste », comme le suggère le collectif dirigé par Iris Brey et Juliet Drouar (2022), dans une société prohibitive en droit mais tolérative de fait. L’idée d’une « culture hantée » par le spectre de l’inceste surgit à la fin des Deux Sœurs, lorsque l’anthropologue examine des productions culturelles des années 1970-1990 où l’inceste du premier et du deuxième type a la part belle. Ressort dramatique, l’inceste apparaît surtout comme un imaginaire omniprésent qui imprègne les fictions populaires, en témoignent encore aujourd’hui les séries adaptées de la saga de G. R. R. Martin, Game of Thrones (2011-2019) et The House of the Dragon (2022-), diffusées sur la chaîne américaine HBO. Il faudrait alors se demander si cet imaginaire, dont Les Deux Sœurs et leur mère se contente de noter l’immémoriale présence, n’est pas en passe d’être révisé par des textes (Triste Tigre, N. Sinno) et des enquêtes (le rapport de la Ciivise de 2023, le tract du Juge Durand de 2024) qui, en plaçant le curseur du côté de l’expérience vécue et de l’ampleur statistique de l’inceste pour le vider de sa part abstraite et fantasmatique, participent de l’élaboration d’un regard critique à même de créer en retour une brèche dans les représentations.
Les Deux Sœurs et leur mère. Anthropologie de l’inceste, s’il se propose de réviser les théories antérieures sur l’inceste, reproduit néanmoins en partie leurs effets : la théorie de l’inceste fait paradoxalement écran à l’inceste lui-même. Du XXe au XXIe siècle, un changement de paradigme, voire une révolution morale, semble en cours : le temps des systèmes pourrait faire place à la saisie sociologique et institutionnelle de l’inceste, qui, en se tournant vers ses formes, ses logiques et ses conséquences effectives et concrètes, l’arrache à la sphère de l’interdit et du tabou pour le ramener à la réalité d’une pratique sociale.
Bibliographie indicative :
- Iris Brey et Juliet Drouar (dir.), La Culture de l’inceste, Paris, Seuil, 2022.
- Édouard Durand, 160 000 enfants. Violences sexuelles et déni social, Paris, Gallimard, 2024.
- Dorothée Dussy, Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste [2013], Paris, Pocket, 2021.
- Claude Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté [1947], Paris, La Haye, 1967.
- Bernard Vernier, La Prohibition de l’inceste. Critique de Françoise Héritier, Paris, L’Harmattan, 2009.