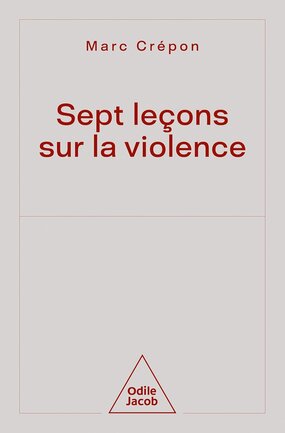Dix ans après La Vocation de l’écriture. La littérature et la philosophie à l’épreuve de la violence (Odile Jacob, 2014), Marc Crépon entreprend d’écrire une « autre critique de la violence » (p. 15), qui n’en fait ni l’histoire, ni l’anthropologie, car il s’agit d’« éviter le piège de sa justification » (p. 117), mais reconsidère son « expérience » (p. 13), absente de la plupart des philosophies de la violence (Benjamin, Arendt). Déplaçant le curseur des causes vers les effets, Sept leçons sur la violence aborde l’éventail de ses manifestations (violences politiques, sociales, domestiques, sectaires) à travers une conséquence commune, sa « destructivité » (p. 14), qui affecte singulièrement chaque vie. C’est dans cette « attention […] à ces effets de la violence » (p. 15) présente partout et pour tous que le philosophe cherche à fonder conjointement l’éthique et le politique.
La perspective englobante adoptée dans Sept leçons sur la violence demande au préalable une définition qui le soit tout autant. Selon Marc Crépon, la violence est une atteinte à la singularité, laquelle doit être doublement comprise. « Relationnelle » (p. 18), la singularité s’invente d’abord comme « tissu de relations » (p. 129) : avec chaque être vivant, chaque lieu, chaque institution, se crée un lien de « commune interdépendance » (p. 18) qui implique un « minimum de continuité » (p. 130) ainsi qu’une « fiabilité minimale » (p. 131). « Infinie » (p. 27) ensuite, la singularité est un « irréductible excès » (p. 133), celui d’une « transcendance » (p. 23, 133) toujours au-delà de ce qu’il est possible de dire, de connaître et de comprendre. Toute manifestation de violence s’entend alors comme « la destruction de la fiabilité et la réification » (p. 26) : parce qu’elle « compromet la relation » par « rupture de la confiance » (p. 131), et qu’elle « réduit à l’état d’une chose, d’un matériau brut sur lequel s’applique une force contre sa volonté » (p. 132), la violence est « une négation radicale, brutale, toujours soudaine et indéfiniment réitérée, de la singularité » (p. 133). Cette définition posée, Marc Crépon interroge ses ressorts en reprenant à ses précédents ouvrages des concepts réarticulés à la démonstration d’ensemble. En amont, la violence est préparée par une « sédimentation de l’inacceptable » (La Culture de la peur, t. I, 2008), à savoir
l’incorporation de manières de juger, de dire et, au bout du compte, de faire avec, c’est-à-dire de traiter telle catégorie déterminée d’individus d’une façon qu’on n’aurait jamais imaginé devoir ni même pouvoir accepter un jour, à moins qu’on en ait hérité et qu’on n’ait jamais appris à faire autrement. (p. 31)
En aval, elle est tolérée par un « consentement meurtrier » (Le Consentement meurtrier, éditions du Cerf, 2012), entendu comme une transaction avec un nouvel impératif catégorique censé régir toute relation à autrui, en principe « fondée sur la responsabilité de l’attention, du soin et du secours qu’appellent de partout et pour tous sa vulnérabilité et sa mortalité » (p. 74). En pratique, le constat d’une « “pleurabilité” inégale des vies » (p. 25), selon le concept emprunté à Judith Butler (La Force de la non-violence, Fayard, 2020), montre une tendance à la« relativisation de la violence » (p. 78) au quotidien. C’est contre cette indifférence, ou plutôt cette différence de traitement éthique et empathique, implicitement fondée sur le triage inconscient des vies singulières, de leur valeur, de leur dignité, que Marc Crépon invite à penser et à appliquer l’« obligation mondiale » (p. 75) d’un « appel hyperbolique de la responsabilité » (p. 74), fondée sur la « reconnaissance de l’interdépendance des êtres vivants » et « la considération des liens qui nous attachent les uns aux autres » (p. 75-76).
Dans la seconde partie, « Violences de l’intime », en particulier dans la sixième leçon, « Violences domestiques », Marc Crépon prête attention aux violences que le déplacement du « seuil de tolérance » (Inhumaines conditions. Combattre l’intolérable, Odile Jacob, 2019) a arrachées au secret de la vie privée, pour les rendre visibles, audibles et appréhensibles par la société publique. Ce « recul sans précédent de notre seuil de tolérance à l’égard des destructions intimes » (p. 150) est selon lui le signe d’une révolution marquée par « un progrès, indissociablement moral et politique » (p. 150), dont on développera trois aspects.
L’intolérance concomitante à l’égard des violences exercées contre les femmes et les mineurs au sein du foyer s’explique d’abord par la « remise en question radicale de la domination patriarcale comme modèle familial » (p. 155). Sans que l’idée soit formulée en ces termes, il semblerait que la « sédimentation de l’intolérable » trouve un remède dans le décapage des discours, des images et des mythes sur lesquels se fonde l’idéologie de la famille, lequel dépend de la capacité à accueillir et relayer collectivement les voix singulières des victimes.
Sollicité par la Ciivise en 2023, Marc Crépon rappelle que la rhétorique de la « prétendue “libération” » (p. 139) des mœurs a, sous le couvert de la révolution sexuelle, occulté la destructivité des violences sexuelles sur mineurs, dont le XXIe siècle prend tout juste la mesure, notamment sous l’impulsion de la littérature (Le Consentement, V. Springora, La Familia Grande, C. Kouchner). À la lumière de sa définition bipartite de la violence, il montre que les violences sexuelles dévoient l’enfance en tant que relation au corps et que potentialité infinie. D’une part, dès lors que l’une des premières relations que l’on tisse est celle qui unit à son propre corps, l’intercession des désirs de l’adulte dans cet apprentissage de soi par soi empêche « de s’approprier son propre corps à son rythme » (p. 137) : la violence vient du « forçage d’une appropriation de l’autre et par l’autre » (p. 138), qui court-circuite la relation au corps de l’enfant et le rend « étranger à lui-même » (p. 139). D’autre part, l’abus de l’adulte dans le cadre d’une relation d’autorité a pour conséquence de ruiner la confiance à la base de toute relation au monde : il en résulte une « perversion de la confiance » et une « destruction de la pluralité et de la variabilité qui définissent l’ouverture sur l’avenir du monde de l’enfance » (p. 142), qui mettent en péril voire ruinent sa singularité infinie à venir.
Enfin, le système de défense, la logique du déni et l’injonction au silence imposés par la société pour étouffer le scandale représenté par la révélation des violences domestiques, amènent Marc Crépon à politiser la notion de « consentement meurtrier », envisagé comme « une éclipse davantage qu’une suspension » de « la responsabilité de l’attention, du soin et du secours qu’appellent de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d’autrui » (p. 148) :
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit précisément non pas d’une mise entre parenthèses, mais d’un véritable effacement, d’une disparition, d’une invisibilité. Et ce qui est significatif alors tient à la façon dont l’éclipse engage l’idée qu’un ordre donné, avec la hiérarchie des pouvoirs qui l’organise, se fait de sa propre responsabilité qui est d’une tout autre nature, dès lors qu’il s’agit pour ledit ordre, ladite hiérarchie, ledit pouvoir, de se préserver, de se protéger, de se sauver peut-être. (p. 148)
La responsabilité éthique se trouve supplantée par une responsabilité dite politique qui n’est, en réalité, que la sauvegarde des intérêts des dominants. Pour que la révolution morale soit complète, reste encore à voir s’accomplir un « renversement du rapport de force entre les deux responsabilités conflictuelles » (p. 150), par « le vecteur d’une injonction adressée au politique » (p. 153) faite au nom des victimes de violences dont, désormais, on sait que « le pouvoir est comptable » (p. 51).
Bibliographie :
Hannah Arendt, Du mensonge à la violence, Paris, Calmann-Lévy, 1972.
- Walter Benjamin, Critique de la violence, Paris, Payot, [1921] 2018.
- Judith Butler, La Force de la non-violence, Paris, Fayard, 2021.
- Marc Crépon, Le Consentement meurtrier, Paris, éditions du Cerf, 2012.
- Marc Crépon, La Vocation de l’écriture : la littérature et la philosophie à l’épreuve de la violence, Paris, Odile Jacob, 2014.