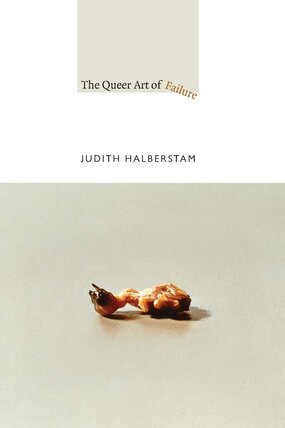Qu’il s’agisse des politiques pour l’allocation de bourses d’études ou du choix dans le lancement d’une thérapie, l’un des critères de triage les plus répandus et les moins contestés concerne le couple de notions échec-réussite. L’essai The Queer Art of Failure de Jack Halberstam se propose de revenir sur les impensés liées à ce couple, pour réfléchir à la manière dont il structure nos comportements, nos représentations et nos relations. Halberstam travaille à la croisée des medias et des queer studies afin de proposer une lecture aussi interdisciplinaire qu’anti-disciplinaire de l’échec en tant que catégorie d’interprétation du monde. « L’échec », annonce-t-il en ouverture au volume « est une chose dans laquelle les personnes queer ont toujours très bien réussi » (p. 13, ma traduction). L’objectif qu’il se donne pour les pages suivantes consiste à comprendre l’échec non seulement comme un phénomène qui façonne la manière d’être, de connaître ou d’agir d’un groupe spécifique d’individus – individus qui se trouvent culturellement marginalisés ou vulnérables pour différentes raisons précédentes à l’échec – , mais aussi comme modèle d’un renouveau éthique, esthétique et épistémologique. À cet effet, il procède à la remise en question des valeurs positives qui participent de l’idée de succès (la motivation, la mémoire, la constance) et qui, à son avis, découlent en grande partie du mode de vie capitaliste et néo-libéral. Une fois ces valeurs déconstruites, il se penche sur les émotions négatives généralement associées à l’échec (l’humiliation, la honte, le sentiment d’inaptitude) et les regarde comme des moyens d’émancipation. La capacité reproductive et l’accumulation des richesses sont deux signes du succès social, postule Halberstam, mais puisque la crise des marchés financiers et des institutions a bouleversé cet état des choses, il faut chercher « d’autres phares » (p. 40) pour nous orienter. « Si les années de boom et de récession de la fin du XXe siècle et du début du XXIe nous ont appris quelque chose » continue-t-il, « c’est qu’il faut au moins avoir une critique saine des modèles statiques de succès et d’échec » (ibid.). Boucs émissaires de la culture du succès, les personnes queer sont précisément les personnes capables de renverser l’état des choses et d’ouvrir un espace de possibilités non prévues par la distribution normative des pratiques ou des discours. Par le fait d’être exclues ou de se soustraire à l’impératif du self-made man, leur échec peut en fait expliquer et contrecarrer le déterminisme social qui règle notre quotidien. La défaite est accompagnée d’émotions négatives, mais leur offre un moyen de tisser des liens communautaires alternatifs, bâtis sur un « optimisme autre » (p. 75) que celui dont on fait généralement l’éloge.
Halberstam se réclame de la low theory – approche postcritique consistant à mettre en valeur, dans la connaissance théorique, les éléments de détour ou d’incertitude plus que les assomptions valides– et de la silly archive – la constitution d’un corpus de référence qui mélange volontairement références érudites et culture populaire dans le but de donner une complexité à l’analyse ainsi que de lui faire atteindre un plus large public. Il met ainsi Jacques Rancière en dialogue avec South Park, se penche sur la comédie trash Dude, where’s my car ? avec les outils d’Althusser, ou encore offre une lecture gramscienne de Bob l’éponge : « Nous pouvons penser à la low theory et au sillyarchive comme à des sortes de modèles passés sous le radar, assemblés à partir de textes et d’exemples excentriques qui refusent de confirmer les hiérarchies de la connaissance » (p. 22). L’auteur part du constat que, tout comme ceux qui préparent des repas ou réparent des vêtements ne sont pas nécessairement des chefs ou des tailleurs, ceux qui participent à la production culturelle d’une société ne sont pas des intellectuels. Si la distinction entre savoir traditionnel d’une part et savoir postcritique d’autre part est pour lui importante, c’est qu’elle témoigne de la tension existante entre des connaissances disciplinaires (c’est-à-dire visant, autant par la forme que par le contenu, à reproduire les rapports et les normes en vigueur) et des connaissances indisciplinées. « Les disciplines qualifient et disqualifient, légitiment et délégitiment, récompensent et punissent », précise-t-il, « et plus important encore, elles se reproduisent statiquement en inhibant toute dissidence » (p. 24).
Bien qu’il ait été publié chez l’un des éditeurs universitaires les plus prestigieux, The Queer Art of Failure se propose de fouiller dans ces produits artistiques que l’université n’a pas jugés suffisamment fins pour faire l’objet d’une théorisation. En se proposant d’identifier des représentations alternatives, mais potentiellement jubilatoires, de l’échec, Halberstam suggère qu’il existe une autre manière, non sérieuse mais pas pour autant velléitaire, de lire un texte ou un film de manière critique. Le parcours accompli par la protagoniste de Little Miss Sunshine (2006), une jeune fille à la famille dysfonctionnelle ayant pour objectif de remporter un concours de beauté, devient ainsi l’exemple de cette approche : si la victoire manquée d’Olive est source d’humiliation pour la petite, elle s’accompagne aussi d’une prise de conscience épiphanique sur la précarité du succès et sur la valeur des liens affectifs. De même, dans Le monde de Nemo (2003), les troubles cognitifs du poisson Dory et ses nombreux égarements servent de point de départ pour discuter le lieu commun de la mémoire comme valeur a priori positive. En étudiant ce dessin animé Pixar à travers le prisme de Beloved (1987) de Toni Morrison, de Lose Your Mother (2008) de Saidiya Hartman et de Ghostly Matters (1996) d’Avery Gordon, Halberstam avance l’idée selon laquelle certaines formes d’effacement fonctionneraient mieux que certains dispositifs de mémorisation précisément parce que « la mémorisation a tendance à ranger des histoires désordonnées (de l’esclavage, de l’holocauste, des guerres, etc.) […] » (p. 103). En tant que « mécanisme disciplinaire », la mémorisation à des fins mémorielles peut opérer comme un « pouvoir qui sélectionne ce qui est important (les histoires de triomphe) » (ibid.) au détriment de ce qui ne l’est pas. À l’instar du discours littéraire, celui sur la mémoire devrait aussi éviter d’aplatir les ruptures et les contradictions communes aux récits de témoignage. L’oubli, précise-t-elle, « peut être un moyen de résister aux logiques héroïques et grandioses de la célébration » (p. 105) et par là « libérer de nouvelles formes de mémoire qui se rapportent plus au fantasme qu’à la preuve tangible, plus aux généalogies perdues qu’à l’héritage, plus à l’effacement qu’à l’inscription » (ibid.).
Par son exploration des contrary epistemologies (les épistémologies issues d’une « forme de pensée qui a été culturellement effacée », p. 201), Halberstam aborde l’échec à la fois en tant que forme de connaissance et en tant qu’acte de résistance. Son livre nous offre certes un regard différent sur la manière dont nous jugeons esthétiquement ou éthiquement cette catégorie, mais il reste à se demander si, par le fait de remettre en question le monopole du succès et sa légitimité dans nos échelles de valeurs, l’auteur est vraiment en train de hisser l’échec à la tête d’un modèle opérationnel pour la construction ou la redéfinition de notre rapport au savoir. Remplacer le succès par l’échec, ne reviendrait-il pas à simplement renverser le binarisme en continuant de mener une pratique de triage parfois douteuse ? Et surtout, comment embrasser avec enthousiasme une défaite lorsque les conditions matérielles de nos vies nous empêchent de tirer un profit intellectuel ou émotionnel de cette expérience, comme ce serait le cas pour quelqu’un se voyant refuser un soutien financier ou l’admission à un parcours universitaire au vu d’un examen non réussi ou d’une moyenne insuffisante ? Si la logique de l’échec structure nos quotidiens et nos représentations, est-ce qu’il revient à ceux qui en subissent les conséquences d’en tisser malgré tout l’éloge, ou bien aux institutions qui la perpétuent d’en redéfinir l’application ?
Matilde Manara - Configurations Littéraires