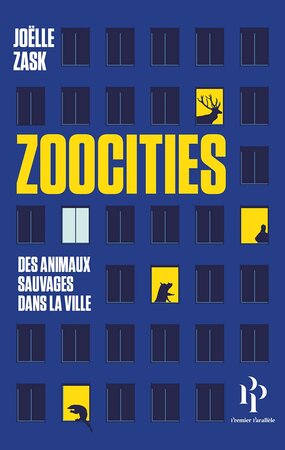Chacun se souvient de l’émoi qui provoquèrent, au moment des confinements imposés par l’épidémie de Covid-19, les images de bêtes sauvages circulant sur les trottoirs et dans les parcs de villes désertées : famille de canards paradant devant la Comédie Française, hordes de sangliers à Barcelone, dauphins dans le parc national des Calanques, etc. L’essai de Joëlle Zask avance que cette présence animale, abondamment relayée par les réseaux sociaux, est loin de constituer une exception : tout au plus manifeste-t-elle un état de fait, rendu plus aisément perceptible par l’interruption des activités humaines. Zoocities se fonde dès lors sur l’inversion de la morale d’une célèbre fable de La Fontaine, que la philosophe cite à plusieurs reprises : à présent que l’habitat des animaux campagnards est de plus en plus menacé et que les villes, non contentes d’offrir de la nourriture et de l’eau en abondance, font l’objet de politiques d’écologisation de plus en plus importantes, « c’est […] bien le rat des villes qui a raison », ce que manifeste un exode rural animal de plus en plus important. Les espèces concernées sont nombreuses et variées (renards, ours, ratons-laveurs, paresseux, éléphants, léopards, chacals, faucons, goélands, hérissons, pygargues à tête blanche, phoques, coyotes, serpents de tous types, etc.), tant et si bien que l’autrice en vient à avancer que « le “grand remplacement” annoncé par des groupes d’extrême droite depuis la fin du XIXe siècle pourrait bien s’avérer non pas interhumain et interracial, mais inter-espèces. » L’objectif de ce livre n’est pas de comprendre les motivations de cet exode, qui varient selon les espèces et les individus, mais de le prendre au sérieux, en ne le considérant pas comme une touchante « erreur » de l’animal, qu’il s’agirait dès lors de relocaliser, et d’en envisager ensuite les conséquences éthiques aussi bien que pratiques. Joëlle Zask entend à ce titre contribuer à pallier une « carence à la fois légale et culturelle, qui témoigne d’une ville pensée sans l’animal » et « l’absence de sciences dédiées à l’étude de celui qui s’y trouve cependant » (la spécialité ayant pour nom urban wildlife studies n’est apparue qu’au tournant des années 2010 et traite essentiellement l’animal comme un problème, en se concentrant sur « la gestion des animaux sauvages en cas de relations conflictuelles avec les humains et [les] valeurs morales qui devraient inspirer leur résolution »).
La présence des animaux dans les environnements urbains invite d’abord à remettre en cause un raisonnement fondé sur l’opposition du sauvage et du civilisé, laquelle admet « très mal le phénomène, pourtant planétaire et universel, de la migration ». Elle impose aussi une meilleure éducation des nouvelles générations à l’éthique animale et à l’éthologie (ce à quoi Joëlle Zask s’emploie elle-même dans son remarquable guide des bonnes pratiques, Face à une bête sauvage, 2021). Un tel travail des consciences impose un changement de perspective : « face à l’urgence écologique, il n’est pas souhaitable de classer les animaux en fonction des affects qu’ils font naître en nous, comme le proposait Spinoza. Il s’agit au contraire de travailler les affects de manière à éviter toute classification ». De façon plus cruciale encore, la présence animale dans l’espace urbain constitue l’occasion d’imaginer des « villes qui, à terme, seraient écologiques, au sens où, loin d’avoir une existence hors contexte, dans les airs, et sans habitants, elles parviendraient à inclure des éléments étrangers par rapport au plan initial – hommes, bêtes, plantes, etc. – au titre de partenaires et de voisins ». À ce titre, adapter l’environnement urbain à la présence animale constituerait également un service rendu à la population humaine des villes – non pas que cette dernière puisse tirer des bénéfices directs de ce nouveau voisinage (l’autrice évoque ainsi le cas de l’engouement pour les abeilles productrices de miel, qui conduisit à l’installation de nombreuses ruches en ville, mais s’est aussi soldé par l’extinction des abeilles sauvages : les maçonnes, les tapissières, les charpentières et les cotonnières), mais parce que cette transformation du paysage urbain permettrait la construction d’un cadre de vie meilleur : « […] grâce à quelques bêtes sauvages en vérité peu spectaculaires, c’est une promesse de cité qui est apparue. Nous n’avions pas perçu qu’il restait du sauvage dans la ville. Nous avons réalisé qu’elle avait le potentiel d’un écosystème et que c’était dans ce sens qu’il fallait la transformer ». Le constat de la présence des animaux, qui constitue, selon les termes de Thoreau, « un événement dont nous savons que nous ne pourrons pas faire le tour » devient ainsi le point de départ d’une révolution morale qui aboutit à une transformation de notre façon de concevoir l’espace urbain.
Opposant la ville et la cité, Joëlle Zask avance que la première est fondamentalement « antidémocratique » et « expulse les gens hors de leur propre vie pour leur imposer un ordre invariant qui neutralise leur volonté et qui les contraint, idéalement, à adhérer collectivement au plan d’ensemble. » Dans la définition qu’en propose Aristote, la cité est au contraire « composite, associative, congruente, plurielle », ce qui fait que si « elle avance trop sur la voie de l’unité, une cité n’en sera plus une, car la cité a dans sa nature d’être une certaine sorte de multiplicité. » La cité multispéciste et évolutive dont l’essai se propose de tracer les contours, en articulant étroitement les espaces complémentaires que constituent les « niches » et les « corridors », est « une jungle au sens où les modes de vie animaux, qu’il faudrait pouvoir préciser un à un, l’enrichissent de dimensions sur lesquels le contrôle humain au sens usuel ne doit pas et, souvent, ne peut pas s’exercer. » Son modèle n’est plus celui du « zonage urbain » et de ses quartiers spécialisés, mais des « espèces d’espaces » imaginés par Pérec, « espaces variables selon les usages, les organismes, les époques, les lieux, et auxquels, en vertu d’une petite bifurcation, d’une simple observation, d’un exercice de perception, on pourrait accéder, en se dépaysant ».
Cette invitation au dépaysement ne doit pas cependant être lue comme une incitation à rechercher le contact animal. Les pages les plus stimulantes de cet essai sont peut-être celles où Joëlle Zask s’essaie à penser un nouveau rapport à l’animal, qui ni soit celui de la domestication ni celui du rejet dans l’authenticité fantasmée d’une sauvagerie inentamée que le séjour à la ville viendrait nécessairement corrompre. La philosophe note à ce titre que « l’écologie du voisinage est celle de la bonne distance », rappelant plus prosaïquement qu’un dicton américain veut qu’un ours nourri soit un ours mort (car, ayant pris le pli d’attendre sa nourriture des hommes, il ne cessera de venir la chercher et finira sans doute par devoir être supprimé). En matière de relation interspécielle, elle invoque donc une « éthique minimale », consistant, selon la formulation de Ruwen Ogien, à « ne pas nuire aux autres » et note que « paradoxalement, l’éthique qui consiste “seulement” à ne pas nuire à un animal aboutit à une relation plus exigeante et plus engageante que de se borner à ne pas le tuer ou ne pas le faire souffrir. Elle inclut le respect de son milieu » et suppose la préservation de son indépendance, que la philosophe présente comme une « notion multispéciste ». Préconisant un « laisser vivre » qui n’est en aucun cas un « laisser faire », Zoocities se situe à mille lieues de son quasi-homonyme fictionnel, dû à la romancière sud-africaine Lauren Beukes (Zoocity, 2010). Alors que celle-ci imagine un monde dystopique, où les citoyens reconnus coupables d’une faute légale ou morale se trouvent dotés d’un inséparable double animal, la philosophe nous rappelle que la cohabitation avec les bêtes n’est pas du ressort de la fiction, ni de la magie, mais constitue une réalité de plus en plus présente, exigeant un changement majeur de nos représentations et de nos modes de vie : « le problème n’est […] pas d’accéder à un point de vue sans biais, par définition inaccessible, mais de transformer la manière dont nous nous représentons le monde. Celui que nous pensons pouvoir administrer, régenter, contrôler ou, à l’inverse, contempler comme quelque chose d’extérieur n’est pas le monde que les animaux nous poussent à considérer, celui que nous savons être imprévisible et dont nous nous sentons partie prenante. »
Ninon Chavoz - Configurations littéraires