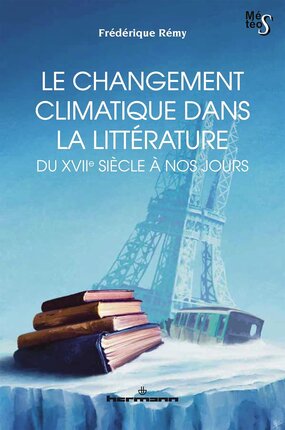Si le sens moderne du mot « climat » apparaît à la fin du XVIIIe siècle, l’homme occidental forme à son sujet, depuis l’antiquité, grand nombre d’observations, d’analyses et de modélisations afin de l’expliquer, de le comprendre et de le prévoir. Ce constat d’un intérêt millénaire est le point de départ de l’enquête passionnante de Frédérique Rémy, spécialiste de l’histoire du climat et lectrice passionnée de littérature dans son dernier ouvrage Le Changement climatique dans la littérature du XVIIe siècle à nos jours.
En cinq chapitres chronologiques, Frédérique Rémy retrace non seulement l’histoire d’un thème dans la littérature occidentale, qui serait celui du climat, mais plus précisément celle d’une interrogation envers sa nature et ses enjeux. Le climat varie-t-il seulement de manière cyclique ou évolue-t-il également sur le temps long ? L’homme peut-il espérer le maîtriser voire le transformer à son profit (réel ou illusoire), peut-il en rompre la périodicité voire le « dérégler » ? Ce qu’on pourrait appeler la littérature climatique forme ainsi un ensemble hétérogène en termes de genres, qui mêle à toutes les formes de fiction celles de l’essai scientifique, de l’analyse philosophique et du manifeste politique, mais elle trouve une unité de fond dans l’expression d’une préoccupation envers les conditions météorologiques et atmosphériques dans lesquelles l’homme, mais aussi les autres espèces, évoluent dans les différentes régions du monde[1].
On ne sera guère surpris que l’histoire de cette littérature climatique suive les grandes étapes de l’histoire, souvent rapportée, du rapport de l’homme et de la nature, lesquelles recoupent en grande partie celles du développement des techniques, de l’industrialisation et des transformations du paysage : le milieu du XIXe siècle voit se démultiplier un imaginaire climatique fécondé par la science et par les théories plus ou moins solides qu’elle fait émerger. Si l’idée d’une vulnérabilité climatique de l’homme s’impose de plus en plus, c’est vers le milieu du XXe siècle que l’effroi, l’inquiétude ou la curiosité font massivement place à une prise de conscience progressive et essentiellement individuelle du « rôle néfaste [de l’homme] sur la nature » (p. 91). En modifiant le regard sur les progrès technologiques et industriels, cette prise de conscience engendre ce qui apparaît bien comme une « révolution morale » qui redéfinit l’écologie[2] non plus seulement comme la science des conditions d’existence des espèces et de leurs relations[3], mais comme une position politique et une responsabilité anthropologique. La fondation en 1988 du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) marque pour Frédérique Rémy la fin de ce qu’elle nomme la « période intermédiaire », ou encore « transition », avant l’institutionnalisation et la massification de la préoccupation climatique. L’élaboration de politiques publiques et de programmes scientifiques dédiés au « changement climatique » en tant que phénomène provoqué par l’homme en forment le versant optimiste ; l’inaction ou l’impuissance, ainsi que les contre-discours de vérité, le versant pessimiste. « L’épilogue » ne peut conclure une histoire littéraire qui dans les décennies actuelles semble s’accélérer tout en se heurtant à une forme de limite : comment inventer des phénomènes si exactement décrits par la science, comment imaginer l’après d’un cataclysme annoncé, comment réenchanter le climat ?
Mais Frédérique Rémy ne semble pas avoir écrit ce livre pour nourrir un propos militant ou pour saluer l’engagement des auteurs de fiction en matière climatique. L’histoire propre des phénomènes naturels, celle des sciences et des techniques, voire l’influence décisive de certains penseurs, ne sont jamais ici sacrifiées sur l’autel d’une démonstration. Les vastes connaissances de l’autrice en matière de climatologie – on pourra lire l’Histoire de la glaciologie[4] entre autres ouvrages fort documentés de cette chercheuse au CNRS – apportent à cette histoire littéraire des jalons parfois peu familiers aux lecteurs non spécialistes : passages de comètes, évolutions des températures, modifications des marées, etc., n’ont cessé de bousculer les théories et les représentations climatiques en imposant des questionnements voire des inquiétudes nouvelles. On comprend par exemple que la baisse mondiale des températures, au milieu du XXe siècle (p. 97 sq), a pu retarder la prise de conscience des effets de réchauffement de la pollution, tandis qu’à l’inverse c’est un réchauffement inexpliqué des températures qui, au milieu du XVIIIe siècle, a contribué à inverser la tendance de la perception du changement climatique : ce n’est plus la glaciation qui devient redoutable, mais le réchauffement. Alors que « la mort du soleil est l’un des premiers scénarios de cataclysme climatique » (p. 24), l’évolution du climat à l’époque classique pousse même le roi Louis XIII à légiférer contre le déboisement considéré comme responsable de la diminution des pluies (p. 36). On s’explique alors pourquoi certains textes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en particulier ceux de Buffon ou de Bernardin de Saint-Pierre, semblent témoigner d’une sensibilité écologique qui nous paraît aujourd’hui très moderne, voire prémonitoire. Elle est en effet au cœur des écofictions contemporaines – genre ou « super-genre » de fictions qui placent non pas l’humain mais la nature et ses écosystèmes au centre de la représentation fictionnelle, jusqu’à remettre en cause la suprématie des intérêts de l’espèce humaine sur ceux des autres espèces et à promouvoir la « conscience[5] » des intérêts de la nature prise dans sa globalité. Si l’ouvrage de Frédérique Rémy ne s’enferme pas dans un discours militant, il ne se contente pas non plus d’expliquer la littérature climatique par les phénomènes qui ont marqué l’histoire du climat, et ne se propose pas davantage d’illustrer cette dernière par son expression littéraire. Il explore les voies par lesquelles la littérature des quatre derniers siècles a pu percevoir et interroger notre rapport au climat, en montrant plus particulièrement comment les fictions, en interaction constante avec l’observation et l’analyse scientifique des phénomènes naturels ainsi qu’avec les discours et représentations idéologiques qui s’en sont emparés, ont pu contribuer à forger une « conscience » climatique, un « faire cas » du climat.
Le nombre et la variété des œuvres évoquées par Frédérique Rémy se prêtent mal à la synthèse – et l’autrice semble volontairement en éviter soigneusement la possibilité. Grande lectrice, Frédérique Rémy évoque aussi bien des œuvres emblématiques – parmi lesquelles figurent en bonne place les grands classiques des auteurs de science-fiction, James Graham Ballard, Jules Verne, H. G. Wells ou, plus près de nous, Philip K. Dick ou Robert Silverberg – que des textes moins connus du grand public, qu’il s’agisse d’œuvres plus anciennes de l’imaginaire scientifique, comme celles de Rétif de la Bretonne ou de Benoît de Maillet au XVIIIe siècle, ou d’œuvres considérées comme marginales, ou trop contemporaines pour avoir déjà fait l’objet de travaux critiques d’ampleur. L’ouvrage constitue ainsi, pour le lecteur curieux, une mine d’idées de lectures : d’une plume alerte et précise, Frédérique Rémy donne envie de lire tous les textes dont elle parle, pointant ses projecteurs sur l’originalité et la variété de l’invention – l’imaginaire du souterrain (p. 133) ou la fréquence de certains animaux comme le loup (p. 107) pour en donner deux exemples – sur la vocation épique ou au contraire la sensibilité psychologique des romanciers et nouvellistes du climat, ou relevant les implications idéologiques et politiques de tel thème ou personnage, comme la figure du savant (qui peut être « fou, misanthrope ou philanthrope », p. 72 et suiv.). L’étendue du corpus considéré permet à l’autrice d’en faire apparaître les motifs et concepts structurants. Les analyses de Frédérique Rémy mobilisent surtout un concept fondamental, celui de « scénario » : à partir du moment où l’on considère que le climat « change » davantage qu’il ne « varie », il ne s’agit plus de raconter une histoire cyclique ni d’en décrire les états récurrents, chaque événement climatique (réel ou fictif) apparaîtra comme singulier, potentiellement déterminant voire irrémédiable. Dès lors, raconter le climat, au passé comme au futur, c’est ouvrir l’étendue des possibles climatiques et c’est aussi considérer que les conditions d’existence de l’espèce humaine sur terre ne sont pas définitivement acquises et assurées.
L’ouvrage de Frédérique Rémy ne prétend aucunement épuiser son sujet. Son grand mérite est d’identifier un corpus, d’en dégager les tendances et de mettre en avant l’« intuition surprenante » (p. 91 à propos de Ballard[6]) des auteurs de fiction en matière de climatologie. L’enquête à l’évidence ne demande qu’à être poursuivie : en élargissant le champ d’une histoire littéraire restée ici essentiellement occidentale (on pourra suivre les pistes ouvertes ici et là par l’autrice en direction des littératures asiatiques ou africaines) ; en interrogeant la manière dont la fiction climatique dialogue avec la science, la curiosité scientifique et le mythe ; en poussant plus loin l’analyse des liens parfois directs entre les phénomènes climatiques, l’invention littéraire et celle des théories scientifiques ; en suivant le développement de certains thèmes particulièrement récurrents (comme y invite l’autrice au fil de certains développements pour la mort du soleil, les inondations ou déluges, les passages de comètes et autres phénomènes astraux, la disparition des espèces, etc.). Ce qui est sûr, c’est que la littérature ne manque pas d’imagination, même lorsqu’elle semble coller aux événements comme dans une période de crise comme celle que nous traversons ; la fiction s’empare du réel, le transforme et nous le renvoie, menaçant ou désirable. Si elle peut être le vecteur d’avertissements, de conseils voire de « messages », elle est par-dessus tout l’espace de sa configuration poétique : de la même façon peut-être que « les auteurs de science-fiction ont été parmi les premiers à saisir et à exploiter la dimension poétique de ces ordres de grandeur et de ce drame cosmique » (p. 100), les auteurs contemporains d’écofictions transforment en littérature une conscience écologique devenue, sinon commune, du moins culturellement répandue. Le climat apparaît alors comme la matière de rêveries poétiques et de représentations critiques, contrastées, et profondément problématiques, bien plus que comme un sujet monodique et clivant.
Emmanuelle Sempère - Configurations littéraires
[1] Pour bien différencier le climat de la météorologie on se souviendra que le premier désigne les conditions atmosphériques d’un espace-temps donné, correspondant à celui d’une génération humaine (20 à 30 ans) : le climat désigne ainsi, y compris dans son sens figuré, « l’atmosphère » dans laquelle évolue un être humain.
[2] Sur ce vaste sujet nous renvoyons à la synthèse de Patrick Matagne, « Aux origines de l'écologie », Innovations, 2003/2 (no 18), p. 27-42. DOI : 10.3917/inno.018.0027. URL : https://www.cairn.info/revue-innovations-2003-2-page-27.htm.
[3] Au sens du fondateur du mot, le biologiste Ernst Haeckel, en 1866.
[4]Histoire de la glaciologie, éditions Vuibert, 2007, ainsi que Histoire des pôles : mythes et réalités polaires XVIIe et XVIIIe siècle, éditions Desjonquères, 2010.
[5] Les fondateurs du site et de la maison d’édition « Ecolit », John Yunker et Midge Raymond, écrivent dans leur présentation-manifeste : « Eco-Fiction is a super-genre of writing that straddles all genres (mysteries, thrillers, literary, children’s). We often refer to it as “fiction with a conscience.” » (https://ecolitbooks.com/about-us/, consulté le 15/06/2024).
[6] James G. Ballard, dans Sécheresse (1964, trad. fr. 1975), second volet d’une « tétralogie apocalyptique » selon le terme de F. Rémy, imagine l’altération de la nature des océans après que des tonnes de polymères les ont recouverts et en ont bloqué l’évaporation.