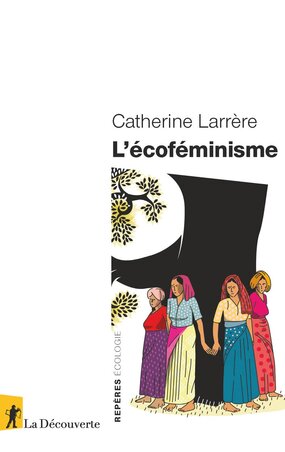Tout comme la congruence entre écologie et démocratie, étudiée par Joëlle Zask (Écologie et démocratie, 2022) et par Catherine Larrère elle-même dans un récent ouvrage (Démocratie et écologie, 2024), la compatibilité entre écologie et féminisme ne va pas de soi. Fondé sur le constat d’une domination croisée de la femme et de la nature, également soumises à une logique d’oppression capitaliste, l’écoféminisme se trouve notamment confronté à un soupçon récurrent d’essentialisme ou de régression primitiviste. Sa propension à se réclamer de modèles anciens ou à réhabiliter les « outils de la magie pour agir sur le monde » (par exemple en devenant « sorcières ») renforce cette défiance en suscitant une forme de « malaise ». De même, l’assimilation de l’écologie aux tâches ingrates et subalternes de l’entretien heurtent certaines sensibilités féministes, qui se voient mal brandir derechef la serpillère, fût-ce pour la bonne cause :
Dans sa façon de célébrer l’oïkos, le foyer, d’en appeler à Gaïa, l’écoféminisme est souvent accusé d’enfermer les femmes dans leurs rôles traditionnels, donc subalternes. Les femmes auraient vocation à s’occuper de la Terre comme elles prennent en charge le ménage : il faut bien nettoyer les saletés que les hommes laissent après eux. […] Retournement du stigmate : le ménage, cette tâche décriée, toujours recommencée, jamais créative, emblématique de la routine et de l’ennui des activités féminines, en vient à être reconsidéré comme une condition de la durabilité, de l’inscription dans le temps, de l’insertion dans ce « filet serré et complexe dont la destination est de maintenir la vie », dont parle Tronto [1993, trad. 2009, p. 143].
La résistance est particulièrement forte en France, « pays de l’universalisme des droits » où se développe spontanément un « féminisme d’antinature » et où, « qu’il s’agisse des femmes, ou de tout autre objet, la dénaturalisation est un préalable de leur étude par les sciences sociales ». Si sa première occurrence remonte au milieu des années 1970, où il apparaît sous la plume de l’autrice française Françoise d’Eaubonne (Le Féminisme ou la mort, 1974), c’est surtout aux États-Unis et dans les pays du Sud que l’écoféminisme a pris son essor depuis quelques décennies, souvent en lien avec les pensées décoloniales. Paradoxalement, et quoiqu’il commence à connaître une diffusion accrue dans les cercles militants et académiques (voir notamment Émilie Hache, dir., Reclaim : anthologie de textes écoféministes, 2016), il est toujours traité avec une suspicion qui rendait indispensable un travail de mise au point conceptuelle et contextuelle.
Combinant approche historique et analyse philosophique, la présente étude constitue à ce titre un outil extrêmement précieux : non contente de rendre compte de la pensée de figures essentielles, telles que Carolyn Merchant, Sylvia Federici, Karen Warren, Val Plumwood, Starhawk, Vandana Shiva (Inde) et Wangari Muta Maathaï (Kenya), elle éclaire des termes centraux qui intègrent désormais notre vocabulaire conceptuel – notamment ceux de care (défini comme « éthique de la responsabilité, contextuelle ou particulariste, qui, attentive à l’étude des cas, fait appel au récit et à la description plutôt qu’à l’énoncé de règles abstraites » et comme une « éthique qui fait place aux sentiments sans les opposer à la raison ») et de reclaim (qui, selon Émilie Hache, « signifie tout à la fois réhabiliter et se réapproprier quelque chose de détruit, de dévalorisé, et le modifier comme être modifié par cette réappropriation »). Elle propose enfin une réponse circonstanciée aux critiques adressées à l’écoféminisme : le troisième chapitre établit ainsi une distinction fondamentale entre la « naturalisation » de la femme, présentée comme le « déguisement d’un rapport social en une donnée naturelle », établi et renforcé au xvie et au xviie siècle lors des fameuses chasses aux sorcières, et son rapport à la « nature » elle-même. De fait, « une fois que, en critiquant le dualisme, on a dénoncé la naturalisation des femmes, le lien entre femmes et nature reste un problème : on ne peut se contenter ni de le nier ni de l’affirmer, sans critique » et une grande partie de la réflexion demeure à mener. C’est dans cette brèche demeurée béante que viennent s’insérer les mouvements écoféministes contemporains et les formes variées du reclaim, parfois indûment perçu comme un néo-primitivisme :
Le reclaim, cette façon militante de se réapproprier une nature oubliée ou dévalorisée, se distingue du simple renversement (reversal) de l’opposition dualiste que critique Plumwood. C’est le renversement qui est essentialiste, car, en inversant les signes de valeur du dualisme, sans en examiner les termes, il fige et essentialise une nature tronquée, qui n’est qu’un produit du dualisme. Le reclaim est une exploration dynamique qui révèle les potentialités ignorées d’une nature oubliée ou occultée. Aussi ne s’agit-il jamais d’un retour en arrière, à une nature qui aurait l’authenticité de l’origine. Il n’y a, dans ces pratiques écoféministes, aucune nostalgie d’une unité perdue dans laquelle il faudrait revenir se fondre. Qu’il s’agisse de la nature ou des femmes, on ne se débarrasse pas du dualisme pour revenir à l’un.
Catherine Larrère développe à ce titre une réflexion essentielle sur la puissance des images dans le discours écologique (que s’emploie à étudier le projet ECOPROP) : selon elle en effet, « accuser l’écoféminisme d’essentialisme (les femmes sont la nature), c’est confondre identité et analogie ». Évoquant « la force normative de l’image », elle souligne que « les métaphores ne sont pas seulement descriptives, elles indiquent ce qui peut, ou doit, être fait » et sont, par conséquent « des programmes d’action ». Ces derniers ne sont pas nécessairement négatifs et placés au service d’une logique de domination : ainsi, pour Merchant, Gaïa est une « puissante métaphore permettant de mieux comprendre et de mieux respecter la vie sur Terre », et qui peut « convenir aussi bien à la science qu’à nos relations générales avec l’Univers ». Après avoir rappelé, à la suite de l’historienne des sciences Mary Midgley que beaucoup de scientifiques – et au premier chef Albert Einstein – « n’hésitent pas à se référer à Dieu », Catherine Larrère avance que « condamner sans examen ces références spiritualistes ou religieuses comme nécessairement obscurantistes, voire essentialistes, serait passer à côté d’une importante tentative pour articuler positivement les femmes et la nature ».
Tout en développant une argumentation philosophique rigoureuse, qui restitue les analyses de Val Plumwood sur les enjeux d’une déconstruction des « dualismes de la modernité », l’ouvrage de Catherine Larrère invite donc à ne pas faire fi de propositions plus spiritualistes, au risque « d’académiser » l’écoféminisme et de le priver ainsi de ses racines les plus vivaces et de son terreau originel. On aurait tort d’oublier que ces mouvements, ancrés dans le local, ressortissent d’abord d’un « féminisme de la subsistance » et des luttes menées par les femmes « pour la justice reproductive et environnementale » (chapitre IV). L’un des atouts les plus remarquables de cet essai est dès lors de traiter aussi bien d’un écoféminisme social et constructiviste (dont les tenantes voient dans la domination des femmes et de la nature des phénomènes historiques surgis dans un contexte donné) que d’un écoféminisme culturel, qui vise à « changer non seulement les mentalités mais aussi les attitudes et les façons de faire » et se fonde parfois sur des postulats essentialistes.
On comprend dès lors que l’objectif de l’essai n’est pas de rendre compte d’une réalité unique et nettement définie : l’écoféminisme n’est résolument pas un existentialisme. Ainsi que le note l’autrice dès l’introduction, « les mouvements écoféministes sont trop dispersés géographiquement, varient trop dans leurs objectifs comme dans leurs pratiques pour qu’on puisse les considérer comme l’application d’une unique doctrine préexistante qui pourrait faire l’objet d’un exposé séparé ». L’adjectif « écoféministe » peut ainsi s’appliquer aussi bien à un essai philosophique qu’à une réunion militante (par exemple à la Women’s Pentagon Action qui réunit deux mille femmes à Washington en novembre 1980 « dans une manifestation colorée et ludique, joignant l’affirmation politique à la performance artistique d’une façon qui montre les capacités d’invention créatrice de ce mouvement ») ou à une œuvre d’art (par exemple au roman d’Annie Lulu, Peine des faunes).
Il faut donc prendre au sérieux la mise en garde liminaire que nous adresse Catherine Larrère : on se tromperait en considérant « l’écoféminisme comme un objet d’étude » et mieux vaut, pour le comprendre, « se mettre à l’écoute de sujets » qui contribuent à l’incarner. Cette posture critique est aussi, on le voit, une prise de position politique et le dernier chapitre de l’essai s’emploie à démontrer comment l’écoféminisme est porteur d’une inflexion de notre conception du pouvoir. À la suite de Starhawk, Catherine Larrère distingue en effet le « pouvoir-sur », caractéristique des logiques de domination violentes, du « pouvoir-du-dedans », défini comme « le pouvoir qui vient de l’intérieur de nous-mêmes ; notre capacité d’oser, de faire et de rêver, notre créativité ».
Là où le « pouvoir-sur » sépare et met à distance, le « pouvoir-du-dedans » réunit, sans limiter. Lutter contre la domination, c’est ainsi passer d’un pouvoir à l’autre, se déprendre du « pouvoir-sur » et se reconnecter au « pouvoir-du-dedans » de façon « à transformer les structures de domination et de contrôle » en changeant « de manière radicale la manière dont le pouvoir est conçu et dont il opère » [p. 150]. Telle est l’originalité des politiques écoféministes : elles ne s’insèrent pas dans une stratégie de prise du pouvoir politique et étatique, elles développent un autre type de pouvoir qui permet de se soustraire à la domination, non de remplacer ceux qui l’exerçaient.
Préférant « ouvrir les possibles » par des « expériences de rupture » utopique plutôt que de « prendre le pouvoir », l’écoféminisme substitue ainsi à la révolution politique ce qu’on pourrait considérer comme une forme de révolution morale. En renonçant à faire de l’écoféminisme une théorie stable pour restituer plutôt un réseau d’échanges où le global s’articule au local, Catherine Larrère se montre fidèle à l’éthique de la conversation qui caractérise ces mouvements :
La diversité des positions est réelle et il faut que place soit faite à toutes les voix qui veulent s’exprimer. Il faut tenir compte non seulement des contenus (la diversité des positions) mais aussi de la diversité des formes – ou du mode d’expression : l’argumentation philosophique, le récit, le témoignage, le poème. Pour que cette diversité soit reconnue et se maintienne, qu’elle puisse être entendue, l’éthique à adopter n’est pas tant celle de la discussion, telle que Jürgen Habermas la présente, où il s’agit d’assurer l’égalité des participants pour que seule l’argumentation rationnelle départage les positions en présence. On ne tend pas en effet à ce qu’une seule position soit finalement retenue, on vise la coexistence de toutes les positions, qui peut permettre un commerce d’idées et des aides réciproques. L’objectif serait alors plutôt une éthique de la conversation, qui vise à accueillir le plus de voix possible, pour que la conversation continue et s’élargisse, sans nécessairement conduire à un consensus.
Cette ouverture permet par exemple d’accueillir au sein de l’écoféminisme des voix plus littéraires, susceptibles de devenir partie prenante au débat en dépit de l’originalité de leurs formes :
En évacuant les courants essentialistes, on prive l’écoféminisme de ce qui fait sa force et sa vitalité. On trouve des positions essentialistes et souvent spiritualistes aussi bien chez celles qui ont introduit les questions écoféministes, comme Daly [1978] ou Griffin [1978], que chez des porte-parole de l’écoféminisme, comme Starhawk ou Shiva (voir chapitre I). Leur discours relève plutôt du témoignage et n’hésite pas à faire appel à des formes poétiques ; est-ce une raison pour négliger cet écoféminisme que l’on qualifie parfois de culturel ?
Ninon Chavoz - Configurations littéraires