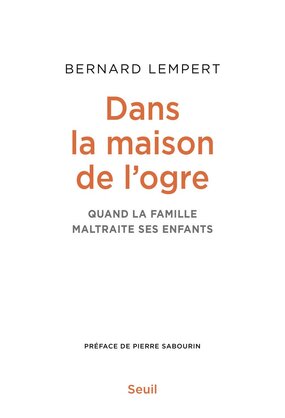Publié à titre posthume, Dans la maison de l’ogre. Quand la famille maltraite ses enfants (2017) de Bernard Lempert s’intéresse à la maltraitance intrafamiliale (des violences dites éducatives à l’inceste), qu’il commence par ramener à un schéma tripartite : la maltraitance s’origine dans une « faute imaginaire » (p. 21) attribuée à l’enfant, alors intériorisée comme une dette à rembourser par un service (économique, psychologique ou sexuel) qui engendre une « triple effraction » (p. 103). Violence faite au corps, malmené par les coups, à la pensée, empêchée et aliénée « dans le système agresseur » (p. 27), et au réel, néantisé par un langage déconnecté de toute référence, la maltraitance, en tant qu’entreprise de « négation de l’autre » (p. 99) et de « lavage de cerveau », relève de « pratiques totalitaires » (p. 156) ayant reflué dans le secret de la vie privée. Ce modèle s’accompagne d’une explication d’ordre psycho-anthropologique. Selon Bernard Lempert, la maltraitance relève d’une « vengeance déplacée » (p. 45) hantant le lignage et dirigée contre l’enfant « victime émissaire » (p. 117), qui « ne mérite pas les coups » mais « hérite de la violence » (p. 44-45) : à une « faute réelle » commise par un ascendant coupable, mais cachée, enfouie ou refoulée, répond un « discours de la faute fantasmatique » (p. 45) reporté sur un descendant innocent, qui « prend pour quelqu’un d’autre » (p. 44) et permet ainsi de « laisser filer cette violence historique considérée comme indicible » (p. 45). Croisant le fer avec la psychanalyse, dont il se réclame pourtant, Bernard Lempert renvoie à la malédiction d’Œdipe et en rappelle l’origine escamotée par la théorie freudienne, à savoir le viol de Chrysippe par Laïos : « On refoule alors non seulement la faute du père, mais aussi son caractère éminemment réel, au profit d’un processus de désignation qui concerne le fils. […] la faute s’est déplacée sur le fils, et elle est devenue fantasmatique. » (p. 229).
Cette double entrée anthropologique et psychanalytique analyse la maltraitance tantôt dans un parallèle avec le sacrifice rituel, où là aussi « le descendant paye dans son corps pour des fautes commises par des ascendants » (p. 238) et disculpées par des « discours censés justifier la souffrance de l’enfant qu’on violente » (p. 239), tantôt dans ses effets cliniques, de la crise au fantasme. Il se montre sur ce point très critique à l’encontre de la doxa freudienne, qui participe du déni et de la négation du réel, en ce qu’elle fait « oublier la violence objective des commencements, nier ou relativiser à l’extrême le poids de la charge traumatique, et finalement protéger le système agresseur dans son ensemble, c’est-à-dire la violence concrète de l’histoire » (p. 178). Au contraire, les récits et les crises des patients sont à prendre au sérieux en tant que potentiels signes et symptômes d’un non-dit recouvert par la loi du silence : « la folie n’est pas un mal, mais le signe d’un mal » (p. 166), le délire est « l’expression décalée » (p. 171) d’une agression passée, la « construction fantasmatique est le signe d’une réalité objective, dont elle fait mémoire à sa manière » (p. 126-127).
À la lumière de cette double allégeance, il n’est pas étonnant qu’à côté des études de cas anonymisés, se multiplient les interprétations de contes de fées (Peau d’Âne, le Petit Poucet, le Petit Chaperon Rouge, le Chat Botté), de mythes (Œdipe, Moïse) et de fables (« Le loup et l’agneau » de La Fontaine). C’est que ces histoires « ne [font] que dire à [leur] manière du réel » (p. 224), et vouloir les renvoyer à l’invraisemblance de la fiction révèle quelque chose d’un refus d’entendre ce qu’elles véhiculeraient d’un traumatisme initial. Dans La Maison de l’ogre, au titre en cela évocateur, le récit merveilleux constitue une sorte d’échangeur qui met en relation deux espaces (réel/symbolique), deux temps (moderne/archaïque), pour transmettre la vérité de la violence. « Détour symbolique que la réalité est obligée de faire » afin de « dire le réel caché » et « l’exprimer enfin dans le champ social », « la fable négocie avec le secret » (p. 85), et c’est en tant qu’elle se fait « son lieu d’élucidation » (p. 86) qu’elle doit interpeller le psychanalyste trop prompt à rejeter du côté des chimères les constructions de l’imaginaire comme du fantasme. En outre, selon Bernard Lempert, « le passage par les contes de fées nous permet de remonter le cours du temps et, en partant des formes modernes de la maltraitance, de retrouver l’arrière-plan historique des sacrifices d’enfants » (p. 240). Loin de perdre de vue les enjeux liés aux violences intrafamiliales, le recul anthropologique éclaire au contraire le mécanisme de la maltraitance, qui « s’enracine dans une histoire et dans un terreau culturel – si archaïque soit-il » (p. 234-235). En d’autres termes, l’anthropologie met au jour le fond idéologique sur lequel s’érige la maltraitance, qui partage avec le sacrifice sa logique, sa rhétorique et sa visée : dans les deux cas, la violence exercée contre l’enfant consiste en une « entreprise de destruction », produite par « une organisation volontaire, justifiée par un discours », « au nom d’un bien, d’une valeur supérieure – éducative ou religieuse » (p. 235), avec pour but de « consolider le corps social » et d’ « affirmer un ordre politico-religieux » (p. 236) – en l’occurrence, pour ce qui est de la maltraitance, le système de la domination masculine et patriarcale, relayée par l’autorité parentale.
C’est d’ailleurs là un mérite de l’ouvrage : ni le prisme psycho-anthropologique, ni le corpus des classiques, n’induisent de lecture dépolitisée des violences intrafamiliales, bien au contraire. La relecture de Peau d’Âne, que Bernard Lempert, comme d’une certaine manière Jennifer Tamas dans Au NON des femmes (2023) et Lucile Novat dans De Grandes dents (2024), réactualise avec les outils féministes (p. 89), en est la meilleure preuve : le personnage du roi incestueux rappelle que « le viol est une affaire de toute-puissance » (p. 89), que « la maltraitance n’est jamais que la prolongation des anciens supplices royaux dans le champ de la vie familiale. Elle est comme une survivance politique des systèmes de domination qui auraient trouvé refuge dans l’espace privé de certaines familles. » (p. 274). Plus frappante encore est l’interprétation de la bonne fée, loin d’être univoquement positive. Rappelant qu’il faut plusieurs tentatives avant que la fée ne décide d’intervenir plutôt que de tempérer les assauts du père, Bernard Lempert voit dans cette figure un reflet de l’aveuglement, voire du déni, propre au témoin : « Elle est comme nous quand nous ne voulons pas croire l’imminence du passage à l’acte ou sa réitération » (p. 87). Ainsi, non seulement le conte encrypte l’histoire de la violence, mais il résume aussi, par ses archétypes, le système social et idéologique qui la génère et l’autorise, à moins qu’une intervention ne brise l’ordre des choses, Bernard Lempert voyant dans les destins d’enfants sauvés et victorieux dépeints dans les contes une leçon d’anti-fatalisme.
C’est principalement à la justice que Dans la maison de l’ogre confie le rôle salvateur d’arracher l’enfant au « monde à l’envers généralisé qui caractérise les violences intrafamiliales » (p. 149) : « L’incarcération fonctionne comme une remise à plat des données. La loi réinvestit un monde qui s’était organisé sans elle. Elle remet à l’heure les pendules du réel, elle nomme la violence pour ce qu’elle est, les sévices pour ce qu’ils sont. » (p. 157). Néanmoins, au vu des chiffres et du fonctionnement effectif de la justice, peut-être faut-il nuancer la confiance quasi lyrique accordée dans le système judiciaire. Peut-on vraiment soutenir que « l’ogre ne s’est jamais brisé les dents que sur le code pénal » (p. 253) quand le rapport 2023 de la Ciivise signale que l’écrasante majorité des plaintes sont classées sans suite et qu’à peine 1% des cas d’inceste font l’objet d’une condamnation ? Peut-on également considérer qu’« utiliser les qualifications juridiques, c’est en quelque sorte relever le défi et descendre dans l’arène du réel » (p. 253) quand on connaît la fréquence des déqualifications opérées lors des procédures ou par les avocats (des viols en agressions sexuelles, des agressions en attouchements, des attouchements en jeux) ? La terminologie des codes, loin de « dire ce qui est » (p. 253) pour faire advenir la justice, dans une forme de performativité miraculeuse, peut brouiller la réalité, lorsqu’il ne l’oblitère pas complètement en décrétant un « non-lieu » ou la « prescription des faits ». À la violence première de la sphère privée s’ajoute une violence symbolique produite par le système judiciaire, dont Christine Angot dans Le Voyage dans l’Est (Flammarion, 2021) montre qu’elle est précisément affaire de langage : « Parce que, si, en plus, il faut que je supporte un non-lieu… Non. Ça, ce n’est pas possible. Un non-lieu. Non-lieu. Ça n’a pas eu lieu. » (p. 170). Ce soupçon dirigé à l’encontre de la justice n’équivaut pas à une « déjudiciarisation » (p. 254) des violences intrafamiliales, contre laquelle Bernard Lempert prend fermement position. Il est plutôt le rappel du fait qu’entre l’ordre familial et l’ordre judiciaire, la coupure idéologique n’est peut-être pas si nette qu’il n’y paraît, dans la mesure où ce dernier, comme le rappelle Dorothée Dussy dans Le Berceau des dominations (Pocket, 2021), est lui aussi fondé sur la domination patriarcale et imprégné de ses représentations, qui profitent en général aux agresseurs. Refuser une forme d’idéalisme abstrait, qui verrait dans la procédure judiciaire une panacée, relève d’une responsabilité et même d’une éthique ancrée dans la réalité, donc consciente de ses failles. Prendre acte des biais et des torsions que la justice inflige au réel, c’est se positionner pour en appeler à la réformer en profondeur, et œuvrer ainsi à une meilleure prise en charge de l’enfance contre la maltraitance.
Bibliographie :
- Christine Angot, Le Voyage dans l’Est, Paris, Flammarion, 2021.
- Dorothée Dussy, Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste [2013], Paris, Pocket, 2021.