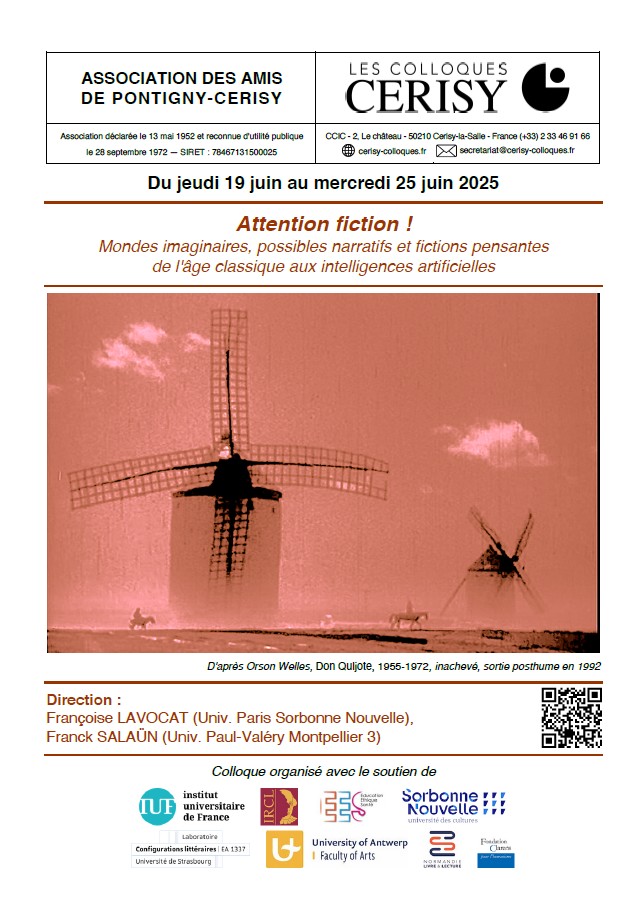
« Attention, fiction ! » Affolement, mépris, curiosité : quel sentiment ressentez-vous à la lecture de ce titre ? C’est par cette question que Françoise Lavocat a ouvert le colloque de Cerisy organisé par Nathalie Kremer, Anthony Mangeon et Pascal Nouvel, et dirigé par Françoise Lavocat et Franck Salaün. Entre le 19 et le 25 juin, des chercheur·euses ont ainsi interrogé la fiction, tentant de visualiser la frontière qui la sépare du réel. Comment repérer une fiction ? Quels sont ses critères ? Qu’est-ce qui prouve que le discours de l’historien·ne est plus objectif et scientifique qu’une fiction ? La fiction donne-t-elle accès à des connaissances prétendument objectives ? Existe-t-il un savoir qui serait « le savoir de la fiction » ? La fiction disparaîtra-t-elle un jour ? Autant de questions qui ont rythmé les six jours passés dans le château de Cerisy, lieu dans lequel un conte pourrait aisément prendre place, ou une fable, comme l’ont proposé les doctorant·es [1] :
La fable de la fiction
À l’écart du monde, au château de Cerisy,
Venaient se rassembler lion, hibou, souris.
Soudain, accompagné de sa fiction chérie,
L’écureuil vint à s’immiscer dans la partie.
Mais, détourné par les bulles bien dégustées,
Il ne vit pas que la fiction s’en est allée
Affronter vaillamment sur son beau destrier
De grands moulins à vent afin de les sabrer.
À la nuit tombée, quand la bise fut venue,
Seul vint le cheval : le cavalier n’était plus.
Dame fiction, – malheur ! –, avait disparu,
Enlevée ou tuée par quelque individu.
Un primate accusa, non sans hésitation,
Deville et son projet de roman sans fiction.
Cunégonde, l’abeille à la belle diction,
Énonça : « À coup sûr, c’est la télévision ! »
Fadaise, dit le lion, le coupable est certain !
Récidiviste est ce penseur et écrivain,
À la vie de l’auteur ce trompeur a mis fin ;
La fiction, aujourd’hui, cible le barthésien.
Mais au pan fictionnel le renard préféra,
En bouc émissaire, les hypomnématas.
La chouette inspectrice s’écria « Eurêka !
Le coupable du meurtre est évidemment la [tintement de la cloche] [2]
Moralité
Cette fable est pour vous, chère assemblée savante.
Depuis six jours entiers, la fiction ces lieux hante.
Après maints discours et discussions brillantes,
Il nous faut donner une conclusion édifiante
Et résoudre l’énigme en la fable présente,
Mais attention : c’est une fiction pensante !
[1] Les doctorant·es en question sont : Vittoria Dell’Aira, Luca Penge et Salomé Pastor. Ce texte a été produit à l’occasion d’un rapport d’étonnement.
[2] Au château de Cerisy, les journées sont rythmées au son de la cloche, et gare à celles et ceux qui en feraient fi.
*
Cette dernière expression, théorisée en 2010 par Franck Salaün, a retenu l’attention de Charlotte Krauss, qui a analysé la série Les Cités obscures, créée par les bédéistes François Schuiten et Benoît Peeters. Elle a proposé d’étudier l’évolution formelle des albums en tant que fiction autoréflexive qui interroge ses propres conditions d’existence. La métaphore organique de la cartographie émerge comme un élément clé de l’esthétique de la série, reflétant son évolution au fil des aventures et des contextes culturels, historiques et politiques. Charlotte Krauss en situe le point culminant dans la dernière planche du tome 2 de La Frontière invisible (2013), où le paysage, vu d’en haut, prend les formes d’un corps féminin. La carte s’inscrit alors dans une vision organique : tout comme les histoires qui peuplent et façonnent les mondes fictionnels, les habitants deviennent pays, le territoire devient corps. Linda Gil a justement invité les participant·es à incarner la fiction en proposant une conférence interactive lors de laquelle les auditeur·ices sont devenu·es des personnages de Voltaire. La chercheuse a ainsi analysé Cunégonde, figure à la croisée du réel et du fictif, mais également femme combative et capable de préserver sa liberté morale. Dominique Memmi a continué d’enrichir les études de genre en se concentrant sur des films qui explorent la relation entre maître et domestique, une relation dont les représentations, le plus souvent, se concluent par un meurtre. Toutefois, le tournant des années 1980 marque une rupture : si auparavant le père vengeait le viol, depuis cette période, c’est la femme elle-même qui se venge des violences subies. Cet acte de vengeance se transforme à travers la dramatisation : plutôt que de reconnaître la condition domestique, celle-ci est rejouée sous forme de drame sanglant. Pourtant, d’après Dominique Memmi,la fiction permet, au minimum, de penser la situation, d’en poser un diagnostic et d’esquisser des issues possibles, lesquelles dépendent de l’endroit où se trace aujourd’hui la frontière entre fiction et réalité. Cette frontière est selon elle historiquement située et pourrait correspondre à un moment précis dans la gestion contemporaine des relations de « domination rapprochée ». Aude Déruelle, pour sa part, a plutôt mis en avant l’idée d’une continuité des époques. Spécialiste du XIXe siècle, la chercheuse est partie des années 1820 et a expliqué qu’à cette période le roman historique devient un modèle de représentation qui fascine les historien·nes. À partir des années 2000, ce phénomène ressurgit, les chercheur·euses en histoire, à l’instar de Thomas Bouchet, Pauline Valade et Patrick Boucheron, produisant de plus en plus de romans. Aude Déruelle a ainsi décelé chez les historien·nes un désir de roman qu’elle comprend comme l’élaboration d’une nouvelle pratique historienne, laquelle traduit un renouvellement de l’éthos historien, dorénavant lié au sensible et à l’empathie. Les lecteur·ices, quant à elles/eux, sont confronté·es à une impossibilité d’agir, doublement marquée par la fiction et par l’irréversibilité historique. Selon l’intervenante, cette impuissance contribue à activer une forme d’empathie qui participe à la transmission d’une mémoire vive. Anthony Mangeon est remonté plus avant dans le temps et a emporté Cerisy dans la Renaissance française. À la suite des grands voyages, les médecins et historiens de la nature expriment leur fascination pour les singes. Au XVIIIe siècle, des savants vont alors nourrir l’idée d’une éducation des primates. Au XXe siècle naît ainsi la primatologie, une discipline concurrente de l’anthropologie et qui prouve définitivement que les singes sont aussi capables de gestes civilisationnels : utiliser des outils, apprendre, enseigner, employer des langages. Cependant, une frontière entre humains et primates demeure : la fiction, qu’aucun singe n’a jamais pratiquée. Il existe en revanche des « fictions primates », qu’Anthony Mangeon classe en cinq catégories : fiction de l’intermédiaire, fiction des communautés hybrides, fiction du renversement, fiction critique, fiction du témoignage. Pourvues de caractéristiques propres, ces fictions ont toutefois cela de commun qu’elles présentent une visée métaphorique : métaphore des fantasmes ou des hantises du métissage ; métaphore du rôle de l’explorateur dans la découverte et la reconnaissance de populations supposément primitives ; métaphore de la peur d’une mise en accusation des Occidentaux ; métaphore de la domination coloniale. Ridha Boulaâbi a poursuivi ces études francophones en se concentrant sur Le Silence de Mahomet (2008), un ouvrage dans lequel Salim Bachi reprend l’histoire de l’Islam en s’appuyant sur la biographie du prophète Mahomet. En soulignant la position singulière de l’écrivain francophone dans le champ littéraire qui s’empare de la question de l’islamisme, le chercheur a montré que ce positionnement s’accompagne de difficultés philologiques et intellectuelles. Le parcours est en effet semé d’embûches : rareté des sources sur la vie du Prophète, frontière incertaine entre fait historique et fait légendaire. Cette frontière constitue un enjeu majeur, les recherches contemporaines confirmant l’impossibilité de fixer scientifiquement une version canonique de l’histoire des débuts de l’Islam et de son fondateur. La fiction biographique se situe donc dans une dialectique entre quête historique et exigence romanesque, et elle engage la polyphonie comme principe structurant. Ce procédé peut être interprété comme le prolongement d’une tradition ancienne de la littérature arabe, fondée sur la chaîne de transmission (isnād). L’écrivain endosse alors le rôle d’archéologue : cette archéologie littéraire repose sur un dispositif de réflexivité sophistiqué, où la centralité du métadiscours manifeste une conscience aiguë du geste littéraire.
Toutes très riches, les communications ont été entrecoupées de différentes lectures et représentations, dont une du Pygmalion (1770) de Rousseau, que Nathalie Kremer a pris le temps de restituer et d’analyser en appuyant sur la difficulté qu’il y a à catégoriser cette pièce de théâtre, puisqu’elle relève tantôt de la poésie lyrique, de la fiction ou de la non-fiction. Si, néanmoins, ce texte a bien été pensé pour le théâtre par son auteur, ce n’est pas le cas de l’ensemble des pièces représentées sur scène, un fait qui a donné lieu à une intervention de Michel Toman. Metteur en scène et acteur, il se définit comme un « praticien de la scène », et c’est sous cette identité qu’il s’est penché sur Le Paradoxe (1830) de Diderot et a présenté différentes mises en scène. Franck Salaün s’est quant à lui tourné vers Le Neveu de Rameau (1805). En s’arrêtant sur le chapitre 12 de l’œuvre de Diderot, il a notamment montré comment les mises en scène illustrent la difficulté qu’il peut y avoir à représenter un univers mental, qui est aussi, en l’occurrence, un monde musical. La question du passage du texte à la scène peut ouvrir à celle de l’intention d’auteur·ice. Franc Schuerewegen a ainsi proposé une réflexion autour de ce qu’il appelle le dispositif Barthes-Lanson-Fish, une constellation théorique qui permet d’interroger les différentes manières de penser la présence ou l’absence de l’auteur·ice dans l’interprétation des textes littéraires. Avec Barthes, le point de départ est la mort de l’auteur, en tant qu’institution critique qui dominait la lecture positiviste et biographique. Et pourtant, dans l’expérience du texte, une forme de désir d’auteur·ice subsiste. Cette présence spectrale ne contredit pas sa mort critique, mais la réinscrit dans le plaisir du texte. Lanson, dès le début du XXe siècle, déplaçait déjà la focale : le livre, une fois publié, n’appartient plus à l’auteur·ice. Il devient un phénomène social. Cette perspective annonce ce que les théories de la réception développeront plus tard, avec Stanley Fish, notamment. La réflexion s’ouvre enfin sur la proposition de Sophie Rabau, qui explore les modes de reconfiguration fictive de l’auteur·ice. Face à l’absence auctoriale, elle identifie des stratégies historiques – biographie, empathie romantique, reconstitution – et insiste sur la puissance singulière de la fiction. Libérée des contraintes du réel, elle permet aux lecteur·ices d’opérer une réparation imaginative : un jeu libre avec la figure de l’auteur·ice. Sjief Houppermans s’est justement penché sur le cas de Raymond Roussel. En dehors d’une norme arbitrairement construite (il était homosexuel et habitait une caravane), l’auteur des Impressions d’Afrique (1909) façonne ses textes à partir d’un procédé qui entre en écho avec sa personnalité et qui trouve trois formes. La plus simple, l’« élémentaire », consiste à remplacer une lettre pour modifier le sens de la phrase : « Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard » = « Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard ». La deuxième forme, dite « amplifiée », suppose la transformation d’un mot : « Mou à raille » = « mou à rails ». La troisième technique enfin, nommée « évoluée », tient dans la modification complète d’une phrase en fonction d’un jeu phonique : « J’ai du bon tabac dans ma tabatière » = « Jade tube onde aubade en mat à basse tierce ». On perçoit ainsi l’importance qu’occupe l’imagination dans les textes de Roussel, dont les fictions sont nourries par la vie de l’auteur lui-même et la tradition littéraire.
C’est précisément sur la tradition du « roman politique » au XVIIIe siècle qu’est revenu Colas Duflo. S’inscrivant dans les pas de Genet, le chercheur a proposé une catégorisation mettant face à face les traités politiques classiques, soit la philosophie discursive par diction, et le roman politique, c’est-à-dire la philosophie politique narrative par fiction. Selon Colas Duflo, le genre discursif par fiction présente un discours argumenté autonomisable, ainsi que c’est le cas dans Les Lettres persanes (1721). Aussi, si les discours politiques présents dans les « romans politiques » servent sans aucun doute la fiction, ils ont également un sens au-delà du lieu fictif qu’ils nourrissent, et il peut être intéressant de les lire en ayant conscience qu’ils ont la prétention de « dire vrai ». En ce sens, l’universitaire a proposé de qualifier les romans qui mêlent fiction et réalité de « fictions métaleptiques ». Pascal Nouvel s’est quant à lui intéressé à la « fiction utile », une expression qui peut paraître paradoxale lorsque l’on se rappelle, ainsi que le font les organisateur·ices du colloque, que la fiction a longtemps été « considérée comme contraire au savoir et à l’utile, trompeuse, corruptrice » (voir l’argumentaire). Définie par Peter W. Singer et August Cole, la « fiction utile » remonte à la publication de Ghost Fleet: A Novel of the Next World War (2015). Dans son exposé, Pascal Nouvels’est aussi référé à l’ouvrage Martial Aesthetics: How War Became an Art Form (2023) d’Anders Engberg-Pedersen. Selon ce dernier, la « fiction utile » projette le discours sur la guerre à travers une scénarisation qui s’apparente à des outils opérationnels de stratégie militaire. Cette mobilisation de la littérature a suscité une certaine émulation parmi les institutions militaires. En effet, à l’instar de la Red Team française, plusieurs armées ont fait appel à des auteur·ices de science-fiction pour anticiper les enjeux technologiques futurs. Pascal Nouvel a ainsi remarqué que, tout comme les historien·nes semblent avoir besoin du roman, les auteur·es de ce genre fictionnel s’appuient sur l’histoire et la littérature technique spécialisée pour explorer les développements susceptibles de se produire à court terme. Partant de ces constats, le philosophe a formulé deux questions majeures : de quelle manière la fiction entre-t-elle en contact avec des faits réels ? Comment s’articule la jonction entre les faits de fiction et les faits réels ? Ivan Jablonka a justement montré qu’une analyse de la fiction pouvait permettre de mieux lire certains pans du réel, certaines données sociales invisibilisées, voire impensées. Pour ce faire, il s’est concentré sur le féminicide, représenté, dans la quasi-totalité des cas, selon la tripartition suivante : sexualisation, mutilation, mise à mort. À partir d’un riche corpus, l’historien et écrivain a ainsi remarqué que si la fiction donne à voir le féminicide comme un fait atemporel, elle a aussi contribué à façonner une « culture du féminicide ». Pour prouver ses propos, Ivan Jablonkaa pris soin de différencier les représentations réalistes, soit celles qui mettent clairement en scène le meurtre d’une femme tuée pour son genre, des représentations symboliques. Moins explicites, celles-ci contribuent pleinement à l’invisibilisation du féminicide, et partant à sa normalisation.
Parfois infime, si ce n’est imperceptible, la distinction entre fait et fiction, réalité et invention, vérité et mensonge, réel et imaginaire n’est pas toujours une infranchissable frontière : elle est aussi une texture flottante et malléable, un espace vaporeux et arachnéen dans lequel il est facile de se perdre. Mais peut-être que s’y perdre s’est dorénavant imposé comme quelque chose de profondément nécessaire, voire d’inévitable.
Vittoria Dell’Aira et Salomé Pastor
Doctorantes de l'ITI Lethica


