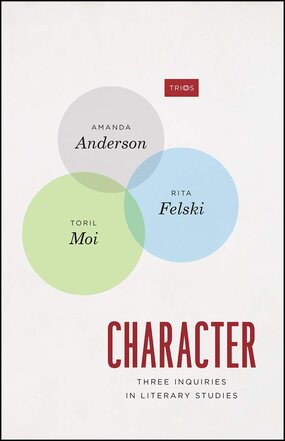Ouvrage collectif écrit par trois représentantes du post-criticism, ce travail se présente sous la forme d’un bilan et d’une enquête sur la théorie du personnage et sur les débats qui l’ont constituée depuis son essor. En se penchant sur les développements dans la pratique de la lecture non académique et dans les études spécialisées, Anderson, Felski et Moi se donnent pour objectif de revenir sur ce qu’elles considèrent comme une doxa critique : la tendance, d’héritage structuraliste, à ne pas traiter les personnages comme s’ils étaient des personnes réelles pour les aborder comme des simples stratégies textuelles. Un tel rejet serait aussi contre-intuitif que le fruit d’une arrogance de la part d’une catégorie de lecteurs qui se prétendraient plus aptes que les autres à comprendre les œuvres de fiction, et qui finiraient en revanche par s’empêcher d’accomplir des gestes aussi immédiats que s’identifier à un héros ou de réfléchir à travers l’expérience dont ce dernier est protagoniste.
« L’intérêt pour le personnage », affirment les autrices dans l’introduction au volume, « est un aspect crucial dans l’engagement du lecteur ou du spectateur avec de nombreuses formes de fiction » (p. IV). Si l’on s’interroge sur la raison pour laquelle un texte compte, ou pourrait compter pour nous, c’est souvent la question du personnage que nous nous posons en premier. En reprenant certaines conclusions tirées dans The Limits of Critique, Rita Felski observe notamment qu’il existe des usages variés et souvent imprévisibles de la fiction par les lecteurs ordinaires, et qu’une approche pragmatique serait plus apte à assouvir l’insatisfaction envers les réponses jusqu’ici données au problème du personnage et de son rapport aux personnes réelles, que ne le ferait une théorie hautement abstraite. Persuadées qu’il faut traiter les œuvres de fiction comme des sources potentielles de compréhension directe plutôt que comme des objets nécessitant d’être décryptées par un métalangage, Anderson, Felski et Moi s’intéressent à la « déconstruction des approches formelles conventionnelles à la forme littéraire » (p. XIX). En même temps, et tout en partageant un fort intérêt pour les liens de la fiction d’avec la vie éthique et politique, elles ne souscrivent pas aux « présupposés d’une politique textuelle qui corrélerait automatiquement la forme littéraire à une remise en cause des normes ou à une subversion des idéologies dominantes » (p. XX).
Bien qu’elles ne rejettent pas catégoriquement l’idée que les discussions sur le personnage soient souvent condamnées à une forme de psychologisation naïve, les autrices dénoncent le fait que ces « hybrides ontologiques » (l’expression est de John Frow) sont souvent déshumanisés, et que le lien entre leur nature fictive et la catégorie de personne réelle qu’ils incarnent est trop fréquemment réduit à un élément accidentel. Dans sa contribution, Toril Moi s’interroge ainsi sur la naissance, la persistance et les enjeux de l’injonction à ne pas traiter les personnages littéraires comme s’ils étaient des personnes réelles, en remontant aux origines intellectuelles et sociologiques de ce tabou. Moi maintient notamment qu’il serait issu d’une tentative de transformer la critique littéraire en discipline académique alignée sur l’esthétique du modernisme. Le véritable dégoût pour le discours sur les personnages serait moins le produit d’une analyse théorique ou philosophique insatisfaisante, que le résultat d’un processus de distinction visant à séparer les interprètes légitimes du commun des lecteurs. En s’appuyant sur la théorie du langage ordinaire offerte par Wittgenstein, Moi appelle à une nouvelle discussion sur ce que nous attendons de la critique littéraire aujourd’hui.
Les chapitres de Rita Felski et celui d’Amanda Anderson se posent un défi différent : défendre la tendance à l’identification dans le personnage et repenser le rapport du lecteur avec celui-ci. Le rejet fréquent, et parfois même le mépris, manifesté par les critiques structuralistes et poststructuralistes envers l’identification du lecteur au personnage, provient de sources différentes, affirme Felski : souvent assimilée à une approche simpliste et à un excès de sentimentalisme vis-à-vis du texte, l’identification est également confondue avec l’identité, c’est-à-dire avec la fixation des paramètres qui composent la personnalité. L’identification peut aussi être anti-identitaire, et avoir lieu par contraste lorsque l’on est confronté à ce qui est à l’opposé de son identité, au miroir de l’altérité.
Felski propose alors que l’identification au personnage, geste éthique avant d’être émotionnel, soit abordée à l’aide d’une approche analytique capable de rallier lecture académique et lecture profane, mettant en évidence les similitudes entre des modes de réponse au texte apparemment très différents. Quant à Anderson, elle explore l’importance du personnage pour la dramatisation de l’expérience morale, et en particulier pour ce qu’elle considère une « phénoménologie morale de la pensée » (p. 189). L’une des réalisations les plus significatives du roman consisterait en effet dans sa capacité à capturer les processus de la « rumination » intérieure : en déplaçant l’intérêt général des théoriciens à associer la critique morale centrée sur le personnage à des figures désuètes ou problématiques, Anderson invite à se concentrer sur des moments ponctuels de notre quotidien (et des fictions qui le décrivent) où nous convoquons notre faculté de jugement, de décision ou d’action.
Le type de critique dont le livre souhaite l’avènement – et qui demeure à un état d’hypothèse plutôt que de formulation aboutie – concentre son étude sur « l’imbrication mutuelle de la vie intérieure et de désirs socialement ancrés » (p. 43), et accepte ainsi à la fois d’abjurer à la rigueur désincarnée propre aux lectures formalistes, et de renoncer à une idée de personnage en tant que figure façonnée par un « marché des formes d’expression de soi » (ibid.). Là où les méthodes d’interprétation académique les plus largement mobilisées supposent une distinction nette entre les réponses des lecteurs aux œuvres et les révélations critiques auxquelles parviennent les chercheurs, Anderson, Felski et Moi plaident pour la création d’une approche institutionnelle et disciplinaire qui prenne en compte les différences sociales, économiques et culturelles, dont l’oubli aurait produit l’imperméabilité des théories littéraires à la dimension de l’ordinaire.
Matilde Manara - Configurations littéraires