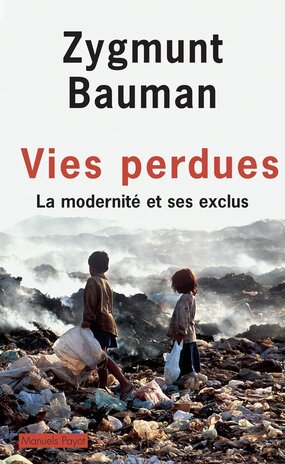Comment raconter l’histoire de la modernité ? Telle est la question de départ de cet essai. Pour esquisser une réponse, l’auteur prend exemple sur le roman Les villes invisibles d’Italo Calvino. Dans la ville de Léonie :
les éboueurs sont reçus comme des anges, et leur mission qui consiste à enlever les restes de l’existence de la veille est entourée de respect silencieux, comme un rite qui inspire la dévotion, ou peut-être simplement que personne ne veut plus penser à rien de ce qui a été mis au rebut. (Calvino, 1974, p. 134)
Bauman se penche sur la façon dont les habitants de Léonie perçoivent la décharge située en périphérie de leur ville. Comment peuvent-ils s’accommoder d’un amas d’ordures obsédant ? Dans le récit de Calvino, ces questions ne sont pas soulevées par les résidents, mais bien par un étranger, Marco Polo, ambassadeur auprès de l’empereur Kublai Khan. De même que Marco Polo à la résidence impériale, l’écrivain tchèque Ivan Klíma fut l’hôte du président de la compagnie Ford à Détroit, à la fin des années 1960. Dans son roman Amour et ordures, il raconte comment, au cours d’une conversation avec Ford, il a réalisé que la surproduction et l’élimination des véhicules étaient considérées comme une question purement technique (Klíma, 1992, p. 26-27).
Le livre de Bauman se concentre sur la « crise aiguë de l’industrie de débarras des déchets humains » (p. 19). Il interroge le rôle des « victimes collatérales » du progrès économique dans les sociétés modernes et les procédés de tri qui les régissent : « ces sociétés retournent de plus en plus contre elles-mêmes le côté tranchant de ces pratiques d’exclusion. » (p. 135).
Le chapitre initial s’appuie sur des études portant sur l’apparition de nouveaux troubles chez la génération née dans les années 1970 dans les pays développés. Bauman attribue ce malaise à la transformation d’une société qui « prenait l’emploi comme une clé » nécessaire à la survie et à la stabilité de l’identité individuelle et collective, en une société basée sur la « redondance ». Ce renversement sémantique incite la société à percevoir les marginalisés comme un fardeau, voire « comme un problème principalement financier. » (p. 29). Dans le premier excursus, « À propos des histoires », Bauman aborde le concept de sélection comme fondement de la création :
Les histoires aident ceux qui cherchent à comprendre en séparant le pertinent du non pertinent, les actions de leur cadre, l’intrigue de sa toile de fond et les héros ou les scélérats qui sont au centre de l’intrigue, des multitudes de mannequins ou de personnages en surnombre. C’est la mission des histoires que de sélectionner, et leur nature que d’inclure par l’exclusion et d’illuminer en jetant des ombres. Reprocher aux histoires de favoriser une partie de la scène tout en négligeant l’autre est une grave erreur de compréhension et une injustice. Sans sélection, il n’y aurait pas d’histoire. (p. 38)
Bauman évoque le personnage de Funes, créé par Borges. À la suite d’un incident dans son enfance, chaque image visuelle déclenche en lui un tourbillon de perceptions et de souvenirs, trop nombreux pour être codifiés. Cela le submerge : « Ma mémoire, monsieur, est comme un tas d’ordures. » (Borges, 2008, p. 115). Bauman soutient que la connaissance et la création artistique sont indissociables des lieux de décharge. Cette analogie met en lumière la dualité inhérente au concept de déchet : il est à la fois un prérequis pour engendrer quelque chose de nouveau, et un symbole du chaos. Bauman reprend la métaphore de Lewis Mumford qui met en opposition l’agriculture et l’extraction minière. Le premier type d’activité est répétitif, avec chaque génération de plantes ou d’animaux qui cède sa place à une autre. En revanche, l’industrie minière se distingue par son aspect disruptif, puisqu’elle conduit à l’épuisement des ressources (Mumford, p. 450-451). Selon Bauman, ce modèle s’est imposé comme paradigme dominant pour la création et la production : dans l’esprit moderne, le projet est donc non seulement « compulsif et cause de dépendance », mais aussi générateur d’effets secondaires pour la majorité des cas imprévisibles (p. 61).
Le deuxième chapitre examine l’idée de surpopulation. Thomas Robert Malthus l’a abordée dans son essai Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society (1798), où il mettait en garde contre les limites des ressources par rapport à la croissance démographique, mais le mot « surpopulation », remarque Bauman, n’apparaît pas dans l’Oxford English Dictionary avant 1870 (p. 69). L’auteur montre ensuite comment la question de l’encombrement du marché du travail a été résolue par l’exportation, notamment via le projet colonial et les migrations visant à réduire la pression sociale intérieure. L’auteur aborde les invisibles de cette histoire, qui n’a pas pris fin avec la colonisation des Amériques. Il donne l’exemple du gouvernement israélien, qui, depuis 1948, a déplacé de force la population bédouine du désert du Néguev, sous couvert d’aménagement du territoire. Après la création d’Israël, environ 88 % des Bédouins ont été expulsés. La plupart d’eux sont devenus des réfugiés de l’Unrwa, mais ont choisi de vivre en petits groupes dans des zones isolées de Cisjordanie. Le projet de colonisation de la zone E1 (« East 1 ») a débuté sous Yitzhak Rabin dans les années 1990. Ariel Sharon, alors ministre, a nié la présence bédouine au Néguev, le décrivant comme une terre inhabitée, « si ce n’est la présence de quelques chèvres et moutons » (p. 77). La moitié des 140 000 Bédouins du Néguev vivent dans des colonies officielles, qui ressemblent à des décharges urbaines. Le village d’Al Jabal, situé près de la plus grande décharge de Cisjordanie (Abu Dis), a été jugé invivable socialement et économiquement dans l’étude de 2013 de l’Unrwa.
Bauman souligne que le discours sur la surpopulation détourne l’attention des véritables problèmes sociaux. Contrairement aux régions densément peuplées d’Europe, ce discours s’intéresse à l’Afrique, dont la population est moins dense. Il reprend le propos des biologistes Paul et Anne Ehrlich : lors d’une conférence en 1994 intitulée « Trop de gens riches », ils ont affirmé que le vrai problème n’est pas la population, mais son mode de vie (p. 86-87). Pourtant, comme la qualification de la redondance sociale reflète les intérêts de ceux qui dictent les règles, ces derniers refusent de reconnaître leur dépendance vis-à-vis des « redondants » :
Y aura-t-il assez de ramasseurs d’ordures, d’éboueurs que « notre mode de vie » engendre quotidiennement ou — comme le demanda Richard Rorty — un nombre suffisant de « personnes qui se salissent les mains à nettoyer nos toilettes » alors qu’ils sont payés dix fois moins que nous « qui sommes assis devant un clavier » ? (p. 90)
Bauman réfléchit aussi à la notion de sélection à l’ère de l’abondance et de l’excès d’informations. À travers l’analyse des résultats de moteurs de recherche sur des termes comme « déchet » ou « surpopulation », Bauman met en évidence le rôle des technologies dans la gestion de la quantité : « L’invention de la mémoire électronique vint à point se rendre utile : la toile qui couvre le monde entier remplit le rôle d’une poubelle de capacité infinie, à la croissance exponentielle, recueillant les déchets. » (p. 53).
Dans le deuxième excursus, « De la nature des pouvoirs humains », l’auteur reprend la notion de « peur cosmique » développée par M. Bakhtine, qui décrit la vulnérabilité de l’humain face à l’immensité de l’univers. Ce sentiment, initialement canalisé par les religions, a préfiguré la vision moderne du souverain, qui détient le pouvoir d’exemption (Schmitt, 1988). La peur officielle, issue de la peur cosmique, vient ainsi justifier l’autorité politique. Bauman montre comment le désir de sécurité peut gouverner les humains en utilisant l’allégorie kafkaïenne du Terrier, récit mettant en scène une créature absorbée dans l’édification souterraine d’un refuge idéal, à l’abri de tout ennemi (Kafka, 1998).
Dans le troisième chapitre, Bauman examine la relation entre le crime, le droit et l’exclusion sociale. S’inspirant des travaux du philosophe Giorgio Agamben, l’auteur remarque qu’aujourd’hui, la citoyenneté détermine qui a droit à la vie et qui peut être ignoré ou éliminé en toute impunité. Les États agissent de manière arbitraire, défendant certains « États sans peuple », comme le Koweït, tout en tolérant la disparition de « peuples sans État », comme les Kurdes, les Palestiniens, les Arméniens (Agamben, 1995, p. 78). Cela fait du droit international un système de distribution de privilèges et d’indifférence. La fin du pacte social de l’après-guerre et la domination du marché global ont favorisé l’émergence de la peur comme ciment du pouvoir politique. Dans ce contexte, l’intention humanitaire est également à remettre en question : Bauman cite l’étude Aux bords du monde, les réfugiés, dans laquelle l’anthropologue Michel Agier observe que le travailleur humanitaire risque de devenir une « figure de gestionnaire de l’exclusion au moindre coût », utile pour apaiser la culpabilité collective du monde riche et pour renforcer l’isolement des indésirables (Agier, 2002, p. 117).
Enfin, le dernier chapitre et son excursus, « Culture et éternité », examinent comment la vision de l’éternité a changé. Bauman remarque que la croyance en l’éternité, telle que Dieu, l’immortalité ou l’amour éternel, a été remplacée par la logique de l’immédiateté. Cette évolution a conduit à une société où attendre est perçu comme une forme d’infériorité. Le rapport à l’endettement est aussi un symptôme de cette mentalité : les cartes de crédit permettent de satisfaire les désirs sans délai, supprimant l’attente mais aussi la culpabilité, entretenant le déni du poids moral ou matériel de l’obsolescence. Enfin, cette culture transforme les relations humaines : s’appuyant sur diverses études, Bauman observe que les individus cherchent des liens, mais sont moins disposés à la négociation et à la constance, pris dans un conflit entre besoin de compréhension et d’intimité, et désir d’autonomie, ce qui rend leurs relations instables et ambiguës.
Après ces digressions, la question demeure : moins celle de la manière de raconter la modernité que celle de savoir comment en traverser l’ambivalence, comment rendre vivables les villes invisibles. À la fiction de repérer et de raconter cette ambivalence, comme le fait le roman Amour et ordures, selon l’écrivain Alberto Manguel, qui écrit en 1991 dans son article The Revolution is in the Streets : « Il révèle la dichotomie essentielle de son monde – et du nôtre : nous créons pour détruire, puis nous reconstruisons à partir des ruines. ».
Vittoria Dell'Aira - Configurations littéraires
Bibliographie :
- Giorgio Agamben, Homo sacer. L’intégrale, traduit de l’italien par Marilène Raiola, Paris, Éditions du Seuil, [1995] 2016.
- Giorgio Agamben, Moyens sans fins : notes sur la politique, traduit de l’italien par Danièle Valin, Paris, Éditions Payot & Rivages, 1995.
- Michel Agier, Aux bords du monde, les réfugiés, Paris, Flammarion, 2002.
- Jorge Luis Borges, Fictions, traduit de l’espagnol par Paul Verdevoye, Nestor Ibarra et Roger Caillois, Paris, Éditions Gallimard [1944] 2008.
- Italo Calvino, Les Villes invisibles, traduit de l’italien par Jean Thibaudeau, Paris, Éditions du Seuil, [1972] 1974.
- Ken Hirschkop, « Fear and Democracy: An Essay on Bakhtin’s Theory of Carnival », in Associations, 1, 1997, pp. 209-34.
- Franz Kafka, Le Terrier, traduit de l’allemand par Dominique Miermont, Paris, Éditions Mille et une nuit, [1931] 1998.
- Ivan Klíma, Amour et ordures, traduit du tchèque par Claudia Ancelot, Paris, Éditions du Seuil, [1988] 1992.
- Thomas Robert Malthus, Essai sur le principe de population : en tant qu’il influe sur le progrès futur de la société, traduit par Pierre Theil, Paris, Seghers, [1798] 1963.
- Lewis Mumford, The City in History: Its Origins, its Transformations, and its Prospects, New York, Harcourt, Brace and World, 1961.
- Carl Schmitt, Théologie politique : 1922, 1969, Paris, Éditions Gallimard, 1988.