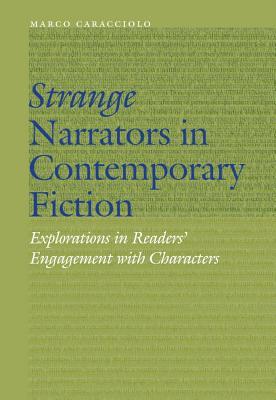« Tout comme une toile d’araignée, la fiction narrative est soigneusement agencée en un motif destiné à piéger ses proies (ou ses lecteurs) par un travail exquis » (p. XIV).L’une des tâches principales de la théorie littéraire consiste à développer des modèles qui puissent rendre compte des propriétés spécifiques à ces mondes narratifs qui résistent à la description et à la compréhension basées sur les règles de notre communication ordinaire : c’est l’objectif du groupe de recherche « Unnatural Narratology », qui se propose d’étudier les aspects des récits fictifs qui dépassent les limites du réalisme traditionnel en violant les conventions imposées par le principe de vraisemblance. Dans Strange Narrators in Contemporary Fiction, Marco Caracciolo s’inscrit dans le débat ouvert par la narratologie antinaturelle pour aborder le phénomène des « narrateurs étranges », c’est-à-dire ces figures de narrateurs à la première personne « susceptibles de résulter particulièrement étranges ou inhabituels aux lecteurs » (p. XV). Se concentrant sur des exemples contemporains de narrateurs étranges à la première personne (l’enfant de neuf ans dans Extremely Loud and Incredibly Close de Jonathan Safran Foer, le général nazi des Bienveillantes de Jonathan Little, l’adolescent neurodivergent dans The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, le tuer psychopathe de American Psycho de Bret Easton Ellis, mais aussi la truie dans Truismes de Marie Darrieussecq), Caracciolo étudie la dynamique de l’engagement du lecteur avec le personnage en termes d’alternance entre implication personnelle et mise à distance critique.L’intérêt de se concentrer sur ces narrateurs consiste précisément dans le fait qu’ils jouent avec les conventions du réalisme psychologique pour créer des représentations défiant les attentes du public. La radicalité narrative qu’ils incarnent reflète « une culture contemporaine de plus en plus sceptique face aux catégories stables et aux vérités établies » (ibid.).
Caracciolo s’appuie sur la notion d’« experientiality » telle qu’elle a été conceptualisée par Monika Fludernik – pour qui l’essence d’une narration coïncide avec le processus de projection, de représentation et de communication de l’expérience humaine dans le texte – et la croise avec les apports venant de la théorie du personnage appliquée aux sciences cognitives et à l’éthique de la littérature, afin de mettre en lumière l’importance du moment interprétatif dans la construction du récit. Contrairement aux approches narratologiques courantes, Strange Narrators n’a pas pour but d’identifier les stratégies narratives à l’œuvre dans un texte, mais de saisir l’effet que ces stratégies peuvent avoir sur les lecteurs, ainsi que le type d’enjeux interprétatifs qu’elles peuvent déclencher. « Des narrateurs de types très différents », maintient Caracciolo, « peuvent susciter un sentiment d’étrangeté chez le public » (p. XXIV). S’il est vrai que « l’étrangeté est toujours une question de négociation expérientielle et interprétative entre des lecteurs particuliers et des textes particuliers », poursuit-il, « le sentiment d’étrangeté n’est pas non plus complètement imprévisible, parce que les lecteurs d’une certaine communauté interprétative ont tendance à partager un grand nombre d’hypothèses culturelles et de modèles pour définir la “normalité” (par exemple, par rapport à la maladie mentale ou aux conditions neurologiques) » (ibid.). Les analyses réunies dans le volume reposent sur l’idée que l’expérience que nous faisons d’une œuvre de fiction s’appuie sur une « illusion esthétique centrée sur le personnage » (p. XXX). Cette illusion se fonde sur un présupposé mimétique qui nous encourage à penser les personnages comme s’ils possédaient des processus mentaux analogues aux nôtres, et ce même si nous savons, de manière subtile et implicite, que leur esprit est le produit de notre imagination et de celle de leur auteur. Pour que les lecteurs développent une illusion centrée sur le personnage, un texte doit contenir un large éventail d’indicateurs de la vie mentale d’un personnage, transmettant de manière cohérente ses souvenirs, croyances, attitudes et expériences actuelles à travers des stratégies globales telles que la focalisation interne. C’est pourquoi, explique Caracciolo, « il est relativement rare d’entretenir une illusion centrée sur le personnage pour un personnage secondaire, tandis que les lecteurs ont régulièrement le sentiment de pénétrer dans la vie mentale d’un protagoniste ou d’un narrateur : c’est à la fois la quantité et la qualité (saillance stylistique, niveau de détail, etc.) des indices textuels de la représentation de la conscience qui font la différence » (p. XXXIII).
Comment nous engageons-nous avec la représentation textuelle de ces processus ? Quelle est la valeur cognitive de la fiction littéraire dans leur explication ? En reconstruisant l’histoire des débats sur ces deux questions (dont la première est au centre des théories cognitivistes, tandis que la deuxième est plus fréquemment posée par les philosophes de l’art), Strange Narrators s’interroge sur les « transactions imaginaires » (p. 43) que nous avons avec des êtres fictionnels : là où les illusions optiques étudiées par les psychologues sont des phénomènes liés à la perception, précise Caracciolo, l’illusion esthétique est un phénomène complexe impliquant la construction d’images mentales, des réponses émotionnelles, et des prises de position morales. À la différence de ces approches cognitivistes qui cherchent dans un récit une illustration d’un phénomène psychologique précis, Caracciolo avance l’idée selon laquelle la fiction offre aux lecteurs une compréhension des processus mentaux d’un personnage spécifique en se basant sur une expérience subjective et produite par un artifice esthétique. Il en résulte que le fonctionnement mental des personnages – et ceux « étranges » étudiés dans le volume servent d’exemple en ce sens – n’a pas besoin d’être cohérent avec les connaissances scientifiques dans le champ ni ne nécessite d’être partagés avec d’autres lecteurs. Puisque l’interprétation littéraire consiste à attribuer un sens à un texte en fonction d’un ensemble de préoccupations et de valeurs qui sont en partie personnelles, en partie partagées par un groupe socioculturel, et en partie par une constitution bioévolutionnaire commune, cette interprétation « passe toujours des situations concrètes dépeintes dans la fiction à des significations plus abstraites et générales » (p. 72).
Matilde Manara - Configurations littéraires