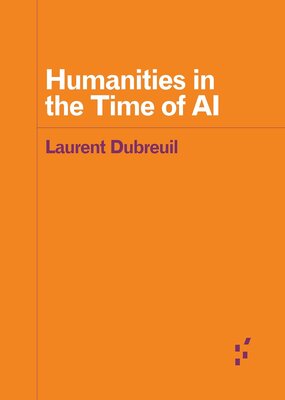Dans L’Amour au temps du choléra (1985), Gabriel Garcia Marquez narrait une indéfectible passion sur fond d’épidémie, pour rappeler qu’on peut éperdument aimer malgré les plus défavorables circonstances. En calquant son titre sur celui du romancier colombien, Laurent Dubreuil fait montre d’un même « optimisme paradoxal », ainsi que l’annonce d’emblée son premier chapitre. À notre époque où les usages de l’intelligence artificielle deviennent en effet viraux et se répandent dans tous les domaines (art, commerce, éducation, littérature, médecine, traduction, transport…), avec des succès qui dépassent et menacent même, dans une certaine mesure, ceux de l’intelligence humaine, les humanités deviennent plus que jamais vitales et elles conservent donc une chance de redevenir plus vivantes que jamais – à condition que l’on exauce véritablement leur projet ou que l’on exhausse leur ambition.
S’il s’agit en effet de « “générer” facilement des images, de la musique, des objets, des films, des textes », tout en considérant que le but de la recherche en humanités est de « trouver des positions consensuelles, amplifier ce que d’autres ont dit, étiqueter des comportements comme “bons” ou “mauvais”, identifier ce qui a déjà été identifié, exprimer des affects primaires et des émotions simples, maîtriser un style standard, produire des synthèses ou des recensions équilibrées, décrire des phénomènes sans les interpréter, résumer des documents ou des livres, et produire des traductions correctes » (p. 7), alors, concède l’auteur, la messe est dite, et les enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales n’ont plus qu’à entonner leur propre requiem tant les intelligences artificielles génératrices de textes et d’images comme ChatGPT, Dall.E, Gemini, etc., peuvent désormais accomplir toutes ces tâches avec autant sinon plus de brio que leurs créateurs humains. Se résigner à cet état de fait serait néanmoins une grave erreur, qui ne se réduirait pas seulement à une défaite paresseuse de la pensée, mais révélerait aussi un malencontreux oubli de la fonction même des humanités.
Leur développement ne s’est en effet jamais simplement mesuré en termes d’efficacité, de progrès ou de quantité (de données stockées, d’informations transmises, etc.), mais toujours en termes d’acuité, de complexité, d’intensité et de qualité dans la production, la réception et l’interprétation des œuvres humaines, quelles qu’elles soient. Ainsi les humanités doivent-elles résolument intégrer les arts, et assumer pleinement leur apport spécifique – non point uniquement dans les domaines de l’invention (toute rhétorique) ou de l’innovation (fondamentalement technique), mais surtout dans celui de la création. Dans L’état critique de la littérature (2009) puis dans The Intellective Space (2015) et dans Poetry and Mind (2018), Laurent Dubreuil défendait déjà la création artistique et littéraire comme un régime disruptif et extraordinaire de la pensée qui excède le cours ordinaire et les habitudes normatives de la cognition : son plaidoyer est ici d’autant plus convaincant qu’il fait fond sur une œuvre critique, mais aussi littéraire et personnelle (Pures fictions, 2012 ; Génération romantique, 2014 ; Portraits de l’Amérique en jeune morte, 2019 ; Comment écrire aujourd’hui ?, 2021) à présent riche d’une quinzaine d’ouvrages.
De même, si les humanités ont assurément une vocation éthique, cette dernière ne saurait résider, pour l’auteur, dans une disposition morale transformant les chercheurs en nouveaux prêtres, comme le dénonçait déjà Friedrich Nietzsche (cité p. 61), voire en gardiens des temples des plus récentes orthodoxies. Leur rôle n’est donc pas uniquement de lutter contre les préjugés sociaux ou les biais moraux, voire de corriger ceux qui se trouvent incidemment transmis aux intelligences artificielles, comme certains experts s’y emploient désormais, en laquais des grandes compagnies de technologies numériques, opportunément promus « coachs moraux » de différents logiciels conversationnels (chatbots). Les arts et les littératures, ainsi que les disciplines qui les prennent pour objets, portent une charge et une dimension éthiques, nous rappelle Dubreuil, dans la mesure où elles peuvent nous aider à vivre mieux en élargissant nos esprits et nos sensibilités, pour mieux nous émanciper des dogmes, et penser et agir à notre tour librement, créativement.
On tire un grand profit critique à la lecture de ce petit livre roboratif, et notamment de son dixième chapitre, intitulé « The Ethical Fallacy », où l’auteur déconstruit habilement les approches souvent moralisantes des arts et des littératures, qui prévalent outre-Atlantique et qui s’importent parfois maladroitement chez nous, tandis que l’intelligence artificielle promet insidieusement un nouvel essor et bientôt « un triomphe du triage » (p. 65) dans les divers domaines où ce dernier prospère (médecine, éducation, emploi, santé…).
Convaincant et incisif, Laurent Dubreuil ne se départit toutefois jamais d’une certaine posture aristocratique. Celle-ci lui permet certes de défendre avec efficace sa conception maximaliste de la recherche comme création (sans pour autant opter pour la recherche-création) et comme herméneutique toujours à reprendre ou pousser plus loin. Un bon exemple nous est offert au chapitre 12, quand l’auteur revisite diverses traductions de la première stance des Canzoniere de Pétrarque, pour aller bien au-delà des restitutions les plus connues – et bien sûr de celle obtenue avec DeepL. Mais tout en reconnaissant une certaine utilité aux humanités numériques et aux outils de l’intelligence artificielle pour constituer, mettre à disposition et traiter mécaniquement ou statistiquement de vastes corpus, en y repérant des régularités ou des structures récurrentes, sa quête personnelle et constante de la singularité, et notamment de la singularité poétique, le conduit à les considérer à son tour de haut et de loin – dans un esprit évidemment fort différent de la « lecture distante » promue par Franco Moretti et sa Littératureau laboratoire (2016). De même, les efforts de démocratisation du savoir, comme les projets collaboratifs d’encyclopédies ouvertes et/ou de dictionnaires en ligne, lui apparaissent suspects de formes d’arasement, de formatage et de normalisation des connaissances et des styles d’écriture qui, en accordant une préséance aux techniciens (maîtrisant les procédures de mise en ligne et d’édition) sur les savants, contraignent parfois les libertés de pensée et d’expression sous couvert d’en donner supposément à tous l’accès. La preuve ultime de ces dévoiements et nivellements des savoirs réside d’ailleurs, selon Laurent Dubreuil, dans l’usage abondant et abusif que les générateurs automatiques de textes et les grands modèles de langage font des ressources numériques du type Wikipedia.
Ces diverses mises en garde sont évidemment à méditer quand on ambitionne, avec une plateforme comme le Lethictionnaire, de produire tout à la fois des synthèses notionnelles et des recensions d’ouvrages. Mais si le principal reproche que formule l’auteur envers les conceptions courantes de la recherche ou les utilisations contemporaines de l’intelligence artificielle, est finalement qu’elles restent ancrées dans le passé (« le corpus d’exercice définit strictement ce qui sera produit, inféodant toute future production à ce qui a déjà été dit, la nouveauté n’est fondamentalement basée que sur des variations composites », p. 23), force est de constater que son éloge de la création ou de la poēsis procède lui-même d’une tradition ancienne. En réinvestissant une forme d’exceptionnalité artistique, littéraire et critique, Laurent Dubreuil se prive peut-être, accessoirement, d’envisager en quoi le développement de l’intelligence artificielle, comme jadis ceux de l’écriture puis de l’imprimerie et finalement de l’informatique, fait aussi événement dans les manières de mettre en forme, en regard et en circulation les connaissances ainsi produites et transmises.
Anthony Mangeon - Configurations littéraires