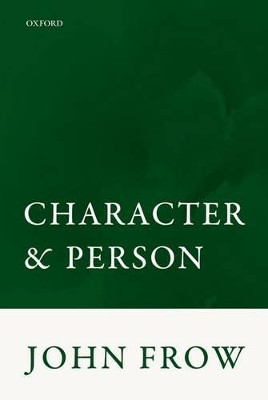Dans Character and Person, John Frow se propose de revenir sur le partage entre les approches « éthiques » et « structuralistes » des personnages littéraires. Là où les premiers considèrent que « les personnages doivent être traités comme s’ils étaient des personnes » (p. VI), les deuxièmes estiment que « les personnages doivent être traités uniquement comme des constructions textuelles » (ibid.). Sa réflexion s’articule autour de deux sujets principaux : la personne et le personnage. Jugés « ontologiquement discontinus » mais « logiquement interdépendants » ces deux entités ne peuvent qu’être abordées l’une au miroir de l’autre, en tenant compte des « nombreux schémas culturels et historiques par lesquels à des personnes réelles et imaginaires sont assignés des modes d’existence propre » (p. XX). Au centre de ce couple conceptuel composé par la personne et le personnage, Frow situe l’ensemble des interrogations critiques qui ont divisé le débat entre courants éthiques et structuralistes. La question de savoir « comment les personnages fonctionnent comme des quasi-personnes à travers une gamme de médias et de genres » ne peut qu’aller de pair avec la question de savoir « comment la personne sociale fonctionne comme une sorte de fiction » (ibid.).
Conçu comme un « dispositif » (au sens que Foucault donne de ce terme, c’est-à-dire d’appareil techniquement construit pour l’évolution sociale), le personnage se développe et se transforme selon Frow en fonction des régimes de reconnaissance au sein desquels il est mobilisé. Ainsi, par exemple, dans un système de valeur où les mœurs et les savoirs sont imposés par une autorité homologuante supérieure aux individus, le personnage fonctionnera comme un « type », aidant à la réduction et à la généralisation de caractéristiques communes afin de simplifier les relations entre les personnes. En passant d’Aristote à Théophraste, pour arriver au roman du XIXe siècle et aux plus modernes théories de la fiction, Character and Person esquisse un portrait épistémologique des tensions qui existent entre la pulsion vers l’unicité et celle vers l’appartenance à un groupe.
En croisant des apports venant de la philosophie, du droit, de l’anthropologie, de la linguistique, de la narratologie, de la psychanalyse et des sciences cognitives, le livre a moins pour vocation de parvenir à une thèse unifiante que de parcourir un ensemble complexe et chronologiquement très vaste de motifs récurrents dans notre rapport au personnage. Au long des chapitres qui le composent (« Figure », « Intérêt », « Personne », « Type », « Voix », « Nom », « Visage » et « Corps »), Frow explore les différentes perspectives, argumentations et représentations qui structurent le débat et le rendent aussi composite. Puisque le personnage « n’est pas une unité textuelle autonome et distincte mais, plutôt, le lieu d’un effet sémantique diffus », les argumentations auxquelles son étude peut donner lieu ne s’appuient pas sur « des données stables qui peuvent être reconnues, mais plutôt sur une construction qui évolue au fil de la lecture » (p. 75).
Selon Frow, un élément commun à ces différents points de vue relève des relations, respectivement de reconnaissance et d’identification, que le public (de lecteurs, de spectateurs, mais aussi de membres d’une société attribuant à telle ou telle figure la valeur de mythe, de modèle ou de représentant) entretient avec le personnage. Qu’il s’agisse d’un personnage politique ou du héros d’un jeu vidéo, le mécanisme par lequel on s’investit activement et affectivement avec celui-ci résulterait d’un effort de compréhension présent dans « tous les régimes historiquement spécifiques d’identification avec des personnages fictifs » (p. 89) et toujours lié à des exigences de construction de l’identité. Par le fait de nous inscrire dans un ordre social qui relie les corps au langage, le personnage concentre en soi notre besoin de nous rendre visibles aux autres en tant que personne.
De même qu’un héros de roman ne se résume pas à son nom propre, mais se distingue par son rapport au monde qu’il habite, de même les personnes qui habitent nos vies n’acquièrent un statut autonome que dans la tension qui s’établit entre leur vie individuelle et la réalité qui les entoure. En se penchant sur les descriptions que le Narrateur donne d’Albertine dans À la recherche du temps perdu, Frow réfléchit ainsi à la manière dont les œuvres de fiction nous restituent la « multidimensionnalité virtuelle » d’une personne, et ce par un ensemble de traits discordants qui se fixent « à tout moment comme une chose unique » (p. 201). Ce qui intéresse l’auteur, en ce sens, est surtout la façon dont la langue permet de situer une personne au centre d’une situation de manière à la fois stable et constamment mouvante. Des stratégies pronominales aux narrations impersonnelles, l’œuvre littéraire incarne l’oscillation permanente entre identification de soi et reconnaissance par autrui, centre et périphérie du point de vue, de sorte que le « personnage fictif produit l’effet d’appartenir simultanément au discours et à la représentation » (p. 243).
Matilde Manara - Configurations littéraires