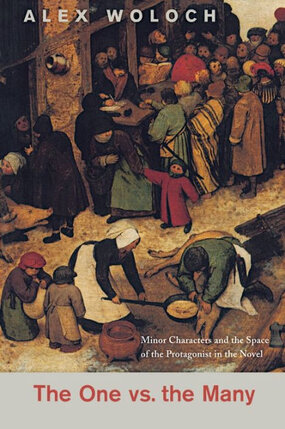Dans Du côté de chez Swann, on lit à propos de la grand-mère du Narrateur :
Elle disait : « Enfin, on respire ! » et parcourait les allées détrempées, — trop symétriquement alignées à son gré par le nouveau jardinier dépourvu du sentiment de la nature et auquel mon père avait demandé depuis le matin si le temps s’arrangerait,— de son petit pas enthousiaste et saccadé, réglé sur les mouvements divers qu’excitaient dans son âme l’ivresse de l’orage, la puissance de l’hygiène, la stupidité de mon éducation et la symétrie des jardins, plutôt que sur le désir inconnu d’elle d’éviter à sa jupe prune les taches de boue sous lesquelles elle disparaissait jusqu’à une hauteur qui était toujours pour sa femme de chambre un désespoir et un problème.
Paru en 2003, le livre d’Alex Woloch part du constat selon lequel un passage aussi complexe et syntaxiquement articulé que celui-ci s’articule autour de deux personnages mineurs : le jardinier, « qui prolonge les ellipses principales de la phrase » (p. 41), et la bonne, « qui ajoute la subordonnée finale (et donc la plus dérangeante) » (ibid.). En se déplaçant à l’arrière-plan du cadre idyllique de Combray, jardinier et bonne véhiculeraient deux procédés stylistiques (l’interruption et l’extension) permettant au Narrateur de les faire disparaître dans leur travail.
« Tous les personnages », maintient Woloch dans l’introduction au volume, « sont potentiellement limités dans leur action par l’univers fictionnel qui les entoure, et qu’ils pourraient troubler si seulement on leur prêtait l’attention qu’ils méritent » (p. 4). En adoptant une approche rhétorique et matérialiste du fait littéraire, The One vs the Many se propose de redéfinir la caractérisation des personnages à partir d’un principe qui est à la fois distributif et spatial. Au long de quatre chapitres consacrés chacun à l’étude d’un roman du XIXe siècle, Woloch s’interroge sur la répartition de l’espace limité du récit entre différents personnages en lutte pour la conquête d’une place au sein du même univers fictif. Cet univers se présente en effet comme étant occupé de façon inéquitable entre les héros d’une part et les personnages secondaires d’autre part. Tout en demeurant unifié, ce « système-personnage » (p. 14) devient le théâtre d’une série de tensions qui ne constituent pas seulement la toile de fond du récit, mais en permettent le développement. Les personnages secondaires ne peuvent dès lors pas être considérés exclusivement comme des figures subsidiaires aux personnages principaux : sans prétendre les ériger au même rang des héros – objectif qui est au centre du courant littéraire des Minor-Character Elaborations – l’auteur vise à mettre en lumière les processus de réduction, de stéréotypisation, d’ellipse, de parodie ou de compression qui conduisent à leur subordination textuelle.
La lecture de près Pride and Prejudice de Jane Austen, Great Expectations de Charles Dickens et Le Père Goriot d’Honoré de Balzac (précédés et suivis d’une ouverture et d’une conclusion portant sur l’Iliade et Œdipe Roi respectivement) permet de réfléchir aux rapports entre la précarité de l’ordre narratif et celle de l’ordre démocratique, à un moment crucial dans son évolution, l’époque de la deuxième révolution industrielle. D’après Woloch, les romans reproduisent à la fois sur le plan référentiel (celui des choses représentées) et sur le plan structurel (celui du texte) « l’absence même de voix que le système de distribution produit dans le monde » (p. 42). Les normes qui règlent cette asymétrie au sein du récit se révèlent ainsi d’autant plus utiles à comprendre les dynamiques de la subordination au sein de la société capitaliste, que la foule de personnages secondaires se disputant l’attention du lecteur sert à la mise en valeur de la richesse et de la complexité du protagoniste.
Tout comme le protagoniste, les personnages mineurs possèdent bien une « conscience » à laquelle le roman pourrait accorder priorité et attention. Cependant, leur vie intérieure demeure circonscrite et fonctionnelle à la mise en lumière de celle du héros principal. En traçant la cartographie des relations axiologiques entre les personnages, Woloch se réclame certes de l’idée selon laquelle « les personnages secondaires sont le prolétariat du roman », revendication plus formelle que thématique. En reprenant le conflit insoluble entre approches psychologisantes et structuralistes (autrement dit, entre ceux qui rapprochent un personnage d’une personne réelle et ceux qui le distinguent en tant que production purement littéraire), son livre situe ces personnages mineurs du roman à la jonction entre éléments représentatifs et éléments formels, en invitant le lecteur à les concevoir comme les analogues de l’opposition entre essor individuel (celui d’un personnage dont le destin mérite d’être raconté) et totalité sociale (celle d’un univers fictif qui force ce même individu à se démarquer des autres).
En attirant l’attention sur l’espace au sein duquel le héros agit et se construit, les personnages mineurs n’aspirent pas simplement à devenir majeurs une fois que nous reconnaissons l’importance de leur fonction au sein du récit : « Leur importance », précise Woloch, « réside plutôt et en grande partie dans la manière qu’ils ont de s’aplatir jusqu’à disparaître » (p. 109). Ainsi, lorsque nous voyons le Narrateur proustien laisser disparaître le jardinier ou la bonne derrière leur fonction, ce à quoi nous assistons n’est pas un simple escamotage narratif, mais la dramatisation d’un conflit « entre la distribution de l’attention dans le discours et le modèle potentiel de distribution dans l’histoire » (p. 110).
Matilde Manara - Configurations littéraires