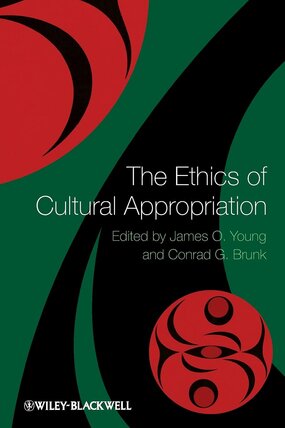Issu d’une série de rencontres interdisciplinaires financées par le conseil scientifique canadien en sciences sociales et humaines qui rassemblèrent, en mai 2005 puis juin 2006, une vingtaine de chercheurs anglophones venus d’Angleterre, d’Australie, du Canada, des États-Unis et de Nouvelle-Zélande, cet ouvrage se distingue d’abord par sa facture. À l’exception des troisième et quatrièmes chapitres, qui n’ont qu’un seul signataire, chacun de ses essais est le fruit d’une collaboration entre deux auteurs d’origine et de discipline différentes, qui s’engagent dans un exigeant travail de confrontation de leurs points de vue sur un certain nombre de sujets sensibles. Des philosophes (Conrad G. Brunk, Elizabeth Burns Coleman, A. W. Eaton, Susan Haley, Dominic McIver Lopes, Geoffrey Scarre, Alison Wiley, James O. Young) dialoguent ainsi tour à tour avec un anthropologue (Andrea N. Walsh), un archéologue (George P. Nicholas), une écologue (Kelly Bannister), un théologien (Travis Kroeker), un historien de l’art (Ivan Gaskell), des juristes (Rosemary J. Coombe, James Youngblood Henderson, Maui Solomon) et des cliniciens spécialistes d’éthique médicale (Laura Arbour, Daryl Pullman) dont certains sont, en outre, issus de groupes aborigènes dans leurs pays respectifs (en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi qu'au Canada). L’enjeu est d’aborder le phénomène très répandu de l’appropriation culturelle dans ses aspects éthiques et non éthiques, ainsi que dans tous les domaines où il fut appelé à s’exercer, sous l’égide de l’expansion coloniale européenne. Les auteurs en examinent principalement neuf : l’appropriation de découvertes archéologiques, mais également de restes humains, de matériaux génétiques, de savoirs traditionnels, de contenus et de formes littéraires et artistiques (récits, chants, airs de musique, etc.), d’œuvres d’art (sculptures, peintures), de sujets ou d’expressions artistiques, de croyances et de pratiques religieuses.
Si ces diverses réalités sont interrogées à l’aune de la problématique de l’appropriation, dans une tension constante entre leur appartenance à des contextes originels d’apparition ou de production, et leur circulation ou leurs usages dans des espaces extérieurs à ces derniers, le cœur du propos reste bien celui de la conservation d’artefacts acquis dans des relations dissymétriques de domination d’une culture sur une autre. Définie de manière intrinsèque comme une pratique d’appropriation culturelle, l’archéologie se voit par exemple interrogée dans ses objets, ses motivations et les ripostes qu’elle suscite chez les descendants des peuples étudiés. À l’autre bout du spectre – et, incidemment, du livre – c’est la muséographie qui se trouve à son tour remise en question comme l’expression ultime d’une forme de pouvoir et de spoliation. Dans les deux cas, l’une des voies privilégiées pour réparer une sorte de faute originelle, inhérente au développement de la discipline et de ses institutions, consiste non plus seulement à documenter les circonstances de l’acquisition, mais à intégrer surtout des descendants ou des autochtones dans l’étude et la valorisation des artefacts récupérés et conservés. Cette focalisation sur la dimension matérielle de l’appropriation se manifeste également dans les chapitres consacrés aux restes humains et aux demandes de restitution dont ils peuvent faire l’objet. Lorsqu’ils abordent en revanche les pratiques résolument artistiques, qu’elles soient musicales, picturales ou littéraires, les auteurs plaident communément pour un assouplissement de la notion de propriété – non point qu’ils remettent en cause celle qu’on dit « intellectuelle », et qui se trouve défendue à travers la notion de « droits réservés » – mais ils montrent que l’emprunt, l’adaptation, l’adoption même de formes, de contenus et d’usages venus d’ailleurs constituent précisément l’un des moteurs de la création ; l’essentiel est alors de ne pas oublier voire invisibiliser la source, et de concevoir sa dérivation comme une « exaptation », selon un terme évolutionniste qui souligne que l’adaptation opportuniste d’un trait ou d’un élément permet souvent de l’enrichir, en ajoutant une ou plusieurs fonctions inattendues à sa destination initiale.
Si les auteurs puisent principalement leurs exemples dans l’histoire et les trajectoires des peuples autochtones d’Amérique et d’Océanie, Anne W. Eaton et Ivan Gaskell proposent également un éclairage bienvenu sur le traitement des productions africaines dans les musées occidentaux. En sus d’offrir un recensement des auteurs et des œuvres cités, le précieux index en fin d’ouvrage ouvre enfin à une lecture plus cursive, en permettant de retrouver plus aisément les définitions des principales notions (appropriation, appropriation culturelle, appropriation subjective, collaboration, consentement, gérance, propriété, valeur…) mobilisées au fil des différentes contributions.
Anthony Mangeon - Configurations littéraires