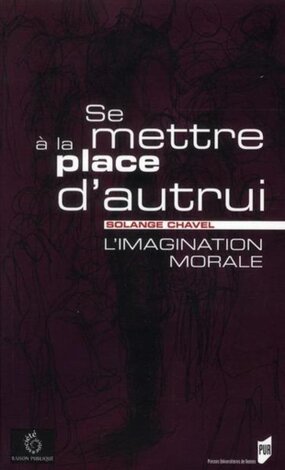Spécialiste de philosophie morale et politique contemporaine de langue anglaise, Solange Chavel est l’une des principales introductrices en France de l’œuvre de Martha Nussbaum, dont elle a traduit trois livres. Ses travaux, qui se situent dans le sillage de ceux de l’autrice américaine mais aussi de ceux de Cora Diamond, Sandra Laugier ou Jacques Bouveresse, se caractérisent par la revendication d’une éthique appliquée et par la volonté de ne pas envisager les problèmes moraux indépendamment de leurs contextes d’émergence. Ce souci explique l’importance que Solange Chavel confère aux œuvres littéraires, envisagées non seulement comme des réservoirs d’exemples mais aussi comme des ressources philosophiques à part entière : une approche particulièrement sensible dans son livre Se mettre à la place d’autrui : l’imaginationmorale, qui porte sur le rôle de l’imagination en morale.
Partant du constat que la plupart de nos désaccords moraux résultent de perceptions différentes d’une même situation, la philosophe s’interroge sur la valeur éthique et épistémologique de l’empathie, c’est-à-dire de la capacité à se mettre à la place d’autrui pour partager ses émotions et ses sentiments. Si bien juger moralement exige de bien voir, c’est-à-dire de proposer la description la plus juste possible de la situation en jeu, Solange Chavel insiste sur l’importance de cette faculté de décentrement, en soulignant que les situations morales mettent souvent en jeu une pluralité de points de vue différents. La thèse est proche de celle que défend Martha Nussbaum dans La Connaissance de l’amour ([1990] 2010), et elle s’accompagne comme chez cette dernière d’une apologie des récits littéraires comme lieux de mise en œuvre par excellence de l’imagination morale. L’un des principaux apports du livre de Solange Chavel réside néanmoins dans la prise en compte des critiques adressées à la philosophe américaine, entre autres par Richard Posner (1997) et Suzanne Keen (2007). Ces critiques la conduisent à nuancer sa position : il ne s’agit pas, selon elle, de soutenir que l’empathie serait par définition une activité moralement bonne, ni d’en défendre les effets sociaux et politiques (et donc son rôle dans les révolutions morales). Sa valeur, comme celle des récits littéraires qui la mettent en œuvre, est avant tout épistémique :
La capacité à se mettre à la place d’autrui comme telle ne préjuge absolument en rien de la propension à agir de manière moralement bonne. Ce qui signifie que si on veut défendre l’intérêt de l’imagination pour le raisonnement moral, ce doit être d’abord pour des raisons épistémologiques et non pas immédiatement pratiques : parce que l’imagination nous donne les moyens de juger plus finement (sans préjuger de l’usage qui sera ensuite fait, sur le plan de l’action, de cette connaissance morale raffinée) (p. 119)
La thèse se déploie en quatre chapitres. Le premier est le plus philosophique : Solange Chavel s’interroge sur la nature du raisonnement moral, et plus spécifiquement sur la façon dont s’articulent jugement et perception. Elle soutient que le jugement moral est toujours le fruit d’un effort de discernement effectué par des sujets situés, et non par des intellectuels désengagés. En ce sens, il n’est pas indépendant du travail de perception, mais en constitue un aspect constitutif : « juger moralement, c’est expliciter une perception » (p. 54). L’idée est illustrée par l’exemple de l’homme qui se lève, dans le métro, pour laisser sa place à une femme enceinte. Solange Chavel montre que le raisonnement moral ne procède pas alors à vide, mais dépend de la manière, déjà pleinement évaluative, dont la situation est perçue : en l’occurrence, le type de perception morale que celle-ci engage est la capacité à reconnaître un corps humain ou animal comme doté de sensations de douleur ou de plaisir.
Les deuxième et troisième chapitres partent du constat qu’il y a donc bien « quelque chose à voir en morale » pour opposer deux conceptions philosophiques du point de vue moral. La première est la fiction du spectateur impartial défendue par Adam Smith. La bonne position morale serait une position de surplomb : tout en étant capable de comprendre ce que ressent l’agent souffrant par l’exercice de la sympathie, le spectateur impartial est désengagé de la situation, ce qui lui permet de ne pas être biaisé. Solange Chavel critique cette « fiction », et plus généralement les théories défendant l’existence d’un point de vue idéal, en montrant que celles-ci reposent sur un fantasme d’omniscience qui ne correspond pas à la réalité de nos vies morales ordinaires, et surtout qu’elles présupposent une approche monologique qui nie le particulier et l’existence de conflits de valeurs parfois insolubles. Elle leur préfère une seconde solution, étudiée dans le troisième chapitre : celle que proposent les éthiques du care. Pour ces dernières, voir bien, c’est voir comme celui qui est concerné par la situation. À cette conception correspond une apologie de l’empathie, à laquelle la philosophe préfère le concept d’imagination morale, emprunté aux philosophes anglo-saxons : l’enjeu n’est plus d’adopter une position de surplomb mais de pratiquer des formes de décentrement multiples, pour saisir chaque cas singulier depuis une pluralité de points de vue.
La dernière partie est celle qui confère à la théorie et aux œuvres littéraires la place la plus importante. La philosophe y confronte sa défense de l’imagination morale (et donc de la littérature) aux objections qui peuvent lui être adressées, ouvrant des pistes de questionnement éthiques susceptibles d’être prolongées au-delà de son livre. Deux d’entre elles en particulier méritent d’être commentées. Revenant sur la question du pluralisme, la philosophe se confronte d’abord au problème du relativisme moral. Elle souligne la nécessité de décorréler empathie et suspension du jugement — de ne pas confondre l’idéal d’équité qui sous-tend l’effort de décentrement avec une injonction plus contestable à la neutralité éthique. Comment s’assurer que la pluralisation des points de vue ne conduise pas à une dissolution du cadre moral ? La question a des implications morales, que la philosophe explore à partir des fictions de Faulkner et de Dostoïevski et en soulignant, comme André Markowicz, les enjeux éthiques de la théorie bakhtinienne de la polyphonie. Elle a aussi des implications poétiques, que Vincent Message notamment a exposées dans son essai sur les Romanciers pluralistes (2013). Le second problème abordé par Solange Chavel concerne la possibilité d’une « imagination amorale » (p. 178), qui peut prendre deux formes distinctes. L’empathie peut se heurter à une limite cognitive, lorsque le caractère exceptionnel d’une situation rend l’imagination impossible. Mais elle peut aussi rencontrer une limite éthique, et les deux exemples proposés par la philosophe sont le point de vue du « fou » (Benjy dans Le Bruit et la fureur) et le point de vue du « monstre » (Les Bienveillantes de Jonathan Littell et Méridien de sang de Cormac McCarthy). Ceux-ci soulèvent la question de la nature de la connaissance morale acquise au terme de la lecture de ces fictions extrêmes, mais aussi de sa valeur et des risques qu’induit sa transmission par la littérature.
Bibliographie :
Mikhail Bakthine, La Poétique de Dostoïevski, trad. fr., Paris, Seuil, [1929] 1970.
Suzanne Keen, Empathy and the Novel, Oxford, Oxford University Press, 2007.
Vincent Message, Romanciers pluralistes, Paris, Seuil, 2013.
Martha Nussbaum, La Connaissance de l’amour : essais sur la philosophie et la littérature, trad. fr., Paris, Cerf, [1990] 2010.
Richard Posner, « Against Ethical Criticism », Philosophy and Literature, vol. 21, n°1, 1997.